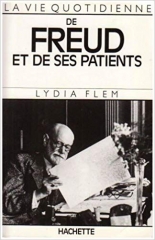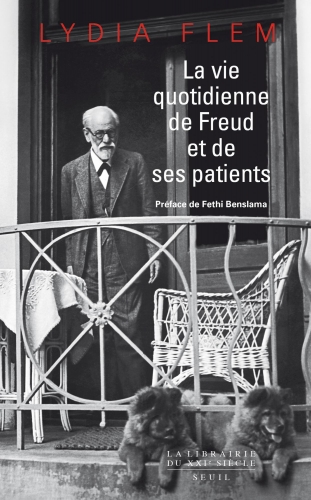L’essai de Cynthia Fleury, Ci-gît l’amer, a pour sous-titre « Guérir du ressentiment ». Lire les titres de la quinzaine d’ouvrages publiés depuis 2000 par cette philosophe et psychanalyste donne un aperçu de ses thèmes de prédilection : culture, soin, démocratie, courage, dignité… Elle rappelle au début que la lutte contre le ressentiment est l’objet premier de la cure psychanalytique et avertit : il n’y a pas de réparation au bout du chemin. Le bonheur visé « ne sera jamais cet ancien bonheur », il s’agit de « créer ce qui n’a jamais existé ».
Retrouver « une forme de santé », « ce sera reprendre le chemin de la création, de l’émergence possible ». L’incitation à écrire pour s’extraire du ressentiment n’est pas du côté de la rumination mais de la répétition, comme dans un rituel : « Le rituel permet d’habiter le monde. » Dans le ressentiment, on perd « l’accès au juste regard sur les choses », en sortir permet de « continuer à s’étonner du monde », à s’émerveiller.
« Un monde incommensurable existe entre éprouver l’amertume, le sentiment d’humiliation et d’indignité, réel mais dont on refuse la permanence, et le fait de se considérer comme la victime expiatoire universelle, de poser cela comme un statut, de vouloir donner écho à cette aigreur, qu’elle vienne consolider une théorie, et se vivre comme réaction, comme débordement. »
Le lien avec les discours victimaires ou les postures agressives, le ressentiment collectif dont l’actualité nous abreuve s’établit aisément, et en particulier dans la deuxième partie du livre, consacrée au fascisme. Qu’il s’agisse du leader, « un autre médiocre » vu comme protecteur, ou de l’idéologie fasciste, « idéal de rétrogradation » lié au délire de persécution, issu de l’impuissance à produire une action transformatrice dans le monde. De l’acquiescement secret à Vichy, l’autrice rapproche la prolifération des propos haineux sur les réseaux sociaux où l’on exprime son ressentiment « sans en payer le prix », anonymement.
La part de vérité qui l’intéresse, écrit-elle, « se situe du seul côté de l’œuvre, qu’elle soit artistique ou qu’elle relève plus généralement de l’ordre de la subjectivation (enfantement, amour, partage, découverte du monde et des autres, engagement, contemplation, spiritualité, etc.) » Parmi les nombreux philosophes, psychanalystes et écrivains auxquels l’autrice fait référence, attentive à ce qui constitue l’essence du « soin », j’ai été frappée par cette citation de Frantz Fanon, « psychiatre et penseur de l’après-colonialisme » : « Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l’invention dans l’existence » (Peau noire, masques blancs).
Cynthia Fleury : « L’expérience de la beauté est une éthique de la reconnaissance qui ne dit pas son nom. Et lorsque des êtres faillissent, lorsqu’ils sont incapables de nous donner un peu de cette reconnaissance dont nous avons tant besoin, il faut alors se saisir de la vie passée et faire alliance avec les morts, les grands artistes souvent non reconnus qui nous ont précédés. Il faut faire alliance avec la culture pour sortir du désastre de l’avilissement programmé. »
Ci-gît l’amer, une fois analysées les multiples raisons ou façons de céder au ressentiment, individuel ou collectif, propose un chemin pour en sortir, même si cela peut prendre des années. Cet essai, une lecture exigeante, parfois difficile dans ses commentaires philosophiques et psychanalytiques, est en même temps une belle défense de l’art et de la littérature pour résister à l’assaut du ressentiment, rebâtir « une part de paix » en laissant derrière soi (« ci-gît ») l’appel ténébreux de l’amertume.