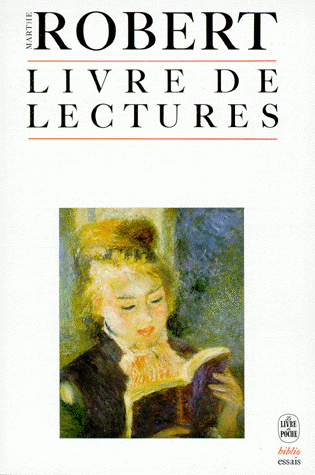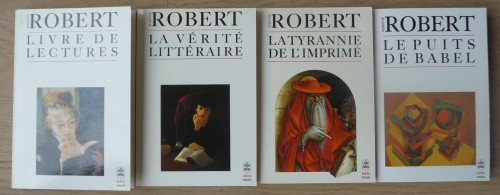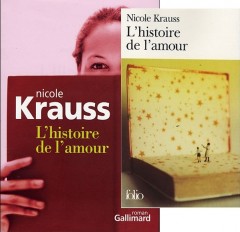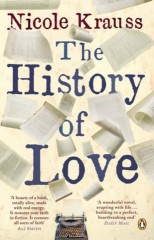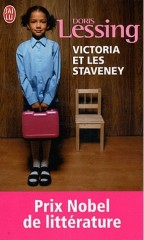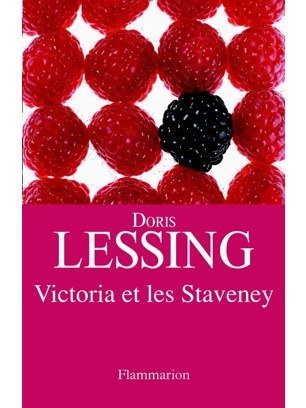Tandis que je vous prépare quelques extraits choisis pour les deux semaines qui viennent – espérant trouver plus de chaleur dans le sud de la France – je me décide à vous écrire quelques mots sur la grande lectrice avec qui je vais vous laisser, en bonne compagnie (vous en jugerez).
J’ai puisé dans le Livre de lectures de Marthe Robert (1914-1996) et je me désole de ne pas trouver davantage de renseignements sur la Toile pour vous parler d’elle, que je connais par ses livres, et que j’aurais aimé connaître aussi en personne. C’est Kafka qui m’a fait découvrir son nom, son cher Kafka sur qui elle a tant écrit : de l’Introduction à la lecture de Kafka (1946) à Seul, comme Franz Kafka (1969).
Essayiste et traductrice nourrie de littérature et de psychanalyse, Marthe Robert « occupe dans la géographie de notre monde intellectuel une place inassignable, et pourtant irremplaçable. » (Livre de Poche) Tournée surtout vers la littérature en langue allemande, langue qu’elle a apprise « parce que son père, combattant dans la Première Guerre mondiale, était devenu un militant de la paix » (Wikipedia), elle a traduit entre autres le Journal de Kafka, « triplement suspect aux yeux des Tchèques » de Prague par le fait qu’il était juif, parlait allemand et était le fils d’un commerçant dont la plupart des employés étaient tchèques.
La notice consacrée à Marthe Robert sur « L’Encyclopédie libre » ne nous apprend pas grand-chose de sa vie, mais la bibliographie de cette spécialiste de Kafka parle pour elle. Etonnant tout de même d’apprendre là qu’elle a eu pour premier mari un peintre, et pour second un psychanalyste, alors que les notices concernant ces messieurs ne citent même pas le nom de Marthe Robert (ni rien de leur vie privée). Et c’est ainsi que le nom des femmes (intellectuelles, artistes, etc.) continue trop souvent à être gommé des tablettes de l’histoire.
Roman des origines et origines du roman (1972) est une lecture essentielle pour qui s’intéresse au genre romanesque. Genre « indéfini », le roman est « passé du rang de genre mineur et décrié à une puissance probablement sans précédent » et règne à présent sur la vie littéraire, « genre révolutionnaire et bourgeois », « libre jusqu’à l’arbitraire et au dernier degré de l’anarchie ».
« Les histoires à dormir debout sont de celles qui tiennent le mieux éveillé », écrit-elle à propos des contes. S’inspirant du « roman familial des névrosés » selon Freud, elle distingue « deux façons de faire un roman : celle du bâtard réaliste, qui seconde le monde tout en l’attaquant de front ; et celle de l’enfant trouvé, qui, faute de connaissances et de moyens d’action, esquive le combat par la fuite ou la bouderie. » Dans la première catégorie, Balzac, Hugo, Tolstoï, Dostoïevski, Proust, Faulkner, Dickens… Dans la seconde, Cervantes, Hoffmann, Kafka, Melville… Où situer Flaubert ? La réponse de Marthe Robert s’intitule En haine du roman.
Pour vous, j’ai feuilleté les quatre tomes de son Livre de lectures, « une sorte de Journal non daté » où elle s’est donné pour but de « relever au jour le jour ce que le fait littéraire a de flou, de fuyant et d’incompréhensible au fond sous ses airs rassurants de phénomène classé ». Je vous en souhaite bonne lecture.