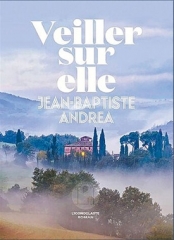Julie Wolkenstein a écrit une thèse sur Henry James, dont le fantôme hante un peu L’heure anglaise, son deuxième roman (2000) qui m’avait beaucoup plu à la première lecture. Elle y raconte une journée d’été d’Edward et Susan Sanders, qui vivent dans une belle maison à la campagne, en 1911. Je me souvenais surtout de la longue promenade clandestine d’Edward, averti par un télégramme à la gare d’un rendez-vous annulé, qui le laisse libre pour la journée. Il décide de rentrer à pied en longeant la rivière, tandis que Susan se rend à Londres, sans qu’il le sache.

Motif "Chèvrefeuilles" du papier peint par William Morris
« Edward », la première partie, remonte à la veille au soir : en secouant les cendres de son cigare à la fenêtre, il regarde les rectangles de lumière sur la pelouse et descend éteindre l’électricité à la cave. Deux cents bouteilles de vin ramenées de Provence – il les collectionne depuis dix ans – y témoignent de sa véritable passion, alors que ses amis louent davantage la qualité de ses cigares, hérités de son père. Dans leur chambre, Susan dort déjà.
Le matin, une fois qu’il a vu ses enfants, Miles et Flora, au petit déjeuner, et Susan qui a rempli un panier de fleurs blanches pour la soirée chez les Porter, leurs voisins, Edward va prendre le train pour se rendre à l’étude Closely, Sanders & Co. Au téléphone, on lui a confirmé qu’il était « inutile de venir » : le voilà libre pour la journée. Sans avertir chez lui, Edward emprunte le sentier qui borde la Sheldon River et se souvient, en marchant, de son enfance solitaire.
Sa mère, « née Lady Virginia, fille du dix-septième duc de Coolingham », a mis quatre filles au monde, toutes décédées avant la naissance de son fils. Féministe militante qui réunissait des femmes du monde chez elle, elle n’entrait quasi jamais dans la nursery où Edward jouait seul avec ses soldats de plomb. Livré aux nurses, il ne voyait guère son père, retranché dans son bureau où il se faisait même porter ses repas.
Sa mère s’était tuée dans un accident d’automobile, son père ne lui avait pas survécu longtemps. Il avait vendu leur maison. Ne fait-il pas comme son père, au fond, en laissant derrière lui chaque matin sa famille et les domestiques ? Tout à sa flânerie inopinée, il ne se montre pas quand il entend les voix de deux d’entre elles, ni quand il aperçoit ses enfants avec leur gouvernante. Rentré dans la salle à manger ouverte sur le jardin, que prolongent les chèvrefeuilles de William Morris sur le papier peint, il épie la maisonnée à cette heure où il n’est jamais là.
La cuisinière a préparé un gigot d’agneau qui doit cuire sept heures, il s’en délecte, lui à qui on ne sert d’habitude que de la volaille ou du poisson maigre. Dans leur chambre, Susan a laissé traîner un roman d’Edith Wharton ; il en tombe un carton : l’annonce du décès de Miss Amanda Closely à trente ans, celle qu’il avait failli épouser.
« Susan », la deuxième partie , deux fois plus courte, débute dans le bureau d’Edward à Londres, où son épouse pensait lui faire la surprise, après son rendez-vous chez Asquith, d’un déjeuner ensemble. Au rez-de-chaussée, dans la vitrine d’un magasin de nouveautés, elle a remarqué d’emblée une écharpe en soie brochée, bordée de velours écarlate. Elle décide de l’acheter pour la porter le soir même.
Elle aussi est assaillie par ses souvenirs, de ses amies de jeunesse dont l’une était morte accidentellement lors d’une sortie en voilier. En déjeunant seule dans le salon de thé où elles se retrouvaient jadis, elle pense à ce qu’elle doit annoncer à Edward. Ses pensées croisent celles d’Edward, les éclairent d’un autre jour. Elle ne sait pas encore qu’elle va le retrouver à la maison en rentrant.
Le couple en couverture du Folio (un détail d’une peinture de Cucuel) a peut-être été choisi pour ce regard non échangé ou par allusion à l’endroit où les Sanders passent leurs vacances, dans le Midi. J’ai préféré reprendre ce motif de William Morris dans leur salle à manger, où se déroule la dernière partie de ce roman où Julie Wolkenstein excelle à peindre des atmosphères, un saut dans le temps inattendu et révélateur. « Une intrigue faussement simple », selon le billet de Keisha, fan de cette romancière, qui m’a donné envie de relire L’heure anglaise.