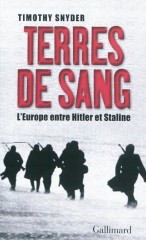Ce livre attendait depuis longtemps sur l’étagère, je pressentais une lecture éprouvante. Terres de sang – L’Europe entre Hitler et Staline de Timothy Snyder (Bloodlands, 2010, traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, 2012) est un essai historique dont les pages vous laissent pétrifiés, horrifiés, sans voix. Lecture indispensable pour qui souhaite une vue d’ensemble de la seconde guerre mondiale, dont nous ne connaissons souvent que ce qui concerne l’Europe de l’Ouest. C’est Charlotte Delbo qui m’a aidée à ouvrir ce livre. Encore merci à celle qui me l’a offert. J’y consacrerai plusieurs billets.
 £
£
Etendue de la famine 1932-1933 (Perspectives ukrainiennes)
Snyder, né en 1969, enseigne l’histoire de l’Europe centrale et orientale à l’université de Yale. Son essai parle des 14 millions de victimes – pas une n’était un soldat en service – massacrées entre 1933 et 1945 sur les terres de sang qui vont « de la Pologne centrale à la Russie occidentale en passant par l’Ukraine, la Biélorussie et les pays Baltes ». Il raconte « l’histoire d’un meurtre politique de masse », l’interaction des politiques de tuerie soviétique et nazie. Sur ces 14 millions de personnes, « un tiers sont à mettre au compte des Soviétiques ».
« J’aurais voulu citer tous les noms un par un, mais on a pris la liste, il ne reste plus rien. » (Anna Akhmatova, Requiem) Les nombres ne doivent pas masquer toutes ces vies individuelles effacées. L’historien insiste dans sa préface sur la forme de son étude née « non pas de la géographie politique des empires, mais de la géographie humaine des victimes. »
Après la première Guerre mondiale, Berlin et Moscou souhaitent changer l’ordre européen aux dépens de la Pologne. Le « grenier » ukrainien attise aussi leur convoitise. Avec Hitler et Staline au pouvoir, « plus de gens furent tués en Ukraine que partout ailleurs. » A qui s’en étonnerait, le chapitre consacré aux « Famines soviétiques » apprendra beaucoup. 1933 fut une année de faim dans le monde occidental mais aussi dans les villes soviétiques et en Ukraine. Les paysans privés d’abord de leurs récoltes, puis de leurs semences, allaient jusqu’à mendier en ville, un comble. Le plan quinquennal de Staline (1928-1932) avait pour objectif le développement industriel, la mort des paysans en fut le prix.
D’abord par la guerre déclarée aux « koulaks en tant que classe » : dans chaque localité, une « troïka » (un policier, un responsable local du parti, un procureur) décide du sort des paysans, sans appel possible. Déporté vers la Sibérie, le Kazakhstan ou les îles Solovki, le paysan ukrainien devient un travailleur du Goulag – un « second servage ». Ensuite par la collectivisation, dont le fiasco déclenche une famine comme on n’en avait jamais vu, due aux exportations alimentaires vers la Russie soviétique.
Staline le sait, ne fait rien pour y mettre fin. Au contraire. Accusant les affamés de vouloir saper les progrès du socialisme ou de viser des fins nationalistes, il prend des mesures qui aggravent encore la situation des Ukrainiens, engendrant le crime, le cannibalisme – y compris dans les familles –, la mort. « Pour l’Ukraine soviétique, on peut raisonnablement avancer un chiffre d’environ 3,3 millions de morts de faim ou de maladies liées à la famine en 1932-1933. »
La plus grande famine artificielle de l’histoire. Peu de journalistes et de diplomates étrangers prennent la mesure de l’horreur. Orwell en a fait l’exemple « de la vérité noire que les artistes de la langue avaient recouverte de couleurs vives ». Un journaliste anglais, anonymement, dénonce « un des crimes les plus monstrueux de l’histoire, si terrible qu’à l’avenir on aura peine à croire que ça s’est produit. »
Il faut lire Terres de sang pour suivre point par point, faits et témoignages à l’appui, l’analyse de ces politiques meurtrières. La nazification de l’Allemagne a masqué aux yeux des Européens la réalité de la révolution stalinienne en Union Soviétique. Beaucoup espéraient faire de l’URSS une alliée. Or les deux systèmes consolident leur pouvoir dès 1933. Snyder montre leurs différences – Hitler refusant la collectivisation, Staline se posant en « antifasciste » – et leur convergence.
Après la guerre aux koulaks, Staline et le Politburo s’en prennent aux « éléments antisoviétiques », condamnant à mort tout contre-révolutionnaire et instaurant des « quotas d’exécution et d’emprisonnement », présentés officiellement comme des limites (les officiers locaux du NKVD savent qu’ils auront à s’expliquer si ces limites n’étaient pas atteintes et les débordent systématiquement). « La Grande Terreur fut une troisième révolution soviétique. » En URSS, les Polonais furent les principales victimes du « meurtre national de masse » initié par Staline, où qu’ils soient sur les « terres de sang ».
Auschwitz est aujourd’hui le « site de tuerie » le mieux connu, grâce aux témoignages des survivants. Mais Hitler ne voulait pas seulement éradiquer les Juifs, il voulait aussi détruire la Pologne et l’Union Soviétique, plus tard. L’attaque de la Pologne par la Wehrmacht le premier septembre 1939, après le pacte Molotov-Ribbentrop du 23 août, ouvre la moitié du pays à l’Union soviétique. Terreur allemande dans le ciel polonais, puis un demi-million de soldats de l’Armée rouge en Pologne, suscitant à la fois peur et espoir – vite détrompé : les officiers polonais se retrouvent dans des camps, les Soviétiques font plus de cent mille prisonniers de guerre – « une sorte de décapitation de la société polonaise ».
A l’ouest de la ligne Molotov-Ribbentrop, les SS ont les mains libres pour éliminer en priorité les classes instruites, pour terroriser les Juifs afin qu’ils fuient à l’est. En zone soviétique, de nouveaux passeports intérieurs sont exigés. Les Polonais, considérés comme dangereux, sont déportés vers le Goulag, comme les koulaks avant eux. Ce n’est pas seulement de l’hiver exceptionnellement froid de 1939-1940 que souffrent les prisonniers polonais. Après interrogatoire, on les emmène au sous-sol pour leur loger une balle dans la nuque. En Europe occidentale, on parle alors de la « drôle de guerre » où apparemment, il ne se passe rien.
Comment se débarrasser des deux millions de Juifs de leur moitié de la Pologne, voilà ce qui préoccupait les dirigeants nazis en 1940. Eichmann propose de les déporter à l’est, mais « l’opération n’intéressait pas Staline. » C’est à cette époque que Julius Margolin est arrêté (Voyage au pays des ze-ka). Alors on constitue des ghettos, à Lodz, à Varsovie et ailleurs – « autant de camps de travail improvisés et enclos en 1940-41. » Un nouveau camp est créé près de Cracovie : Auschwitz. On y expédie d’abord des détenus politiques polonais ; en novembre, le camp devient un site d’exécution.
(A suivre)