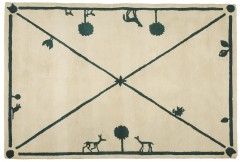Deux ans après Le Fusil de chasse, Yasushi Inoué publie trois récits, brefs mais denses, autour de l’accompli et de l’inaccompli. Les couples, chez ce maître de la prose japonaise, sont de curieuses entités, une conjonction de solitudes où l’homme et la femme ne se parlent qu’avec peine comme si ce qu’ils ressentent vraiment relevait de l’incommunicable.
La Mort, l’amour et les vagues, la nouvelle éponyme, a pour décor l’hôtel Nanki, « une maison coquette, de type occidental », au bord de la mer, en haut d’une falaise. « « Vraiment idéal ! » pensa Sugi. C’était la première fois qu’il se réjouissait d’avoir trouvé un endroit convenable pour se donner la mort. »
A trente-huit ans, à la suite de maladresses, de malchance aussi, l’homme a dilapidé la fortune héritée de son père, un excellent banquier. D’un jour à l’autre, sa photo sera dans le journal, et ce déshonneur lui paraît pire que la mort. Sugi s’offre trois jours pour lire le Voyage en Orient de Guillaume de Rubrouck, un prêtre, une lecture qu’il désire faire depuis longtemps. Ce sera « son dernier luxe », puis il en finira avec la vie. Ce qu’il n’a pas prévu, c’est qu’en ce mois de septembre, quelqu’un d’autre a réservé une chambre à l’hôtel, une femme. Le garçon d’hôtel lui a permis de regarder sa fiche où elle a noté : « Objet du séjour : MORS ».

A l’heure du repas, le premier soir, Sugi accepte que la jeune femme et lui partagent une même table. Nami, vingt-trois ans, est belle et silencieuse, absorbée dans ses pensées. Sugi ne lui cache pas ce qu’il sait, elle insiste alors pour qu’il ne dérange en aucune façon son projet. Rien à craindre. Pour Sugi, l’être humain est libre de choisir sa mort. Nami lui confie qu’elle vient de rompre et lui demande, au cas où quelqu’un viendrait à sa recherche, de lui donner une rose rouge, une fleur artificielle qu’elle lui tend, ou de la jeter si personne ne se présente. Mais ce n’est pas si facile de se jeter du haut d’une falaise, se dit Sugi en cheminant sur le sentier au bord du précipice. Devant « le spectacle splendide » à ses pieds, « il fut surpris d’entendre tout en bas le bruit des vagues venant frapper d’innombrables écueils. » Pour l’un comme pour l’autre, la présence d’un témoin change la donne. On verra jusqu’à quel point.
La deuxième nouvelle, Le jardin de pierres, se déroule à Kyôto, « l’ancienne et paisible capitale » où Uomi a passé sa jeunesse. En voyage de noces, il veut faire découvrir à son épouse Mitsuko ses endroits préférés, « se promener, tendrement serrés l’un contre l’autre, comme les jeunes mariés qu’ils étaient ». Ensemble, ils visitent le pavillon de thé du Ninnaji, puis marchent jusqu’au jardin de pierres du Ryôanji. « L’air et la lumière étaient d’une pureté inimaginable à Tôkyô. »
Pour Uomi, ce jardin est lié à des souvenirs marquants. Etudiant, il s’y promenait avec son meilleur ami, Totsuka, avec qui il partageait tout. Amoureux tous deux d’une hôtesse de bar, Rumi, c’est ici qu’ils se sont bagarrés pour elle, et que Totsuka a renoncé à son amour et même à ses études. Uomi et Rumi ont vécu quelque temps ensemble, puis se sont séparés, ici même. Est-ce vraiment une bonne idée pour le jeune couple de fouler à nouveau ce lieu si beau et si fatal ?
Anniversaire de mariage raconte les souvenirs conjugaux de Karaki Shunkichi. A trente-sept ans, il vient de perdre sa femme. L’idée de se remarier, que lui souffle son entourage, lui répugne. Non qu’il soit inconsolable, « Kanako était bavarde et entêtée et cela l’agaçait ». Mais ce modeste comptable partageait avec elle un vice inavouable : l’avarice. En réalité, il leur a toujours fallu économiser pour nouer les deux bouts. Deux ans plus tôt, Mitsuko était rentré chez lui avec une étonnante nouvelle ; il avait gagné dix mille yens ! Ils avaient envisagé alors de mettre la moitié de côté et de dépenser le reste en se rendant à Hakone, en y logeant à l’hôtel, ce qui ôterait à Kanako la honte de n’être jamais partie en voyage de noces. Le jour de leur cinquième anniversaire de mariage, ils se mettent donc en route. Un voyage inénarrable, où la joie du dépaysement se marie au désir de ne rien dépenser inutilement, ce qui les conduit, inévitablement, vers une tout autre destination que prévu. Inoué porte sur l’amour, sur ce qui lie entre eux les êtres, un regard d’une terrible ironie, et c’est peu dire.