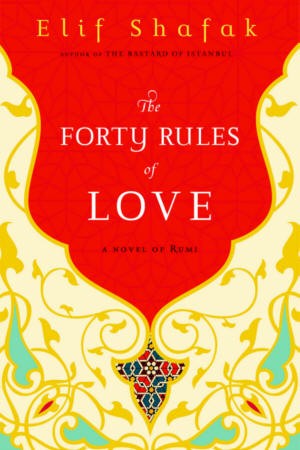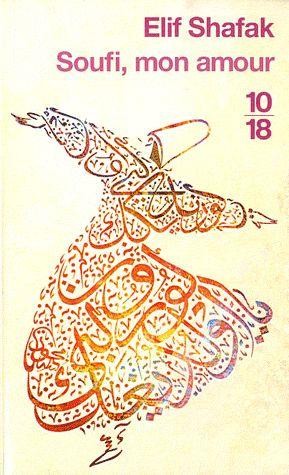Elif Shafak met sans doute un peu d’elle dans ses héroïnes qui, d’un roman à l’autre, se posent plein de questions. Trois filles d’Eve (2016, traduit de l’anglais (Turquie) par Dominique Goy-Blanquet, 2018) tourne autour d’une question essentielle déjà abordée (très différemment) dans Soufi, mon amour, même si la romancière turque (qui vit à Londres) raconte surtout ce qui arrive à Nazperi Nalbantoglu, appelée Peri, trente-cinq ans, une « bonne personne » aux yeux de sa famille et de ses amis stambouliotes : « Bonne épouse, bonne mère, bonne maîtresse de maison, bonne citoyenne, bonne musulmane moderne, voilà ce qu’elle était. »

« Le temps, comme un tailleur adroit, avait raccordé par des coutures invisibles les deux tissus qui gainaient la vie de Peri : ce que les gens pensaient d’elle, et ce qu’elle pensait d’elle-même. » Très vite, la narratrice la plonge dans une situation problématique qui fait découvrir au lecteur les tumultes de sa vie intérieure et la renvoie à son autre moi secret : la Peri étudiante à Oxford, celle qui aimait courir tous les jours, celle qui garde sur elle une photo d’alors, où elle est en compagnie de deux autres étudiantes – et du professeur Azur.
Avec sa fille de douze ans en pleine crise d’hostilité, Peri est coincée dans la folle circulation d’Istanbul. Adnan, son mari, l’attend à un dîner mondain dans le « manoir balnéaire » d’un riche homme d’affaires. Elle préférerait de loin rester à la maison avec un bon roman, mais « la solitude était un privilège rare à Istanbul ». Par erreur, elle a jeté son sac de luxe (un faux) sur le siège arrière et laissé les portes de sa Range Rover déverrouillées ; pendant qu’elle attend le feu vert pour avancer, un vagabond surgit et vole son sac. Sans réfléchir, elle laisse sa fille en lui disant de l’attendre avec les portes fermées et se lance à sa poursuite.
Entre 1980 et 2016, Trois filles d’Eve déroule plusieurs séquences de la vie de Peri. « La dernière-née des Nalbantoğlu » a grandi dans un quartier populaire sans se sentir privée de rien, sinon de sérénité, entre ses parents « aussi incompatibles que la taverne et la mosquée ». Mensur, son père, abuse du raki ; il aime discuter politique, déplorer l’état des choses, honore la mémoire d’Atatürk. Selma, sa mère, a changé sous l’influence d’un prédicateur ; elle se couvre complètement la tête et veut ramener les gens dans le droit chemin d’Allah, son mari en premier lieu. La religion a divisé la famille en deux : Selma et le fils cadet, Mensur et le fils aîné ; Peri, « tiraillée » entre les deux, ne veut offenser personne.
Quand son frère aîné, gauchiste, se fait arrêter et condamner pour appartenance à une organisation communiste illicite, le conflit entre ses parents monte encore d’un cran et Peri entame sa propre « querelle avec Dieu ». S’il ne leur vient pas en aide, c’est qu’il n’est pas tout-puissant ou bien qu’il n’est pas miséricordieux. En colère, Peri s’interroge sur la nature de Dieu. Pour l’apaiser, son père lui offre un carnet et l’encourage à y écrire ses pensées sur Dieu, écrire, effacer, pour éviter les idées noires. Il la soutient dans ses études, elle est bonne élève, et c’est lui qui va l’inscrire à Oxford, convaincu de ses grandes capacités : « Il n’y a que les jeunes comme toi qui peuvent changer le destin de ce vieux pays fatigué. »
Quand Peri est arrivée à Oxford avec ses parents, Selma l’a tout de suite mise en garde contre Shirin, l’étudiante iranienne de deuxième année qui les a accueillis : grande, maquillée, séduisante. Celle-ci, sa future voisine de chambre au collège, se révèle audacieuse dans tous les domaines. C’est elle qui parle la première à Peri du professeur Azur, qui lui a « ouvert les yeux » dans un cours sur Dieu qu’elle lui recommande. Peri a bien trop à découvrir, à lire, à étudier, pour envisager de s’inscrire à un séminaire en plus. Oxford la ravit : la beauté des bâtiments anciens, le silence (inconnu à Istanbul), l’ivresse de vivre une étape importante de sa vie. Elle s’achète une paire de baskets pour courir et le jogging devient une habitude quotidienne, sa meilleure manière de s’alléger de ce qui la préoccupe.
Durant « la semaine des débutants », elle fait la connaissance de Mona, une étudiante égypto-américaine qui porte le foulard. En deuxième année, celle-ci est bénévole dans diverses associations et milite pour le féminisme. Peri, Shirin, Mona : les trois filles d’Eve sont très différentes. Peri n’est pas facilement à l’aise avec les autres, que ce soit là-bas quand elle était étudiante ou à Istanbul, à cette soirée où sa fille, qui a récupéré le polaroïd tombé du sac de sa mère où elle est photographiée en leur compagnie, la met mal à l’aise en l’exhibant. Une des invitées croit y reconnaître un professeur d’Oxford licencié après un scandale avec une étudiante et met Peri sur la sellette, celle-ci prétend ne pas le connaître.
Or elle a fini par croiser le chemin du professeur Azur, elle a même été admise à son cours, le plus surprenant de ceux qu’elle a suivis, le plus passionnant aussi, bien qu’il l’ait souvent mise mal à l’aise. Le roman d’Elif Shafak distille peu à peu le passé de Peri, qui cherche sa voie entre les certitudes de Mona et les insolences de Shirin, lit énormément, curieuse de tout et inquiète d’elle-même. Comme avec ses parents, elle est toujours à la recherche d’une voie médiane. La vie étudiante lui permet de se familiariser avec d’autres modes de vie. Les onze étudiants d’Azur ont été sélectionnés pour entrechoquer leurs convictions sur Dieu et apprendre à ne pas se focaliser uniquement sur la religion qui ne fait que « diviser et brouiller l’esprit ».
La romancière maintient le suspense sur près de six cents pages, tant à propos de ce qu’a vécu Peri à Oxford que sur la soirée stambouliote qui tourne mal. A travers une histoire très romanesque, Elif Shafak illustre dans Trois filles d’Eve les tensions de la famille et de la société turques, la découverte excitante de la vie universitaire, les choix de vie des jeunes femmes. Ecrire ce roman a été éprouvant pour cette « citoyenne du monde », comme elle se définit dans une vidéo sous-titrée sur le site de l’éditeur, « émotionnellement et intellectuellement », mais elle a voulu porter dans la sphère publique ces débats qui ont lieu, faute de liberté d’expression, dans la sphère privée.
Inquiète de la régression actuelle en Turquie et dans les pays musulmans, où les femmes ont beaucoup à perdre, elle a donné la parole à Shirin, Mona et Peri, « la pécheresse, la croyante et la déboussolée », sans chercher à faire passer une morale ou un message. Cette façon originale d’aborder la question de Dieu m’a plu, Elif Shafak la reliant aux « aspirations d’une jeunesse en quête de vérité et de liberté. »
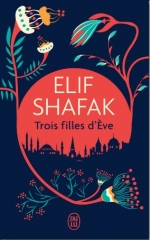 « A chaque intervention, Peri se renfonçait un peu plus dans son siège, rapetissant à vue d’œil. Elle aurait aimé disparaître complètement. Il lui semblait de plus en plus évident que le professeur Azur avait sélectionné les étudiants moins selon les mérites de leur bilan académique qu’en fonction de leurs histoires et ambitions personnelles. Il n’y avait pas deux étudiants venus d’horizons similaires, et les divergences entre eux étaient si manifestes qu’elles pouvaient facilement tourner à la bagarre. Peut-être était-ce cela que cherchait Azur : un conflit – ou quantité de conflits. Peut-être qu’il expérimentait sur les étudiants sans que ceux-ci en aient conscience, comme s’ils étaient une portée de souris qui s’agitaient et grattaient fébrilement entre les murs de son laboratoire mental. Si c’était le cas, que voulait-il donc tester – une nouvelle idée de Dieu ? »
« A chaque intervention, Peri se renfonçait un peu plus dans son siège, rapetissant à vue d’œil. Elle aurait aimé disparaître complètement. Il lui semblait de plus en plus évident que le professeur Azur avait sélectionné les étudiants moins selon les mérites de leur bilan académique qu’en fonction de leurs histoires et ambitions personnelles. Il n’y avait pas deux étudiants venus d’horizons similaires, et les divergences entre eux étaient si manifestes qu’elles pouvaient facilement tourner à la bagarre. Peut-être était-ce cela que cherchait Azur : un conflit – ou quantité de conflits. Peut-être qu’il expérimentait sur les étudiants sans que ceux-ci en aient conscience, comme s’ils étaient une portée de souris qui s’agitaient et grattaient fébrilement entre les murs de son laboratoire mental. Si c’était le cas, que voulait-il donc tester – une nouvelle idée de Dieu ? »