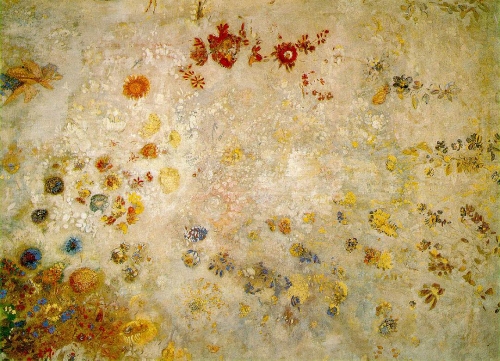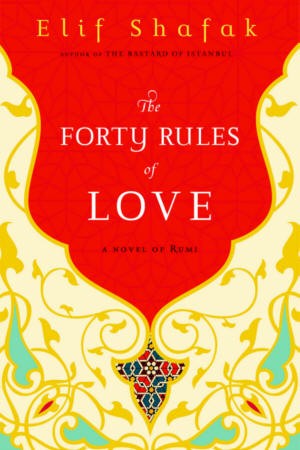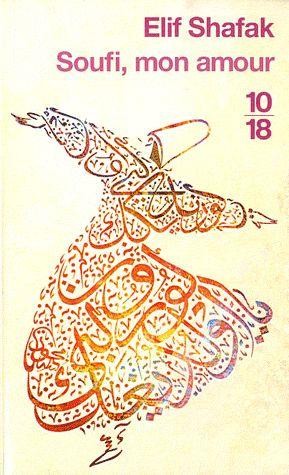Le nom d’Abdennour Bidar m’était inconnu avant qu’un ami me prête Self islam (2006, 2016 pour la postface), sous-titré « Histoire d’un islam personnel ». Ce Français dont la mère s’est convertie à l’islam avant sa naissance (en 1971) a grandi « entre les vignes et la mosquée » dans la région de Clermont-Ferrand. Il aimait comme un père son grand-père athée et communiste, que la chute du mur de Berlin avait perturbé et qui aimait parler de Dieu avec son petit-fils, un de ces êtres qu’on aime « pour la liberté qu’ils vous laissent d’être ce que vous êtes. »
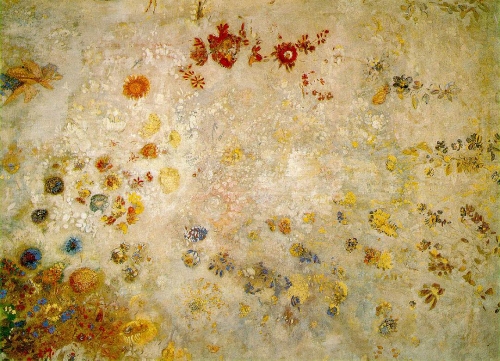
Odilon Redon
L’auteur appartient à la génération Mitterand. L’islam, il l’a d’abord nourri dans son cœur uniquement, puis à la mosquée où il ne comprenait rien, mais trouvait « paix, force, présence ». Ce « musulman auvergnat » qui ne porte l’islam ni sur son visage, ni sur ses vêtements, ni dans son mode de vie, a très tôt voulu détruire le mur entre deux mondes. Abdennour et Pierre sont ses deux prénoms. « Abdennour », qui signifie « serviteur de la Lumière », étonne les autres qui ne lui voient rien d’arabe (et il ne connaît pas l’arabe) ; ce prénom inattendu qu’il doit constamment justifier est bien le sien, en recherche de lumière intérieure. Le second le rattache au Christ. Il a des amis des deux côtés.
Sa mère, médecin, pratique un islam discret, mystique. Son père marocain, au contraire, appartient au « tabligh », un mouvement piétiste d’origine pakistanaise, très conservateur et « ostentatoire », toujours à prier et à prêcher, une sorte de fanatisme « pacifique et joyeux ». C’est sa mère qui l’a éduqué sur le plan spirituel, avec ses frère et sœurs qu’elle a élevés seule, en insistant toujours sur la quête de sens, le sens apparent et le sens caché des versets du Coran qu’elle leur enseignait.
Abdennour Bidar ne veut pas parler ici de ses parents mais de son propre cheminement entre Occident et Orient pour lesquels il rêve d’une « civilisation de la réconciliation à venir ». Il raconte son enfance modeste en banlieue, en HLM, entre pauvres et immigrés ; son éducation « à la droiture, au désintéressement, à la sollicitude envers autrui et à l’exigence envers nous-même ».
Pour lui, Allah désigne un « grand courant de vie, d’énergie, de lumière », dans une optique humaniste où les hommes sont avant tout reliés aux autres, à la nature, à la vie. La religion propose des moyens qu’il ne faut pas sacraliser selon lui, qui se situe à l’opposé d’un islam indiscutable et intouchable jouant trop souvent le jeu de la division et s’appuyant sur l’ignorance spirituelle.
Bon élève, lecteur de Jules Verne, souvent distrait parce qu’il est absorbé par ses pensées, Bidar passe souvent pour un « mauvais musulman » dans une religion « où le jugement de l’autre, apparent ou sournois, est une pratique si courante ». Le « self islam », au contraire, appelle à la responsabilité spirituelle de chacun et à une vie libre par rapport aux lois religieuses. Le mot « islam » ne signifie pas « soumission forcée » mais « obéissance choisie ». Bidar est allergique au « djihad », il veut dissocier le sacré et la violence.
Il lui a fallu du temps pour arriver à cet islam personnel. Poussé par un professeur à étudier à Paris, il prend conscience de sa vocation : « montrer qu’il y a de la lumière dans la caverne de l’existence ». Sa vie d’interne au lycée Henri IV a été une période « extrêmement difficile ». De bon élève, il devient « moyen » et surtout, il se sent différent : « Ils avaient lu l’Occident, j’avais médité l’Orient ». Aussi vit-il son islam clandestinement, comme exilé dans son propre pays. La rencontre en terminale de sa future femme, Laurence, va le soutenir. Attentive à ce qu’il vit et croit, elle finira par se convertir. Leurs trois fils seront élevés dans cette optique spirituelle, sans contraintes autres que le questionnement : qui suis-je ? que puis-je faire pour les autres ? comment se préparer à mourir ?
A vingt ans, il ressent de la tristesse et de la colère contre le matérialisme occidental. Ecœuré, épuisé par le travail scolaire, il est pris dans le conflit entre philosophie et religion – philosophie le jour, soufisme le soir. Enfermé dans cette opposition, il décide de ne pas suivre les cours à l’Ecole Normale Supérieure malgré son admission. Il travaille en solitaire, s’inscrit à la Sorbonne pour une licence et une maîtrise de philosophie, un DEA de culture et civilisation islamiques. Pendant sept ans, sa femme et lui ont adhéré à la « tariqa », une « éminente confrérie soufie du Maroc » qui appelle au respect des obligations religieuses et aux méditations fréquentes – une expérience libératrice, dans un premier temps.
Puis c’est la descente aux enfers : achat collectif d’une propriété, réunions, dérive sectaire, fanatisme et hystérie. La lutte continuelle contre l’ego, un djihad moral condamnant les fréquentations extérieures au mouvement et le questionnement finissent par l’isoler de tous, lui qui s’y refuse. Le voilà grandement déçu par rapport au soufisme en Europe qui, presque partout, cultive une fausse image d’ouverture et de paix. Trop personnel dans ses réflexions, il est rappelé à l’ordre, puis c’est la rupture, le vide autour d’eux, quelques amis exceptés. Sa femme et lui se font alors muter en Corrèze, ils achètent une maison près des bois et y trouvent l’apaisement. Sauvé par son sens critique, le philosophe entre en dépression, ressent un « vide absolu » durant deux, trois ans – à 26 ans, il le vit comme un échec personnel.
La troisième partie de Self islam raconte sa renaissance et son engagement. Abdennour Bidar se dit l’enfant de deux mondes agonisants où il observe la perte du sacré : celui « de la personne humaine » en Occident et celui de la « Grande Vie d’Allah » en Orient. Sa conception d’un islam personnel se fait jour, il l’explique. A partir de l’an 2000, il s’implique dans le débat sur l’islam en Occident, contre la menace et la terreur islamistes, contre l’hypocrisie d’un Tariq Ramadan dont il dénonce le double langage, usant des moyens démocratiques pour diffuser un islam antidémocratique, traditionnel, au nom du multiculturalisme.
Abdennour Bidar a écrit Lettre d’un musulman européen dans la revue Esprit, plus récemment Un islam pour notre temps : il veut promouvoir un nouvel islam, qu’il voit déjà en marche dans de nombreux pays. Chargé de cours à l’Université des sciences humaines à Nice, il considère l’Europe comme un terrain propice pour cette transformation. Il a fondé le cercle Al Mamoun, avec des intellectuels, des hommes et des femmes de bonne volonté, pour un « observatoire de l’évolution de l’islam ». Sur son site, où il résume son parcours, il se présente comme un « méditant engagé ».
« Nous n’avons pas besoin de chefs ni d’imams, mais de penseurs. » Bidar s’appuie sur de nombreuses lectures, celles des grands penseurs de l’islam comme Ibn Arabi, celle de Blaise Pascal aussi. Il dénonce la propagande religieuse dans les librairies remplies de codes de conduite, à travers les vidéos et les cassettes, téléguidée du Moyen Orient. Self islam est un témoignage et un appel à la responsabilité spirituelle, au progrès spirituel, et non au laisser-aller, à un islam self-service ou à la carte, comme le lui reprochent ses détracteurs. Aux catégories traditionnelles comme l’obligatoire, le licite et l’illicite, des concepts du passé, il oppose la nécessité d’une liberté totale. « Le texte propose, l’homme dispose. »
Cet essai offre en deux cents pages un point de vue original, « non conforme » comme le nom de la collection où il a paru en 2006, avant de sortir en format de poche (Points essais) l’an dernier. Une postface d’une vingtaine de pages y fait le point, dix ans plus tard. L’auteur a reçu beaucoup de courrier et de témoignages de lecteurs qui, quelle que soit leur croyance ou leur opinion philosophique, ont été sensibles à la « spiritualité libre » à laquelle il invite. En 2015, il a créé avec la psychologue Inès Weber l’association Sésame, « une maison des cultures spirituelles » à Paris, qui offre des ressources en ligne, des textes et musiques de diverses traditions culturelles.
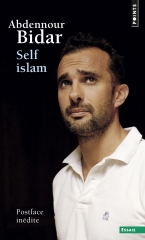 « Quelle est la valeur la plus partagée ? C’est précisément le désir de voir sa différence reconnue par autrui. L’aspiration et le droit à la différence. Chaque individu, chaque culture veut aujourd’hui avant tout avoir un droit d’expression, d’épanouissement, de développement égal à celui de tous les autres. Si l’humanité est « une », c’est donc à présent par son « vœu de diversité », son vœu de « multiplicité ». Ce qui nous rassemble, ce n’est donc plus ce qui nous unit – une même religion, une même langue, etc. –, mais la volonté de voir reconnu et protégé ce qui nous distingue. Ce désir d’une reconnaissance de notre différence fait que nous nous rassemblons tous à présent sur ce point : l’humain en nous-mêmes veut exprimer ce qu’il est individuellement, montrer aux autres ce qu’il porte en lui d’unique, et se faire accepter et aimer précisément pour cette singularité. On ne veut jamais être aimé que pour sa différence. Que l’autre nous trouve unique, irremplaçable. Si nous méditions plus là-dessus, nos différences nous rapprocheraient au lieu de nous diviser. »
« Quelle est la valeur la plus partagée ? C’est précisément le désir de voir sa différence reconnue par autrui. L’aspiration et le droit à la différence. Chaque individu, chaque culture veut aujourd’hui avant tout avoir un droit d’expression, d’épanouissement, de développement égal à celui de tous les autres. Si l’humanité est « une », c’est donc à présent par son « vœu de diversité », son vœu de « multiplicité ». Ce qui nous rassemble, ce n’est donc plus ce qui nous unit – une même religion, une même langue, etc. –, mais la volonté de voir reconnu et protégé ce qui nous distingue. Ce désir d’une reconnaissance de notre différence fait que nous nous rassemblons tous à présent sur ce point : l’humain en nous-mêmes veut exprimer ce qu’il est individuellement, montrer aux autres ce qu’il porte en lui d’unique, et se faire accepter et aimer précisément pour cette singularité. On ne veut jamais être aimé que pour sa différence. Que l’autre nous trouve unique, irremplaçable. Si nous méditions plus là-dessus, nos différences nous rapprocheraient au lieu de nous diviser. »