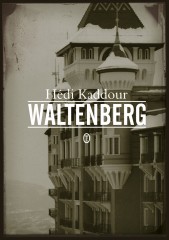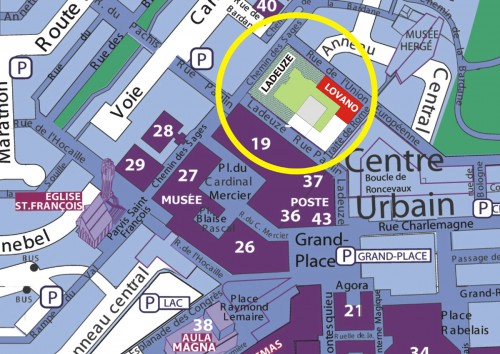Femmes seules avec enfants, c’est une catégorie à part entière dans les études socio-économiques aujourd’hui, particulièrement vulnérable en ces temps de crise. Dans Week-end de chasse à la mère, Geneviève Brisac, dont j’avais aimé l’essai sur Virginia Woolf, aborde cette situation sous un autre angle : un portrait de mère avec enfant, à deux pour passer Noël – passer et non fêter, je souligne.
Avant Noël, Eugenio, le fils de Nouk, ne cesse de poser des questions à sa mère. Il ne supporte pas l’ennui, il a la langue bien pendue. Quand sa mère l’emmène à l’école, le matin, et lui dit chaque fois « Regarde cette maison, c’est la plus belle de Paris », Eugenio répond : « Tu dis toujours la même chose : regarde, écoute, regarde, écoute. Laisse mes yeux et laisse mes oreilles. « Depuis deux ans, depuis le divorce, Nouk partage une pièce et demie avec son fils, qu’elle aime regarder s’endormir, le soir, même si on lui dit de ne pas le faire. « Il n’y a que les mères mortes, me surprends-je à songer parfois, celles-là ne font plus de mal, elles sont les plus douces et les plus parfaites. »
Ensemble, ils vont acheter un couple de canaris chez Papageno, c’est le cadeau choisi par Eugenio. Faire prendre l’air chaque jour à son fils, même quand il neige, c’est « une des rares certitudes maternelles » de Nouk. Parfois, elle le laisse seul pour un rendez-vous au restaurant avec son amie Martha, hostile à ce climat trop fusionnel, et qui ne digère pas la décision qu’a prise Nouk, peintre reconnue, d’abandonner définitivement ses pinceaux. Elle s’est trouvé un homme, elle, depuis trois semaines, et incite Nouk à faire de même – « elle ne se blesse pas comme moi à la moindre épine » songe celle-ci en écoutant les confidences trop intimes de Martha, mêlées aux conversations d’une table voisine, expositions à voir absolument, article de Télérama, télévision. « Nous ne sommes qu’un petit tas d’habitudes, pour la plupart mortelles », pensait Nouk au moment où Martha pose la question redoutée : « Qu’as-tu prévu pour Noël ? » Elle arrive à persuader son amie de venir la rejoindre en Bretagne, dans la maison de famille où elle n’a plus mis les pieds depuis quinze ans.
Le lendemain matin, il y a dehors « ce silence des dimanches matin et des jours fériés, cette épaisseur douce de l'air de Paris, opaque de silence. » Quand un fleuriste sonne, un bouquet de fleurs à la main, la porte de l’appartement s’ouvre sur une femme et un enfant en pleurs : un des canaris est mort dans la cage, la femelle qu’ils avaient baptisée « Eve ». Pas une femelle, observe Anton le fleuriste (sa mère aimait Tchekhov), mais un petit mâle, qu’il propose à Eugenio d’enterrer dans son jardin. Nouk est d’accord, ils en profiteront pour acheter un sapin. « Adam » ira rejoindre les oiseaux de la volière au bas de la cage d’escalier. Pour réjouir l’enfant, le surprendre, sa mère l’emmène pour la première fois à l’Aquaboulevard : Eugenio s’enthousiasme, se trouve un copain ; Nouk est vite écœurée par la foule et les odeurs – « Nous sommes trop nombreux sur la terre, mais à certains moments, c’est saisissant. »
Nouk cède plus souvent qu’il ne faut à la mélancolie, on l’a compris, et pourtant un rien l’émerveille, elle déborde de créativité pour distraire son fils. Son travail de fonctionnaire à la Bibliothèque de recherche sur la pédagogie et l’enfant lui convient, elle y est chargée de lire et de recenser les nouveautés, comme La Fête et la Faute, « un livre érudit et malheureusement dépourvu de l’humour que contient son titre ». Quand Martha lui téléphone au bureau pour lui rappeler sa promesse, elle n’a aucun mal à obtenir un congé, ses collègues sont pleines de sollicitude.
Nouk et Eugenio se dépêchent, changent leurs billets de train pour voyager en première, pour la douceur des « petites lampes orange » qui plaisent tant à Eugenio, exultent en s’y installant – « Les voyages sont contenus dans la seconde du départ. » Mais chez Martha, « militante de la protection des adultes menacés par la civilisation de l’enfant-roi », ils occuperont la chambre la plus sombre, derniers arrivés des quinze convives de Noël (la mère de Martha, ses soeurs et leurs filles, l’ami Etienne). Une bonne ou une mauvaise idée ?
Les pages touchantes du duo mère et fils, la poésie des choses ordinaires, les affrontements complices, la satire parfois féroce des mœurs contemporaines, tout cela ne suffit pas à masquer la tristesse qui pèse sur Week-end de chasse à la mère (prix Femina 1996). Geneviève Brisac l’exprime avec des mots simples et de jolies formules. Dans un Petit texte sur l’art de la nouvelle qu’on peut lire sur son site, elle parle de l’écriture, de ses difficultés, de la dépression, et du « devoir exigeant qui est le nôtre d’être simplement ce que nous sommes, ce qui est si difficile. » On termine l’histoire de Nouk et d’Eugenio sur le même soupir qu’aux lendemains de fêtes où l’on n’avait pas le cœur à ça. On songe à toutes les mères qui, comme Nouk, sans jamais se sentir à la hauteur, font de leur mieux, jour après jour.