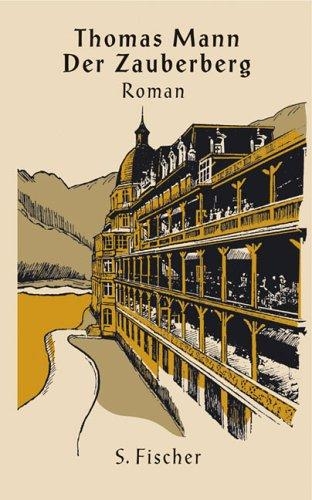Pourquoi attendre d’avoir refermé un livre pour en parler ? Je le fais d’habitude, mais cette fois, après qu’un roman décevant m’était tombé des mains, j’ai ouvert le premier tome de La Montagne magique de Thomas Mann (Der Zauberger, 1924, traduit de l’allemand par Maurice Betz), une relecture trop souvent remise à plus tard. Dès les premières pages, une voix intérieure me chuchotait : attention, chef-d’œuvre.
« Un simple jeune homme se rendait au plein de l’été, de Hambourg, sa ville natale, à Davos-Platz, dans les Grisons. Il allait en visite pour trois semaines. » Le premier chapitre relate le voyage de Hans Castorp d’Allemagne en Suisse et son arrivée à Davos : deux jours l’ont éloigné de son quotidien « infiniment plus qu’il n’a pu l’imaginer ». « L’espace qui, tournant et fuyant, s’interpose entre lui et son lieu d’origine, développe des forces que l’on croit d’ordinaire réservées à la durée. D’heure en heure, l’espace détermine des transformations intérieures, très semblables à celles que provoque la durée, mais qui, en quelque manière, les surpassent. »
Avant son stage pratique sur un chantier de constructions, Hans découvre pour la première fois l’univers alpestre. A la gare du village, son cousin Joachim Ziemssen le presse de descendre : une voiture va les emmener au sanatorium international Berghof. Hans le complimente sur sa mine, Joachim le ramène à la réalité. Le soleil a bruni sa peau, oui, mais le médecin pense prolonger sa cure de « six bons petits mois ». Au Berghof, on se fait une tout autre idée du temps, trois mois passent comme un jour, « on change de conceptions ». Cette analyse du temps et de la manière dont on le perçoit sera un des leitmotivs du roman.
En échangeant leurs impressions sur le paysage, sur la qualité de l’air à seize cents mètres d’altitude, Joachim répète « nous autres, ici, en haut », comme s’il s’agissait d’un monde à part. Hans est content de découvrir sa chambre « gaie et paisible » au numéro 34, à côté de celle de son cousin. Une Américaine y est morte deux jours avant, mais tout a été désinfecté par « des fumigations ». Hans écoute distraitement, s’étonne du froid des radiateurs – pas de chauffage en été, il s’habituera. Au restaurant, pendant un excellent dîner, Joachim lui parle des habitudes et des gens, puis le présente au médecin en second, le Dr Krokovski, qui ironise sur la « santé parfaite » du jeune ingénieur de la marine. La première nuit de Hans sera peuplée de rêves étonnants.
Le chapitre II revient sur son passé : ayant perdu sa mère puis son père avant ses sept ans, Hans Castorp a vécu d’abord chez son grand-père, un sénateur qu’il aimait et admirait, qui lui a transmis ses valeurs avant de mourir d’une pneumonie, comme son fils. Puis chez son tuteur et oncle, le consul Tienappel, qui gère le patrimoine de Hans et lui conseille des études et un bon travail s’il veut continuer à mener sa vie agréable de jeune bourgeois – linge marqué, tailleur, confort.
Le trouvant fatigué après son examen d’ingénieur, le médecin lui a conseillé des vacances en haute montagne ; aussi le consul lui a suggéré de passer trois semaines avec son cousin qui s’ennuie au sanatorium depuis cinq mois. En découvrant l’établissement, Hans est curieux de ce mode de vie tout nouveau pour lui et suit à peu près l’horaire de son cousin – sur le conseil du médecin-chef Behrens qui trouve que le visiteur ferait un meilleur malade que lui.
La sieste obligatoire sur la galerie n’est pas pour lui déplaire, Hans trouve la chaise-longue extraordinairement confortable. Bizarrement, ses cigares préférés n’ont plus ici leur bon goût habituel. Les jeunes gens qu’il croise ont l’air joyeux, exubérant, il les trouve très libres dans leurs manières et leur tenue. En promenade, Joachim et lui rencontrent « un étranger, un monsieur gracieux et brun », Settembrini. Ses vêtements manquent d’élégance, mais Hans est aussitôt charmé par sa façon de s’exprimer, pleine d’esprit et d’allusions. Il remarque aussi certaines femmes, comme l’attirante Mme Chauchat, qui mange à la table dite des « Russes bien » ou Maroussia, qui semble troubler son cousin.
Qu’est-ce qui enchante dès ces premiers chapitres de La montagne magique ? Nous arrivons avec le héros au Berghof, nous ressentons avec lui un changement complet d’atmosphère – le paysage et le climat des Alpes, les rites du sanatorium. Thomas Mann décrit avec art ses personnages, leurs émotions, pose ici et là un présage, un accent, une observation dont on se doute qu’ils auront une suite. Il y mêle des réflexions sur la maladie, la mort, l’existence, les autres. Avec humour le plus souvent, sans s’appesantir. Ces digressions ralentissent l’intrigue et imposent en quelque sorte au lecteur le rythme, la durée de la cure. Au sanatorium, on s’amuse aussi, on peut même y tomber amoureux. Alors que les trois semaines vont se terminer, Hans se dit qu’il y resterait bien un peu plus longtemps.