Parisa Reza a donné un beau titre à son premier roman : Les jardins de consolation. Née à Téhéran en 1965, arrivée en France à dix-sept ans, elle écrit en français. L’histoire de Talla et Sardar, un couple de paysans, puis de leur fils Bahram, se déroule entre 1920 et 1953. Parisa Reza utilise dans son récit le calendrier iranien. En 1299, à douze ans, Talla quitte son village natal, Ghamsar, sur le dos d’un âne, avec son mari qui marche à ses côtés.

Festival de la rose à Ghamsar-Kashan (Synotrip)
A Ghamsar, « le bout du paradis, tombé du ciel », pousse la rose de Perse, dont quelques familles extraient « la plus odorante essence de rose ». « Ce n’est pas sans raison que le paradis est né dans le désert. Aucun être entouré de verdure n’aurait imaginé le paradis. Lorsque les gens de la région disent que Ghamsar est un paradis, ils reconnaissent en lui un improbable objet de désir : un jardin de fleurs et de fruits. »
Les femmes ne sortent pas du village. Talla travaille dans le verger, cueille les roses, s’occupe des poules, trait les brebis et fait le beurre, le fromage et le yaourt. A vingt ans, Sardar vend ses terres, il veut quitter Ghamsar, souvent la proie de pillards, et vivre ailleurs. Talla, neuf ans, travailleuse, sera une bonne épouse. Pour une fille, c’est l’âge de se marier. Le père de Talla lui accorde sa main, mais prudent, décide que le mariage ne sera célébré et consommé qu’au retour de Sardar.
Si elle souhaite devenir une femme, Talla est encore une enfant qui s’épanouit en plein air, aux champs, dans le verger. Dans cette famille nombreuse, elle a pris en charge sa sœur cadette, Havva, qu’elle emmène partout avec elle. Mais la petite est fragile, mouille encore sa couche à quatre ans ; le père, exaspéré, la bat et cause un jour sa mort, horriblement. Sardar revient, trois ans plus tard, heureux de voir à Talla une silhouette de femme. A son bonjour, elle répond par une gifle « retentissante ». Il lui explique qu’il lui a fallu ce temps pour sortir de la misère. Talla ne veut pas divorcer, elle veut partir, rapidement.
Elle a peur de franchir les montagnes. Ils traverseront le désert pour arriver à Kashan, puis ils iront vers le nord, deux cent cinquante kilomètres à parcourir pour atteindre la capitale. Au village, les femmes ne portent le tchador blanc ou coloré que pour la prière, sinon elles se contentent d’un foulard noué derrière la tête. Sardar lui a rapporté de Téhéran un tchador noir et un « roubandeh » (voile) blanc comme en portent les habitantes de Téhéran, Talla accepte de les porter pour entrer dans son nouveau monde, elle s’y sent à l’abri.
Installés d’abord dans un faubourg de Téhéran (une simple pièce dans la cour du maître), ils subissent un ordre social inconnu à Ghamsar où ne régnait aucun khan, où chacun possédait sa maison et ses terres. Ici le paysan craint le maître. La vie paisible y est à peine troublée par le coup d’Etat de Reza Khan. L’été, la transhumance les emmène vers le nord, à Shemiran. Talla aime ces collines qui lui rappellent son pays natal.
Enceinte une première fois à treize ans, elle perd une petite fille à six mois de grossesse. A quinze ans, elle accouche d’un fils, qui ne vivra pas longtemps. Elle se croit maudite. Sardar ne lui reproche rien, mais les gens la critiquent. Quand Reza Khan devient Reza Shah (roi d’Iran) et annonce de grands changements pour le pays, ils vont s’installer à Shemiran, où Talla retrouve « vigueur et espoir ». On y vit sans peur.
Enfin naît le fils tant attendu, sept ans après le précédent : Bahram (« un prince vaillant et grand chasseur de fauves ») Amir (le nom de son père). Sardar, berger analphabète, possède à présent un nom de famille, une carte d’identité, le droit de vote, grâce à la révolution constitutionnelle. Les gens doivent s’habiller à l’européenne, le tchador est interdit. Sardar croit en Dieu et son Prophète, mais il ne va pas à la mosquée. Talla, indifférente aux nouveaux droits des femmes, heureuse d’être mère, se contente d’être maîtresse chez elle.
Deux ans après la naissance de Bahram, ses parents deviennent enfin propriétaires d’une maison et d’une bergerie entourées d’un grand jardin, à Gholhak. Sardar a réalisé son rêve. Même si Talla est d’humeur changeante, le couple tient bon. Insensiblement, Bahram devient le héros du récit : il est beau, intelligent, volontaire. Ses succès scolaires ravissent son père.
D’une vie à l’autre, Les jardins de consolation racontent l’histoire d’une famille, le destin d’un garçon doué – peut-être trop aimé par sa mère pour aimer vraiment une autre femme un jour –, et l’évolution d’un pays. Des jardins de Ghamsar aux jardins de Shemiran, Parisa Reza décrit la vie du foyer et celle au dehors. C’est tout un pan de l’histoire iranienne qu’elle nous fait traverser, entre rêves amoureux et péripéties politiques. Un très beau premier roman, prix Senghor 2015, qui donne envie de lire le suivant, Le parfum de l’innocence.
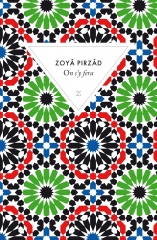 « Sur le guéridon, au centre du hall, était posé un grand vase en cristal rempli d’arums blancs. Arezou ouvrit une porte sur la droite, pénétra dans le corridor qui menait aux chambres, passa devant trois portes closes : la pièce de la télévision, sa chambre de jeune fille, le bureau de son père. Quand ils avaient fait construire cette maison, son père avait dit : « Un bureau ? Mais, madame, pourquoi faire ? Moi, je travaille à l’agence. » Mah-Monir, qui feuilletait un magazine, avait relevé la tête en regardant fixement son mari : « Toutes les maisons nobles ont un bureau ! Nous aussi, nous en aurons un. » Son père avait éclaté de rire : « Alors, nous voilà nobles ! Eh bien ! Va pour un bureau ! » Mah-Monir avait jeté sa revue de décoration sur la table : « Toi, tu es devenu noble, moi, je le suis de naissance. »
« Sur le guéridon, au centre du hall, était posé un grand vase en cristal rempli d’arums blancs. Arezou ouvrit une porte sur la droite, pénétra dans le corridor qui menait aux chambres, passa devant trois portes closes : la pièce de la télévision, sa chambre de jeune fille, le bureau de son père. Quand ils avaient fait construire cette maison, son père avait dit : « Un bureau ? Mais, madame, pourquoi faire ? Moi, je travaille à l’agence. » Mah-Monir, qui feuilletait un magazine, avait relevé la tête en regardant fixement son mari : « Toutes les maisons nobles ont un bureau ! Nous aussi, nous en aurons un. » Son père avait éclaté de rire : « Alors, nous voilà nobles ! Eh bien ! Va pour un bureau ! » Mah-Monir avait jeté sa revue de décoration sur la table : « Toi, tu es devenu noble, moi, je le suis de naissance. »


