Dans C’est moi qui éteins les lumières de Zoyâ Pirzâd (traduit du persan (Iran) par Christophe Balaÿ), ce « moi », c’est Clarisse, que ses enfants trouvent au retour de l’école, comme d’habitude, dans sa cuisine. Les jumelles ramènent avec elles Emilie, la fille des nouveaux voisins qui ont emménagé dans l’appartement qu’occupait Nina, l’amie de Clarisse.

"Notre menu à nous était un riz avec du ragoût de gombos."
Photo et recette : http://augredumarche.blogspot.be/ (merci)
Armen, leur grand frère de quinze ans, observe à distance. Les fillettes veulent montrer à Emilie la poupée Raiponce aux mains blanches comme les siennes. Le goûter commence à peine qu’on sonne : une toute petite dame, trois rangs de perles autour du cou, réclame sa petite-fille. A peine les présentations faites, Elmira Simonian se fâche sur Emilie et l’emmène, sous le regard médusé des enfants.
Artush, le mari de Clarisse, l’écoute à peine quand il lit le journal le soir, mais il réagit au nom des nouveaux venus. Emile Simonian, le père de la petite, a été muté récemment dans son entreprise. Clarisse observe celui qu’elle a épousé dix-sept ans plus tôt, il a pris vingt kilos, il a beaucoup changé. Puis ils vont se coucher et c’est Clarisse qui éteint les lumières.
Le lendemain, sa mère lui raconte tout ce qu’elle sait des Simonian, elle a des idées très arrêtées sur les Arméniens de Jolfa, sur ceux de Tabriz, et se fait du souci pour son autre fille, Alice, qui « ne va pas bien ». Elle est partie s’acheter des chocolats quand la nouvelle voisine vient frapper à la porte : pour s’excuser de son attitude de la veille, elle a apporté un gâteau, et complimente Clarisse pour sa cuisine « originale » (fleurs séchées, pots de faïence, guirlandes de piments rouges et tresses d’ail) et ses belles manières – elle a fait glisser le gâteau sur un plat avant de lui servir du thé. Après avoir parlé de sa vie à Paris, à Londres, à Calcutta, elle invite toute la famille pour dîner, ils feront ainsi connaissance avec son fils Emile.
Artush déteste ce genre de « mondanités » mais s’incline. Emilie leur ouvre la porte en jolie robe blanche, sa grand-mère porte une longue robe de soie noire et d’imposants bijoux. Et voilà Emile Simonian qui fait le baise-main à Clarisse, à sa grande surprise. Etonnante aussi, la soudaine politesse d’Armen qui serre la main d’Emilie. Les jumelles observent avec de grands yeux – « Comme au cinéma », dit l’une. Clarisse remarque une belle armoire indienne dans l’appartement pauvrement meublé. « Lorsque l’on décrit une maison, on montre le caractère de son personnage » a déclaré la romancière dans un entretien au Courrier international.
De cette soirée plutôt guindée, Artush retiendra surtout le sort peu enviable d’Emile, accaparé par sa mère qui répond à sa place, ne cesse de lui donner des ordres et se plaint de devoir tout faire elle-même, alors qu’en Inde elle avait des domestiques.
« Abadan (la ville natale de l’auteure) ne connaît pas de printemps, mais la chaleur et l’humidité », commente Armen en écoutant la radio du matin annoncer du temps printanier à Téhéran. Clarisse apprécie l’esprit de son aîné, qui change beaucoup ces derniers temps. Une fois tout le monde parti, elle ferme la porte à clé, savoure ce moment de solitude avant l’arrivée de sa sœur et de sa mère : elle a le temps de réfléchir, de se souvenir (de son père surtout), tout en vaquant à ses tâches ménagères. Alice est bientôt là, avec un carton de pâtisseries, elle veut tout savoir des voisins, du fils ingénieur en particulier. Alice cherche un célibataire à épouser.
C’est moi qui éteins les lumières décrit la vie quotidienne de cette famille arménienne en Iran : sorties, fréquentations, courses, repas, école, activités des enfants… Artush a trouvé en Emile un bon partenaire aux échecs, mais le juge un peu à part, dans « un monde de légendes et de poésie ». Or Emile et Clarisse sont souvent sur la même longueur d’onde, ils aiment la lecture, les fleurs, les petits plats raffinés – elle est une excellente cuisinière. Quand ils ont l’occasion de parler ensemble, Clarisse en est toute retournée, elle avait perdu l’habitude de tant d’attention et de délicatesse à son égard.
Zoyâ Pirzäd raconte des riens avec finesse, comme dans Un jour avant Pâques, et peu à peu, toute une société prend vie sous nos yeux avec ses coutumes, ses rites, ses préoccupations. Les femmes y sont souvent au foyer, à part la secrétaire d’Artush, qui donne des conférences pour sensibiliser les femmes à leur nouveau droit de vote. « Immense succès en Iran », « romancière adulée de ses lecteurs », peut-on lire sur la quatrième de couverture. Simple et profonde, la Clarisse de C’est moi qui éteins les lumières nous reste en tête bien après qu’on a fermé ce roman « tchekhovien ».
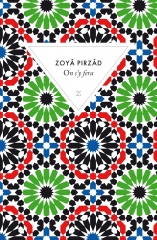 « Sur le guéridon, au centre du hall, était posé un grand vase en cristal rempli d’arums blancs. Arezou ouvrit une porte sur la droite, pénétra dans le corridor qui menait aux chambres, passa devant trois portes closes : la pièce de la télévision, sa chambre de jeune fille, le bureau de son père. Quand ils avaient fait construire cette maison, son père avait dit : « Un bureau ? Mais, madame, pourquoi faire ? Moi, je travaille à l’agence. » Mah-Monir, qui feuilletait un magazine, avait relevé la tête en regardant fixement son mari : « Toutes les maisons nobles ont un bureau ! Nous aussi, nous en aurons un. » Son père avait éclaté de rire : « Alors, nous voilà nobles ! Eh bien ! Va pour un bureau ! » Mah-Monir avait jeté sa revue de décoration sur la table : « Toi, tu es devenu noble, moi, je le suis de naissance. »
« Sur le guéridon, au centre du hall, était posé un grand vase en cristal rempli d’arums blancs. Arezou ouvrit une porte sur la droite, pénétra dans le corridor qui menait aux chambres, passa devant trois portes closes : la pièce de la télévision, sa chambre de jeune fille, le bureau de son père. Quand ils avaient fait construire cette maison, son père avait dit : « Un bureau ? Mais, madame, pourquoi faire ? Moi, je travaille à l’agence. » Mah-Monir, qui feuilletait un magazine, avait relevé la tête en regardant fixement son mari : « Toutes les maisons nobles ont un bureau ! Nous aussi, nous en aurons un. » Son père avait éclaté de rire : « Alors, nous voilà nobles ! Eh bien ! Va pour un bureau ! » Mah-Monir avait jeté sa revue de décoration sur la table : « Toi, tu es devenu noble, moi, je le suis de naissance. »


