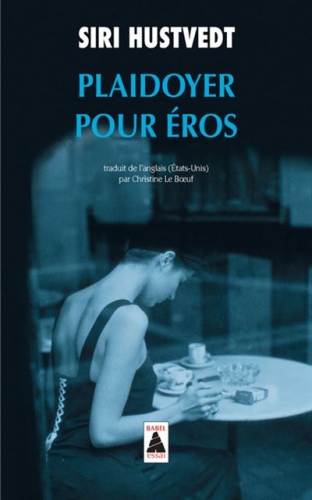Poursuivons la lecture de la correspondance de Tchekhov dans la collection Bouquins. De Melikhovo, en mars 1892, Anton Tchekhov décrit dans une lettre la propriété qu’il vient d’acheter, enthousiaste malgré les punaises et cafards découverts dans la maison et l’endettement. Dans une autre, à propos d’une école primaire aux mains du clergé, il se souvient de la sinistre formation religieuse que ses frères et lui ont reçue (« de religion, je n’en ai plus maintenant ») et s’interroge sur les enfants qui y étudient : « Leurs âmes sont pour moi un mystère. Si elles sont emplies de joie, alors ils sont plus heureux que mes frères et moi pour qui l’enfance a été une souffrance. » (Lettre du 9/3/1892)

Anton Tchekhov lisant sa pièce La Mouette pour la compagnie du Théâtre d'art de Moscou, 1898.
À sa droite, Stanislavski, assis, et à côté de lui, Olga Knipper (de profil).
(Tous les noms figurent au bas de la photo de Petr Pavlov (1860-1925) sur Wikimedia)
Vivre de mes rêves comporte de nombreuses lettres à Lika (Lydia Mizinova), une « blonde plantureuse » réputée pour sa beauté, une amie de sa sœur. Dans leur correspondance, Tchekhov badine volontiers, par exemple quand, en juillet 1892, il l’invite malgré l’épidémie de choléra qui a gagné Moscou et les environs : « Je sais tellement bien soigner le choléra que vivre à Melikhovo est parfaitement sans danger. » Il aime la compagnie des femmes, s’ennuie sans elles, où qu’il soit. Lydia se laissera séduire par un ami de Tchekhov.
Ne plus vivre en ville lui permet d’avoir des chiens : à l’arrivée de deux teckels sur le domaine, Tchekhov les baptise « Brome » et « Quinine ». A Souvorine, il rapporte que le peintre Levitan, son hôte, emmené à la chasse, a tiré une bécasse sans la tuer et sans avoir le courage de l’achever, s’était tourné vers lui : « Il fallut obéir à Levitan et la tuer. Il y eut ainsi sur terre une belle créature de moins, tandis que les deux nigauds rentraient à la maison et s’attablaient pour le dîner. » On retrouvera cette scène dans La Mouette. Souvorine reste longtemps son interlocuteur idéal, le seul « avec qui converser longuement » et avec qui il se sent « libre » (1893).
A cause de sa toux, Anton Tchekhov se rend à Yalta au printemps en mars 1894, mais il s’y ennuie, malgré les visites ; il trouve les gens « assommants, saumâtres, blafards ». Dans ses lettres de 1892 à 1904, déjà présentées à la lecture d’une ancienne édition, il parle plus souvent de Tolstoï et explique un jour pourquoi « la morale de Tolstoï » a cessé de le toucher : « Dans mes veines coule du sang de moujik et l’on ne m’épatera pas avec les vertus des moujiks. Dès l’enfance, j’ai cru au progrès. Je ne pouvais pas ne pas y croire, puisque la différence entre l’époque où l’on me fouettait et celle où on cessa de le faire était considérable. » (27/3/1894)
Conseils aux jeunes écrivains des deux sexes, vie quotidienne, temps qui passe, ennuis de santé (le chat qu’il pose sur son ventre comme compresse contre la diarrhée !), il y a de tout dans sa correspondance. Après sa première visite à Tolstoï à Iasnaïa Poliana en 1895, il confie à Souvorine la « merveilleuse impression » ressentie. (Tolstoï écrit de son côté à son fils que Tchekhov lui a plu : « Il est très doué et semble avoir un cœur bon. Par contre, il n’a jusqu’à présent pas de point de vue à lui. » (note en bas de page) La Mouette, écrite cette année-là, sera jouée l’année suivante – un four à la première, un grand succès ensuite, ce qui aura de quoi rassurer celui qui se sent « un piètre dramaturge ».
En mars 1897, en plein dîner avec Souvorine à Moscou, « un véritable flot de sang » est sorti de la gorge de Tchekhov et il est hospitalisé. A sa sœur, il écrit de n’en rien dire à ses parents. Tolstoï vient le voir à la clinique. A Souvorine, il donne le diagnostic, « tuberculose pulmonaire » ; les médecins lui ont prescrit « un changement de vie ». Il va cesser sa pratique médicale au village. En automne, il entreprend un voyage à l’étranger : Paris, Biarritz, puis Nice, où il loge à la pension russe. Le beau temps lui fait du bien. A Lydia, en octobre, il écrit qu’il est « dans la joie de vivre » ; « j’aurai du moins passé les trente premières années de ma vie, comme on dit, selon mon bon plaisir. »
C’est là qu’il prend connaissance de l’affaire Dreyfus et s’enthousiasme pour Zola – « une âme noble ». « La France est un pays merveilleux. Elle a de merveilleux écrivains. » Cette affaire va l’éloigner de Souvorine, dont Temps nouveau (journal de Saint-Pétersbourg dont Souvorine est propriétaire) se montre « simplement répugnant » sur le sujet. Il lui écrit une longue lettre de désaccord.
Rentré à Melikhovo en mai, il lui faut se remettre à écrire, gagner de l’argent, pour lui et pour les écoles qu’il aide à construire. Mais il doit repartir avant l’hiver, ce sera à Yalta où il loue une petite datcha, deux pièces et un grand jardin. Avant cela, il avait pu assister à une répétition théâtrale et y avait trouvé une actrice « grandiose » dans son rôle : c’est la première allusion à Olga Knipper, sa future femme. En Crimée, écrit-il, les rivages sont beaux, « seulement le malheur, c’est cette absence totale de culture. »
Et pourtant, le voilà bientôt dans de nouveaux rêves immobiliers qu’il expose à sa sœur : l’achat d’une propriété « à trente verstes » de Yalta, pour toute la famille. Quasi toutes ses lettres à Macha abordent surtout des questions pratiques, financières, familiales. En octobre, il apprend à Yalta la mort de son père en son absence. Il pressent que sans celui-ci, la vie à Melikhovo ne sera plus la même. Raison de plus pour devenir propriétaire à Yalta.
Au nouvel an 1899, il projette de vendre tous ses récits à l’éditeur Marx. Il estime sa santé « honorable », mène « une vie de vieux célibataire, qui n’est ni celle d’un bien portant, ni celle d’un malade, mais une vie couci-couça. » Il tombera d’accord avec Marx qui lui donnera quinze mille roubles pour ses récits publiés et à venir. Mais le revenu des pièces revient à Tchekhov, et après lui, appartiendra à ses héritiers.
A partir du 16 juin 1899, la correspondance avec Olga Knipper, qu'il a fini par fréquenter, est lancée : des lettres très enjouées, et toujours avec de joyeux souhaits pour terminer : « Portez-vous bien, soyez gaie, heureuse, travaillez, sautez, ayez des amourettes, chantez et, si possible, n’oubliez pas l’écrivain en disponibilité, votre admirateur empressé A. Tchekhov. » Il suit de près le travail du Théâtre d’Art de Moscou, « les plus belles pages qu’on écrira jamais du livre sur le théâtre russe contemporain. » Il pense déjà à un nouveau sujet : Les trois sœurs. Il achète encore « un petit bout de rivage à Gourzouf » (petite crique, vue splendide, rochers, baignade et pêche privés).
Le mariage d’Anton et d’Olga, en mai 1901, ne changera pas grand-chose à leur rythme de vie, lui en cure, elle en tournée théâtrale. On se souvient de son rêve ancien d’« une femme qui, comme la lune, n’apparaisse pas chaque jour dans [son] ciel ». Mais Olga Knipper-Tchekhova tombe très malade en avril 1902 et ce n’est qu’en juin que Tchekhov sera rassuré sur son état, « sévère, mais pas critique », elle finira par se remettre sur pied. Ils passeront ensemble un été idyllique à Lioubimovka, dans une propriété de Stanislavski, metteur en scène et ami. Il leur reste deux ans avant la mort de Tchekhov en juillet 1904.