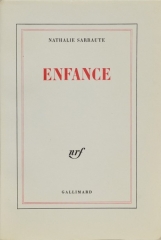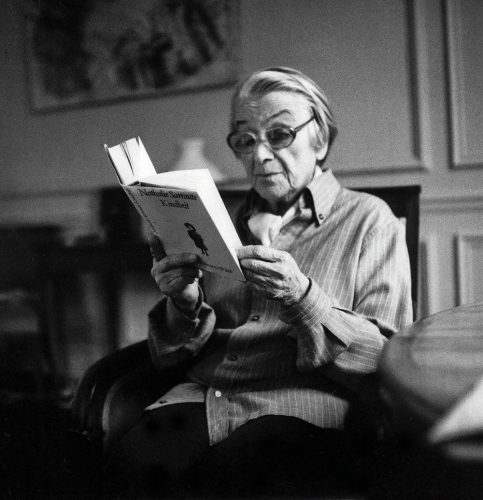Chevreuse attendait, parmi les derniers emprunts à la bibliothèque, et après La femme au carnet rouge où Modiano se promène, son dernier roman s’est imposé dans le prolongement. Il suffit d’une phrase, comme la première – « Bosmans s’était souvenu qu’un mot, Chevreuse, revenait dans la conversation » – pour franchir le seuil et se sentir chez Modiano. Des noms, le passage du temps qu’implique le souvenir, comme une conversation rappelle une rencontre.
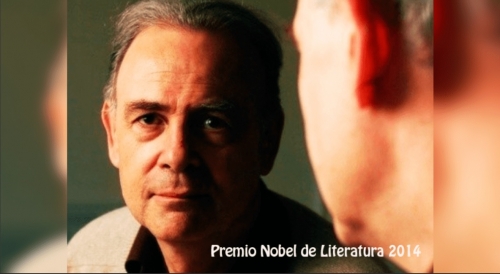
Source : La República
A l’époque de « cet automne-là », environ cinquante ans plus tôt, Bosmans fréquentait un petit restaurant vietnamien en compagnie de Camille. Des détails lui reviennent, une chanson de Serge Latour, le nom d’Auteuil, des « éclats de souvenirs qu’il tâchait de noter le plus vite possible », des images de son passé qui échappent à l’oubli. Et surtout, Chevreuse. « Ce nom attirerait peut-être à lui d’autres noms, comme un aimant. »
« A la sortie de Chevreuse, un tournant, puis une route étroite, bordée d’arbres. Après quelques kilomètres, l’entrée d’un village et bientôt vous longiez une voie ferrée. Mais il ne passait que très peu de trains. » Il est passé dans cette région à diverses périodes de sa vie. Les distances, Bosmans s’en rend compte, diffèrent dans ses souvenirs et sur une vieille carte d’état-major où il a retrouvé la rue du Docteur-Kurzenne, celle d’une maison qu’il connaît. Une rue « marquant la lisière d’un domaine, ou plutôt d’une principauté de forêts, d’étangs, de bois, de parcs, nommée : Chevreuse. »
Il se rappelle plusieurs trajets, l’un d’eux en voiture, au départ d’un appartement « aux alentours de la porte d’Auteuil », où se réunissaient des gens en fin de journée « et souvent dans la nuit ». Un homme y habitait, avec son petit garçon et une jeune gouvernante ; il l’avait reconnu quinze ans après, dans un restaurant des Champs-Elysées, sans se souvenir de son nom.
C’est Camille qui l’avait entraîné un soir dans l’appartement d’Auteuil où elle lui avait parlé d’un « réseau » et présenté une amie, Martine Hayward. A eux trois, ils avaient fait un aller-retour en voiture dans la vallée de Chevreuse, jusqu’à une ancienne auberge où elle avait pris une valise avant de revenir à Paris. En route, Bosmans avait reconnu des noms, des bâtiments, un jardin public : « Il eut envie de leur confier qu’il avait vécu par ici, mais cela ne les regardait pas. » Les deux femmes s’étaient encore arrêtées pour visiter la maison familière de la rue du Docteur-Kurzenne avec une dame de l’agence immobilière – lui n’y était pas entré et n’en avait rien dit.
« Jusque-là, sa mémoire concernant ces personnes avait traversé une longue période d’hibernation, mais voilà, c’était fini, les fantômes ne craignaient pas de réapparaître au grand jour. » Pourquoi ce silence, ces mystères ? « Et ne pouvant revivre le passé pour le corriger, le meilleur moyen de les rendre définitivement inoffensifs et de les tenir à distance, ce serait de les métamorphoser en personnages de roman. »
Jean Bosmans mène l’enquête : les personnes, les lieux, l’appartement en particulier – « si différent le jour et la nuit, au point d’appartenir à deux mondes parallèles ». Les noms de personnes réveillent des silhouettes observées, écoutées, croisées. Certaines d’entre elles sont amicales, d’autres semblent un peu trop attentives à ses paroles, à ses réactions et puis il y en a sur qui il se renseigne sans avoir envie de les rencontrer, comme s’il craignait un règlement de comptes.
« L’Art de se taire. Depuis son enfance, il avait toujours essayé de pratiquer cet art-là, un art très difficile, celui qu’il admirait le plus et qui pouvait s’appliquer à tous les domaines, même à celui de la littérature. » Aussi apprécie-t-il ce que disent les objets : une photo, un agenda, du papier à lettres à en-tête, une boussole…
On aimerait parfois que le romancier nous indique le nord de son histoire, mais ce n’est pas son genre. Parmi les souvenirs d’une vie vécue ou rêvée, lui-même hésite parfois, il préfère nous entraîner avec lui dans le labyrinthe de la mémoire, tout en semant des cailloux au passage. Chevreuse, « une vie recomposée », écrit Fabrice Gabriel dans Le Monde. Un roman finement analysé par Norbert Czarny, qui le relie à d’autres œuvres de Patrick Modiano – à lire plutôt après lecture.