« Dans l’âme de chacun d’entre nous, il y a un merle chanteur. La vie consiste à s’en approcher. »
Metin Arditi, Prince d’orchestre
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
« Dans l’âme de chacun d’entre nous, il y a un merle chanteur. La vie consiste à s’en approcher. »
Metin Arditi, Prince d’orchestre
Prince d’orchestre, au lieu de chef d’orchestre, on verra pourquoi Metin Arditi a choisi ce titre pour son roman consacré à la musique et à la direction d’orchestre. Son héros, le bel Alexis Kandilis, va de triomphe en triomphe. Quelles que soient les situations, tout rentre dans l’ordre sous sa baguette et se termine par une ovation, dans les plus grandes villes du monde.

L'Orchestre de la Suisse romande au Victoria Hall de Genève
Au printemps 1997, l’émotion du chef n’est plus la même qu’à ses débuts, il a appris à feindre. « Et comment aurait-il pu en être autrement ? Mêmes grandes salles. Mêmes solistes. Grand répertoire repris, répété, resservi. » Il joue donc aussi l’émotion, bien qu’il n’en puisse plus : « il y avait la gloire, l’argent, la facilité extrême. Alors il poursuivait. » Les chants des enfants morts de Mahler qui l’avaient bouleversé à vingt ans, le troublent encore, malgré lui.
Saluant sur la scène du Victoria Hall, il reconnaît, tout près de ses proches, le visage de Lenny, un ancien élève de l’Institut Alderson (décor de Loin des bras) où sa mère l’avait mis en pension « sans crier gare, l’année de ses onze ans », et s’imagine aussitôt sa femme, Charlotte, cette « crétine », invitant Lenny à les accompagner au restaurant et lui parlant de la biographie en cours de préparation – « Il ne fallait pas qu’il parle. »
Clio, sa mère, si fière de le voir au sommet depuis vingt ans, a admiré une fois de plus son frac, son élégance, sa beauté, mais elle a vu ce petit mouvement du pied qui signale une angoisse, elle s’interroge. Bien sûr, il aurait voulu être compositeur, il était doué pour cela, mais elle s’était opposée à ce métier difficile, mal payé, solitaire : « Alexis était fragile. Il avait besoin de gaieté. De lumière. » Contrarié, il pouvait basculer dans la colère. Quand il le voulait, « il pouvait charmer un cobra ! »
Peu à peu, Metin Arditi présente l’entourage du maestro, les inimitiés, les tensions. « Lenny ne dirait rien. Alexis en était certain. Entre internes, personne n’avait jamais trahi. » L’atmosphère est donc agréable à table, seul le fils d’Alexis garde le silence. L’arrivée d’un célèbre homme d’affaires, Jeffrey Paternoster, attire l’attention : « un charme de vieux riche », observe Alexis, avant de reconnaître le jeune homme qui l’accompagne, Sacha, « le flûtiste russe de l’orchestre ».
Un autre projet excite fort Alexis : le « B16 », seize pièces de Beethoven à jouer avec l’Orchestre philharmonique de Berlin, un coffret de dix cédés dont il serait la vedette. Il n’est pas encore sûr d’être choisi, mais se juge bien meilleur que son rival, un chef russe qui en fait des tonnes. Ce serait une consécration.
En attendant, il propose à Sacha, le flûtiste, de l’accompagner dans sa limousine entre Lausanne et Genève. Curieux de sa relation avec Jeffrey Paternoster, il découvre que leur intimité est aussi liée au poker : Sacha ne joue pas, mais l’homme d’affaires, son amant, beaucoup et très gros. Ni routine ni usure, le poker est un jeu d’émotions violentes. Alexis y a joué à l’internat et quand le Cercle des Trente lui ouvre la porte de ses luxueuses parties, il ne résiste pas à l’invitation.
Prince d’orchestre fait partager les obsessions, les succès et les angoisses du chef d’orchestre. Sa brillante carrière est un défi permanent. Sa femme et sa mère doivent composer avec ses sautes d’humeur, son égocentrisme, ses peurs. Peu à peu des blessures d’enfance reviennent à la surface. Un chef doit tout contrôler, y compris soi-même, et surtout dans ses rapports avec l’orchestre : diriger, certes, mais sans blesser. Un faux pas lui coûterait très cher, les critiques ne passent rien à ceux qui se prétendent les meilleurs.
Metin Arditi raconte comment celui qui se croyait à l’abri de tout va souffrir de se voir remis en question, jusqu’à mettre sa carrière en péril. Alexis Kandilis pourra-t-il se reprendre, voire se frayer une voie nouvelle ? Ecoutera-t-il les conseils d’hommes sages qui croisent son chemin ? Des femmes aimantes lui ouvrent les bras, mais leur amour ne lui suffit jamais.
Prince d’orchestre (un bon conseil de Plumes d’Anges) est un roman haletant sur la musique, l’orgueil, le jeu, la solitude, la création. Metin Arditi, très actif dans le milieu musical genevois, emmène ses lecteurs vers les sommets de la réussite et dans les gouffres des failles secrètes. Peintre de la maîtrise, comme dans Le Turquetto, et connaisseur de l’âme, comme dans L’enfant qui mesurait le monde, le romancier s’interroge ici sur la violence destructrice de quelqu’un qui a tout et prend le risque de tout perdre.
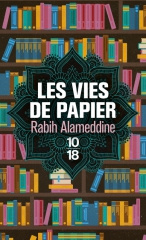
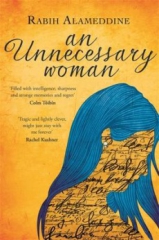 « Dans un de ses essais, Marías suggère que son œuvre traite autant de ce qui ne s’est pas passé que de ce qui s’est passé. En d’autres termes, la plupart d’entre nous pensons que nous sommes ce que nous sommes en raison des décisions que nous avons prises, en raison des événements qui nous ont façonnés, des choix de ceux de notre entourage. Nous considérons rarement que nous sommes aussi façonnés par les décisions que nous n’avons pas prises, par les événements qui auraient pu avoir lieu mais n’ont pas eu lieu, ou par les choix que nous n’avons pas faits, d’ailleurs. »
« Dans un de ses essais, Marías suggère que son œuvre traite autant de ce qui ne s’est pas passé que de ce qui s’est passé. En d’autres termes, la plupart d’entre nous pensons que nous sommes ce que nous sommes en raison des décisions que nous avons prises, en raison des événements qui nous ont façonnés, des choix de ceux de notre entourage. Nous considérons rarement que nous sommes aussi façonnés par les décisions que nous n’avons pas prises, par les événements qui auraient pu avoir lieu mais n’ont pas eu lieu, ou par les choix que nous n’avons pas faits, d’ailleurs. »
Rabih Alameddine, Les vies de papier
Entrer dans Les vies de papier de Rabih Alameddine (2013, traduit de l’anglais par Nicolas Richard, 2016), c’est découvrir d’abord, sous une couverture illustrée de rayonnages et de piles de livres, un titre original qui pose l’accent autrement : An Unnecessary Woman. (Ci-dessous, quelques variantes en couverture.) Alameddine, peintre et romancier, partage sa vie entre San Francisco et Beyrouth – la ville où vit et écrit son héroïne, cette femme inutile ou superflue : Aaliya, une traductrice.
La première des citations mises en épigraphe est de Pessoa, un de ses auteurs de prédilection : « Et que je suis de la dimension de ce que je vois / Et non de la dimension de ma propre taille ». Le souci présent d’Aaliya, 72 ans, deux verres de vin aidant, c’est d’avoir mis trop de produit pour donner un peu d’éclat à ses cheveux – les voilà bleus ! A la fin de l’année, tandis qu’elle relit la traduction qu’elle vient d’achever, elle pense à Hannah, sa « seule intime », qui lui offrait « ce cadeau si rare : son attention pleine et totale ».
Cela fait cinquante ans qu’Aaliya entame une nouvelle traduction le premier janvier ; elle a traduit 37 livres en cinquante ans : « Des livres dans des cartons – des cartons remplis de papier, des feuilles volantes de traduction. C’est ma vie. » La littérature est son « bac à sable ». Son problème, c’est le monde à l’extérieur. « La littérature m’apporte la vie, et la vie me tue. » Elle vit seule, par choix.
Tombée amoureuse de l’arabe à quatorze ans, « la plus difficile des langues » selon son professeur, elle a appris à l’école coranique d’abord à écouter les mots, leur magie : « Ecoutez le rythme, écoutez la poésie. » Son père l’a « nommée Aaliya, l’élevée, celle au-dessus. » Il est mort avant ses deux ans, laissant sa mère de 18 ans veuve ; ensuite elle a épousé le frère de son mari, d’où cinq demi-frères et sœurs dont aucun n’est proche de la fille aînée.
Aaliya se sent dans cette famille un membre superflu, un « inutile appendice ». Mariée à 16 ans, répudiée à 20 par un « moustique amolli à la trompe défaillante » que deux autres mariages ont laissé sans enfants, elle est restée dans l’appartement des années cinquante qu’ils louaient à un propriétaire beyrouthin – un homme généreux jusqu’au départ de son mari, mais interdisant à sa fille Fadia d’avoir le moindre contact avec elle, une fois divorcée. « Mon foyer, mon appartement ; j’y vis, je m’y déplace, j’y ai mon existence. »
En 1982, pendant le siège de Beyrouth par les Israéliens, beaucoup de ses habitants ont fui sauf ceux qui, comme elle, n’avaient nulle part où aller. Aaliya dormait avec une kalachnikov à côté d’elle, qu’elle a dû brandir un jour contre trois soldats, mais c’est Fadia qui les mis en fuite dans l’escalier en tirant dans un sac de sable. Ce fut la fin du harcèlement familial pour qu’elle cède son appartement au frère aîné.
Aaliya se raconte peu à peu, mêlant à tout ce qu’elle observe ou ressent des citations, des vers, des anecdotes littéraires – la compagnie des écrivains est ce qui lui réussit le mieux, d’autant plus qu’elle dort mal, « le don sacré » du sommeil est ce qui lui manque le plus. Les digressions sont nombreuses. A Javier Marías, dont elle adore l’œuvre, elle reprend une façon de définir la vie qu’elle trouve très juste : ce qui ne s’est pas passé nous façonne autant que ce qui s’est passé.
C’est malgré lui, grâce à sa belle-soeur Hannah dont le libraire était parent, que celui-ci l’a engagée et qu’elle est devenue pour tous « le visage » de sa librairie – deux autres candidates plus jolies qu’elle ne s’y étant pas présentées. Quand il est mort, quatre ans plus tôt, elle a hérité, de la librairie aussitôt fermée et vendue, du grand bureau en chêne verni foncé qui a fait « sa grandeur » et sur lequel elle travaille.
Dans le récit de cette femme solitaire et farouchement attachée à sa solitude apparaissent bien sûr, constamment présents, les auteurs aimés, lus et traduits, des compositeurs qu’elle a appris à écouter, et aussi certains visiteurs de la librairie, des parents souvent inopportuns – ce sera terrible quand on voudra lui imposer la garde de sa mère, qu’elle refuse, ce dont elle se sent coupable même si celle-ci n’a jamais eu d’égards pour elle – et « les trois sorcières », trois femmes dont elle perçoit les allées et venues dans l’immeuble.
Fadia, qui a hérité de l’immeuble, reste distante, mais lui laisse régulièrement un bon plat préparé devant sa porte. Elle s’est souciée de sa survie chaque fois que la guerre a privé les Beyrouthins d’électricité, de vivres dans les magasins. Elle est venue à son secours quand le frère aîné la tourmentait. Elle fréquente quotidiennement Joumana et Marie-Thérèse, ses voisines du dessus et du dessous.
Beyrouth, leur ville, tient son rôle dans Les vies de papier, Prix Femina étranger 2016, avec ses rues bruyantes et ses coins calmes, le musée national, ses commerçants et ses mendiants. Passionnée des mots, Aaliya pratique une méthode bien à elle : excluant les écrivains français et anglais dont beaucoup de Libanais connaissent la langue, elle traduit en arabe non à partir de l’original, mais de la traduction française et de la traduction anglaise. « Mes traductions ne sont pas du champagne et elles ne sont pas non plus du thé au lait. – De l’arak, peut-être. »
Pessoa encore : « La seule attitude digne d’un homme supérieur, c’est de persister tenacement dans une activité qu’il sait inutile, respecter une discipline qu’il sait stérile et s’en tenir à des normes de pensée philosophique et métaphysique, dont l’importance lui apparaît totalement nulle. » (Le livre de l’Intranquillité) C'est ainsi pour Aaliya : « Je suis où il faut que je sois. »
J’ai beaucoup aimé me mettre à l’écoute de cette femme peu commune, « délirante » et lucide, vieillissante et volontaire, partager ses lectures et ses souvenirs. Je ne vous dirai rien de la fin sinon que je l’ai trouvée très belle. Une « épiphanie ».
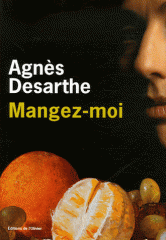 « Comment se fait-il que l’on ait plusieurs vies ? Peut-être ai-je tendance à généraliser. Peut-être suis-je la seule à éprouver ce sentiment. Je ne mourrai qu’une fois et pourtant, au cours du temps qui m’aura été imparti, j’aurai vécu une série d’existences contiguës et distinctes.
« Comment se fait-il que l’on ait plusieurs vies ? Peut-être ai-je tendance à généraliser. Peut-être suis-je la seule à éprouver ce sentiment. Je ne mourrai qu’une fois et pourtant, au cours du temps qui m’aura été imparti, j’aurai vécu une série d’existences contiguës et distinctes.
Je n’étais pas la même personne à trente ans. J’étais un être tout à fait particulier à huit ans. Je considère mon adolescence comme autonome en regard de la suite. La femme que je suis aujourd’hui est déracinée, détachée, incompréhensiblement solitaire. Je fus très entourée. Je fus très sociable. Je fus timide. Je fus réservée. Je fus raisonnable. Je fus folle. »
Agnès Desarthe, Mangez-moi