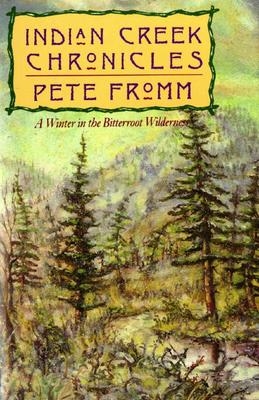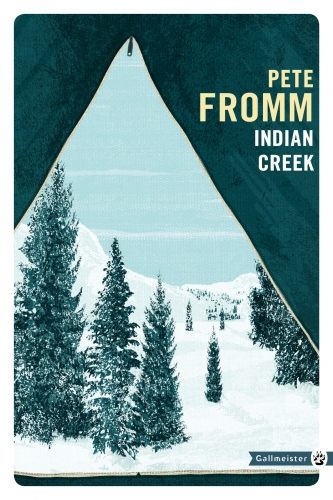La femme gauchère de Peter Handke (1976, traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt en 1978) n’a rien perdu de son impact dans son étrange simplicité. A relire cette brève histoire d’une femme et d’un homme qui se séparent, je me rends compte que je l’ai mal résumée dans un billet récent : ce n’est pas elle qui s’en va, c’est à son mari qu’elle demande de partir, sans explication, restant seule avec son fils à la maison.

Bruno Ganz (Bruno) et Edith Clever (Marianne) dans La femme gauchère, film de Peter Handke
« Elle avait trente ans et habitait un lotissement de bungalows bâti en terrasse sur le versant sud d’une montagne moyenne, juste au-dessus de la brume d’une grande ville. Elle avait les cheveux bruns et des yeux gris qui parfois, même quand elle ne regardait personne, rayonnaient sans que l’expression de son visage se modifiât. »
A la fin d’une journée d’hiver, elle va chercher son mari à l’aéroport. Bruno, chef commercial pour une grande firme de porcelaine, rentre d’un long voyage d’affaires en Scandinavie. Après avoir bu un verre et embrassé leur garçon en pyjama, il propose d’aller faire « un repas de fête » à l’extérieur et ensuite de passer la nuit à l’hôtel. C’est le lendemain matin qu’elle lui fait part d’une « sorte d’illumination » qui lui est venue : qu’il s’en allait, qu’il la laissait seule. « Pour toujours ? » – « Je ne sais pas, seulement, tu t’en vas et tu me laisses seule. »
La femme lui suggère d’aller chez Franziska, la maîtresse d’école de leur fils Stéphane, une amie, qui vient justement de se retrouver seule. Quand elles se revoient, l’amie a déjà reçu un appel de Bruno, à qui elle a dit : « Enfin ta Marianne s’est réveillée. » Elles se retrouvent au café après la classe. Franziska interroge Marianne sur ses intentions : « De quoi allez-vous vivre tous les deux ? » Celle-ci voudrait recommencer à faire des traductions. Si Franziska n’a que « mépris pour la solitude », la décision de son amie pourtant l’enthousiasme.
Sans trop discuter, Bruno vient chercher ses affaires qu’elle a déjà mises dans des valises. La vie de Marianne reprend son cours, seule avec son garçon. Quand elle va poster son offre de services à son ancien éditeur, Bruno la surprend près de la boîte aux lettres : « Est-ce que ce jeu-là va continuer tout le temps, Marianne ? Moi en tout cas, je n’ai plus envie de jouer. » Avant de repartir, il lui laisse un peu d’argent. Marianne a besoin de « réfléchir en paix sur soi-même », quoi qu’on pense d’elle.
Elle change la disposition des meubles, se débarrasse de vieux papiers et livres, nettoie tout avec soin. Le soir, elle met une nappe blanche pour le repas avec son fils, elle l’interroge sur sa journée à l’école. Quand l’éditeur vient lui rendre visite, content de la retrouver, il lui dit : « Maintenant commence le long temps de votre solitude, Marianne ! » Elle répond : « Depuis peu tout le monde me menace. »
C’est l’histoire de cette solitude, l’histoire d’une femme qui se met à vivre seule avec son fils que raconte La femme gauchère. Peter Handke en a fait le scénario du film qu’il réalise en 1978 (avec Edith Clever et Bruno Ganz). Si on s’interroge sur la rupture de Nora à la fin de la pièce d’Ibsen, Maison de poupée, on en devine davantage les motivations que dans ce roman-ci, où les personnages sont décrits de l’extérieur. Brigitte Desbrière-Nicolas propose une analyse intéressante du roman et du film dans la revue Germanica.
Le titre s’inspire d’une chanson de Jimmy Reed, The lefthanded Woman, dont Handke cite les paroles dans son récit – un disque que Marianne aime écouter. Sa nouvelle situation change imperceptiblement la résonance des choses, le ton des rencontres avec les autres, dont Bruno parfois. L’histoire se termine alors qu’elle se brosse les cheveux devant un miroir et qu’elle se dit : « Tu ne t’es pas trahie. Et plus personne ne t’humiliera jamais. »