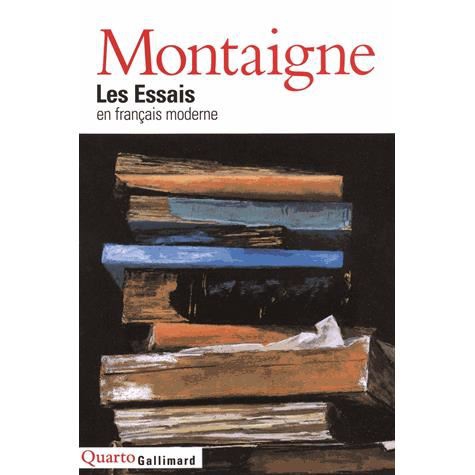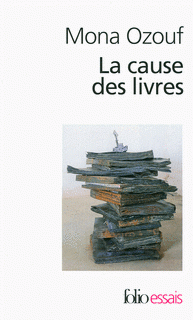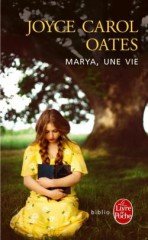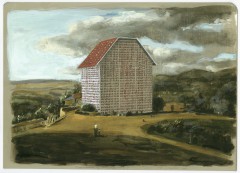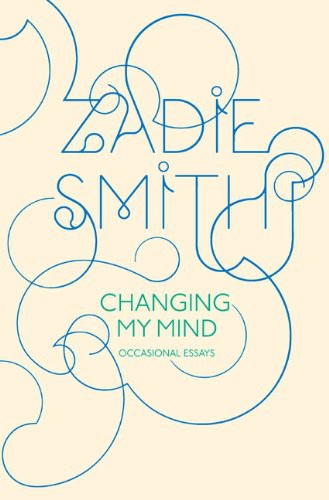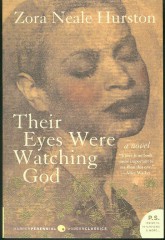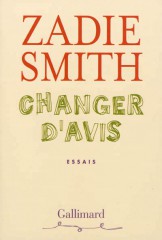Un seul livre à la fois, c’est mon habitude, du moins pour la fiction. Cela n’empêche pas de garder sous la main un essai, un recueil de poèmes, à lire entre deux romans. Depuis quelques semaines, Les Essais de Montaigne « en français moderne » (Quarto) font ainsi mon bonheur de lectrice par intermittence (merci, Dominique).
Réflexions, anecdotes, lecture des anciens, peu à peu se révèle un auteur épris d’équilibre, de modération, de sagesse. Tout vient à point au philosophe, les choses de l’esprit et celles du corps, les mœurs étrangères et les usages locaux, le passé et le présent. La liberté individuelle est sa grande affaire, avec l’empathie : « Je ne partage point cette erreur commune de juger d’un autre d’après ce que je suis. »
J’ai lu et relu « Sur la solitude » (Livre I, chapitre XXXIX), qui commence par une mise en garde : « Laissons de côté la longue comparaison de la vie solitaire et de la vie active, et, quant à la belle déclaration sous laquelle se cache l’ambition et la cupidité [et qui dit] que nous ne sommes pas nés pour notre intérêt particulier, mais pour le bien public, rapportons-en-nous hardiment à ceux qui sont dans la danse : qu’ils se battent alors la conscience [et qu’ils lui demandent] si, au contraire, les situations sociales, les charges publiques et cet affairement dans le monde, on ne les recherche pas plutôt pour tirer de la chose publique son profit particulier. »
Montaigne estime qu’on peut jouir de « la vraie solitude » au milieu des villes et même des cours royales, mais qu’« on en jouit plus commodément quand on est à part ». Aussi conseille-t-il de faire en sorte « que notre bonheur dépende de nous » en se débarrassant des liens qui nous attachent aux autres, afin de pouvoir « vraiment vivre seuls et vivre de cette façon à notre aise ».
« Il faut avoir des femmes, des enfants, des biens et surtout de la santé, si l’on peut ; mais il ne faut pas s’y attacher de manière telle que notre bonheur en dépende. Il faut se réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute libre, dans laquelle nous établissons notre vraie liberté et notre principale retraite dans la solitude. » – « La plus grande chose du monde, c’est de savoir être à soi. »
Cela semble de la misanthropie, ce choix radical de la vie solitaire, qui correspond, écrit-il, aux tempéraments comme le sien plus qu’aux « âmes actives et occupées qui embrassent tout et s’engagent partout, qui se passionnent pour toutes choses, qui s’offrent, qui se proposent et qui se donnent en toutes occasions. » Montaigne admet volontiers que c’est une question de goût : « L’occupation qu’il faut choisir pour la retraite, ce doit être une occupation qui ne soit ni pénible ni ennuyeuse ; autrement, c’est en vain que nous penserions être venus y chercher le repos. »
Ses lectures ? « Je n’aime, quant à moi, que des livres ou agréables ou faciles, qui me charment, ou ceux qui me consolent et me conseillent pour régler ma vie et ma mort. » Ses désirs ? Pas question d’y renoncer. « Il faut retenir avec nos dents et nos griffes l’usage des plaisirs de la vie que les ans nous arrachent des poings, les uns après les autres. »
En jetant un coup d’œil à La cause des livres de Mona Ozouf (en attente), une sélection d’articles écrits pour Le Nouvel Observateur pendant près de quarante ans, j’y trouve cette belle formule en préface à ce qu’elle appelle un « exercice de mélancolie » : « Il oblige à lire à rebours la phrase de la vie. » Elle en détermine la source : « une enfance qui avait reçu en partage à la fois l’ennui, la solitude et leur remède absolu, la lecture. »
Non seulement les illustrations de couverture de ces deux livres se ressemblent, mais, coïncidence, le premier article repris s’intitule « La potion du docteur Montaigne ». Je n’ai pu résister à la curiosité. Ozouf rappelle l’existence d’« un clan, janséniste, ou ascétique, ou révolutionnaire, qui hait en Montaigne tantôt la nonchalance à l’égard du salut, tantôt la tiédeur de l’engagement politique, et en tout cas le style coteaux modérés et douceur française, le goût de la commodité » – « les terroristes, de droite ou de gauche, n’aiment pas qu’on leur dise que le bonheur privé existe, inaliénable ».
« C’est vrai qu’il y a d’innombrables Montaigne, selon lecteurs et humeurs. Dans le patchwork des « Essais », on peut découper un Montaigne chrétien et un Montaigne rationaliste ; un Montaigne hédoniste et un Montaigne stoïcien. Surtout un Montaigne émancipateur et un Montaigne conservateur. » Une allusion à ses propos misogynes ?
Et quelle est cette potion, finalement ? Voici la chute signée Mona Ozouf (13/11/1982) : « Car les Essais sont à la fois ce livre qu’on lit en marchant – ainsi en usait Gide – ou qu’on lit pour apprivoiser le sommeil – ainsi en usait Flaubert. Le docteur Montaigne a inventé le calmant-stimulant, une potion miracle qui contient à la fois le café du matin et la verveine du soir. »