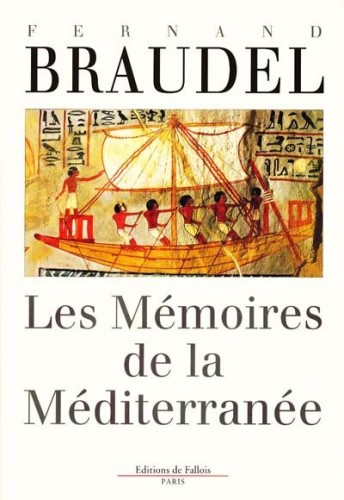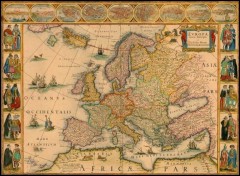C’est en Mésopotamie et en Egypte que la civilisation apparaît, au IVe millénaire, « sous ses premières formes massives », au long de fleuves qu’il a fallu discipliner. Dans le Nord de la Mésopotamie en premier lieu, voici l’araire (la charrue), la roue, l’écriture. Braudel résume avec Maurice Vieyra : « Egypte : don du Nil ; Mésopotamie : œuvre des hommes. » La victoire sur l’eau s’accompagne d’autres progrès : le tour du potier, « l’amélioration constante des espèces de céréales, des arbres fruitiers, de l’olivier, de la vigne, du palmier. »

Bateau minoen (maquette d’après une fresque de Thera (Santorin),
environ 1500 av. J.-C., conservée au Musée archéologique national d’Athènes)
L’homme chasseur devient éleveur, puis conduit la charrue, prenant aux femmes leur place aux champs, certains y voient le passage du matriarcat au patriarcat. La formule paraît trop simple, le rôle de la déesse-mère persistera encore longtemps après. Il faut sans doute attendre le travail des métaux réservé aux hommes pour faire basculer la société vers le pôle masculin, de la Terre Mère à Jupiter – « il y faudra des siècles de connivence sociale. »
Filage et tissage sont de vieilles techniques. La nouveauté, c’est « la montée brusque de la production » : le costume différencie les groupes sociaux, le pagne égyptien traditionnel n’est plus porté que par les hommes du peuple, les gens de qualité superposent pagnes et tuniques, souvent plissés. Au lin blanc succèdent « d’amples robes de lin de couleur » que les femmes portent au-dessus d’un long fourreau. On exporte des lins d’Egypte, des lainages de Mésopotamie.
Tissus, bois, métaux, Braudel suit toutes les lignes du progrès, et bien sûr, les écritures et les numérations – « les empires sont fils de l’écriture ». Du pictogramme à l’idéogramme, puis au phonogramme. De la simple numération décimale en Egypte (unité, dizaine, centaine, millier…) à la numération babylonienne héritée de Sumer, de base 60 (59 signes distincts pour écrire les 59 premiers chiffres !) jusqu’au système fractionnaire du temps d’Hammurabi. L’historien étudie le rôle des villes, l’organisation politique de l’Egypte des pharaons, les religions…
Des pages passionnantes relatent l’évolution des bateaux sur les fleuves de Mésopotamie, sur le Nil. La langue égyptienne a deux mots différents pour désigner le voyage : le bateau à voile déployée, c’est le voyage vers le sud ; le bateau à voile roulée, c’est le voyage vers le nord, à la seule force du courant. Les premières navigations marines sont difficiles à prouver, mais cette absence de preuves n’empêche pas l’historien de croire à l’ancienneté des navigations sauvages. Comment expliquer autrement l’expansion de la céramique dite cardiale (imprimée sur l’argile fraîche à l’aide d’un coquillage, le cardium) dont on retrouve des tessons un peu partout sur les côtes méditerranéennes et même en Afrique du Nord ?
Nous n’en sommes ici qu’aux cent premières pages des Mémoires de la Méditerranée. Le « grand public cultivé » à qui s’adresse Fernand Braudel est déjà ébahi tant par la somme d’informations recueillies pour offrir un tel brassage d’images et de faits à l’appui de l’interprétation que par la manière fantastique dont l’historien les décrit, les habite, les relie, tissant patiemment la toile sur laquelle il peint les étapes de la civilisation en Méditerranée.
A l’étude de l’architecture navale, du transport des mégalithes, vient se mêler la vie des îles : Malte, Sardaigne, Baléares – un bon millier de talayots, tours rondes ou carrées, à Minorque et Majorque, par exemple à Capocorp Vell, près de Lluchmayor, dont le sens culturel et historique reste à démêler. Un atlas cartographique en quinze planches, à la fin du livre, permet de situer les villes et les régions, les mouvements de l’une à l’autre, à chaque période.
L’âge du Bronze, du milieu du IIIe millénaire jusqu’au XIIe siècle environ, est une longue histoire dramatique – invasions, guerres, pillages, désastres… – mais aussi le mouvement d’ensemble d’une « civilisation qui se répand en dépit de toutes les frontières », construisant une certaine unité « des terres et des mers du Levant » par les relations commerciales, diplomatiques, culturelles.
La Mésopotamie est riche de ses routes et monnaies, l’Egypte de son or. La Crète devient « un nouvel acteur de la civilisation cosmopolite », Braudel y consacre de très belles pages qui nous font voyager dans le temps et sont autant d’invitations au voyage, notamment à la rencontre de l’art crétois. On croise dans Les mémoires de la Méditerranée bien d'autres peuples : Hittites, Sémites, Peuples de la Mer...
« Tout change du XIIe au VIIIe siècle » : des steppes asiatiques sortent des cavaliers, l’Occident cesse d’être « absolument barbare ». La deuxième partie de l’ouvrage, après les colonisations phéniciennes en Méditerranée, porteuses d’excellentes industries (teintures extraites du murex, utilisation du bitume pour l’étanchéité des navires), après l’histoire de Carthage, revient sur le mystère des Etrusques, en Toscane et au-delà. Et puis, bien sûr, la Grèce, et puis Rome, une Antiquité qui nous est davantage connue et qui occupe le dernier tiers du livre.
Deux séries de bonnes illustrations sont encartées dans l’essai de Fernand Braudel : « les images de la mer » et « les images de la religion ». On peut rêver à ce qu’aurait offert l’album projeté par Skira, tant le texte fourmille d’exemples. A la rencontre des Méditerranéens de la Préhistoire et de l’antiquité, l’historien ne peut masquer son enthousiasme ici ou là, « même si c’est un péché contre les règles sacro-saintes de l’impartialité ». C’est aussi cela, sans doute, qui rend si captivantes ces Mémoires de Méditerranée.