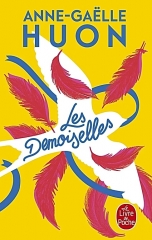La Fondation Custodia se situe au 121 rue de Lille, entre le pont de la Concorde et le musée d’Orsay. Je ne connaissais pas ce lieu, mais j’avais lu que l’exposition Jacobus Vrel, énigmatique précurseur de Vermeer valait la peine. Pas de réservation possible : quelle chance d’avoir accès sans créneau horaire à cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, qui abrite une importante collection d’art ancien, dite « Collection Frits Lugt », placée sous l’égide de la Fondation Custodia (bonne garde en latin).
« A première vue, rien ne semble relier Jacobus Vrel au célèbre Johannes Vermeer (1632-1675) hormis leurs initiales « JV ». Pourtant, nombre de leurs tableaux partagent un même calme contemplatif, le rôle central joué par les figures féminines et, bien souvent, un certain mystère. » L’Avant-propos de l’élégant livret remis aux visiteurs – toutes les œuvres exposées y ont leur légende complète et une notice analytique –, il aurait mieux valu les lire sur place. Heureusement, j’ai pris de nombreuses photos.
On ne sait pas grand-chose de ce peintre du XVIIe siècle, à part quelques indications de lieux dans l’Est des Pays-Bas, d’après ce qu’il a peint, et une datation du bois des panneaux qui aboutit aux années 1635-1640 pour les scènes de rue et vers 1650 pour ses premiers intérieurs. « On peut donc affirmer avec certitude que Vrel était un précurseur de Johannes Vermeer. » Avant Paris, l’exposition a été présentée avec succès à la Mauritshuis de La Haye.
Le parcours (à l’étage) débute avec ses « ruelles », des vues avec personnages comme ces Deux femmes conversant par une fenêtre : Théophile Thoré, le « redécouvreur » de Vermeer, lui attribuait ce tableau comme les trois autres Vrel de sa collection (le critique d’art possédait trois véritables Vermeer et le fameux Chardonneret de Fabritius). La dendrochronologie a établi que cette huile a été peinte sur un panneau provenant du même arbre que Scène de rue, femme assise sur un banc du Rijksmuseum.
La composition de Scène de rue, femme portant une corbeille (ci-dessous), dont la restauration « a ravivé la subtile palette en camaïeux de bruns caractéristique de Vrel », m’a fait chercher une toile de Balthus à laquelle j’ai pensé en la regardant. Une des rares scènes sans personnages en train de converser. Etude de deux femmes, une esquisse à l’huile, témoigne de l’attention du peintre pour le rendu des costumes.
Les scènes d’intérieur de Jacobus Vrel sont les plus fascinantes. On y voit le plus souvent une femme, de dos, seule ou avec un ou plusieurs enfants. Deux des illustrations visibles sur la page d’accueil de l’exposition montrent des scènes de lecture, mais d’autres scènes de genre sont présentées : femme préparant des crêpes, attisant le feu, fouillant dans un tiroir, tenant compagnie à un malade… Grande cheminée, carrelage, tabouret, pots, plats, corbeilles, ustensiles de cuisine, alcôve, chauffe-pied, on retrouve dans ces peintures des constantes de l’intérieur hollandais de l’époque.
La manière dont Jacobus Vrel place ses figures dans une pièce diffère, il me semble, de celle de ses contemporains présentés dans une autre salle, dont le célèbre Rembrandt et une artiste graveuse dont je n’avais jamais lu le nom, Geertruydt Roghman. Quant aux scènes de lecture, je lis dans le commentaire de Femme lisant de Claes Hals, exposée parmi d’autres scènes d’intérieur du Siècle d’or : « Faut-il y voir la représentation d’Acedia – la Paresse, souvent personnifiée par des femmes assoupies sur une chaise – ou plutôt un éloge de la lecture ? »

Jacobus Vrel, Femme saluant un enfant à la fenêtre, Huile sur bois. – 45,7 × 39,2 cm
Paris, Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, inv. 174
Mais revenons à Jacobus Vrel. Dans Femme assise regardant un enfant à la fenêtre, la peinture choisie pour l’affiche, le mouvement de la femme qui fait basculer sa chaise pour faire signe à quelqu’un attire notre attention sur la fillette de l’autre côté de la vitre, mais comme me l’a fait remarquer un visiteur enthousiaste et connaisseur, si l’on regarde bien, il y a souvent un petit personnage discrètement intégré aux scènes d’intérieur, c’est amusant à observer de plus près et très mystérieux.
Ici, la fenêtre ne donne pas sur l’extérieur mais sur une autre pièce, un agencement qui n’est pas rare dans les maisons hollandaises du XVIIe siècle. Les hautes croisées à petits carreaux ont leur appui très bas, on peut s’y accouder comme le fait cette Femme penchée à la fenêtre. Les ciseaux sur la table montrent qu’elle a interrompu son travail. Une fois de plus, « nous regardons un personnage qui ne nous voit pas », attentif à quelque chose ou à quelqu’un qui ne nous est pas montré.

Jacobus Vrel, Femme à la fenêtre, daté 1654, Huile sur bois. – 66,5 × 47,4 cm
Vienne, Kunsthistorisches Museum, inv. GG 6081 © KHM-Museumsverband
Jacobus Vrel, énigmatique précurseur de Vermeer : une exposition passionnante et, pour moi, la découverte d’un maître ancien dont les œuvres nous parlent en silence du cadre de vie de son époque.