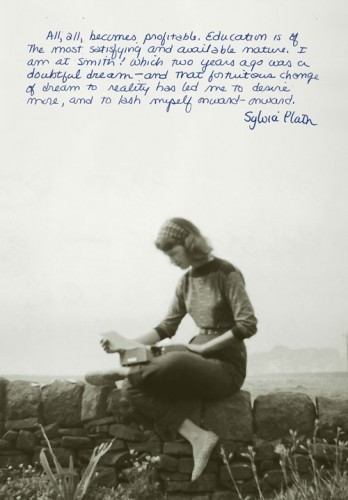« Milena à qui la vie ne cesse pourtant d’apprendre à son corps défendant qu’on ne peut jamais sauver quelqu’un que par sa présence, et par rien d’autre » : ce passage d’une lettre de Franz Kafka à Milena Jesenská (Lettres à Milena) pourrait servir d’épigraphe à Milena, une biographie signée Alena Wagnerova (2006, traduite de l’allemand par Jean Launay).
Margaret Buber-Neumann, première biographe de Milena, l’a connue au camp de Ravensbrück, où elle est décédée. Alena Wagnerova, tchèque, a pu s’appuyer sur deux autres sources importantes : le témoignage de Jana Cerna (Honza), la fille de Milena, et la documentation rassemblée par Jaroslava Vondrackova, qui travaillait avec Milena à la rédaction de la page féminine de Narodni listy (journal national tchèque) et fréquentait les mêmes cercles qu’elle.
Prague est sa ville. Dans un article, Milena Jesenská (1896-1944) se souvient du jour où, petite fille, elle a vu son père rester seul dans la rue auprès d’un blessé après que la police s’est interposée entre deux troupes de manifestants, Allemands contre Tchèques (« Sur l’art de rester debout »). Le Dr Jan Jesensky, cet homme « debout et secourable », dentiste renommé et professeur à l’université, devenu nationaliste à cause des injustices des Allemands envers les Tchèques, se montre très attentif à l’éducation de sa fille et très exigeant. Sa mère, dont la dot assure d’abord l’aisance financière de la famille, transmet à Milena « un sens très aigu des matières, des couleurs et des formes, et l’amour de la littérature, surtout russe ».
Milena supporte mal l’autorité de son père, progressiste dans son travail, mais « patriarche conservateur » à la maison. « Têtue et rebelle », elle est consciente de faire partie d’une élite au lycée Minerva, premier lycée de filles en Autriche-Hongrie, s’y montre « réservée et chaleureuse ». Douée pour écrire, elle correspond à l’encre violette avec son professeur préféré, tandis que sa mère s’éteint, atteinte d’une maladie incurable. Milena, dix-sept ans, en est marquée, sans perdre son goût et sa volonté de vivre, et en gardera une attitude le plus souvent compatissante à l’égard des autres.
Avec ses amies, la jeune fille veut tout expérimenter, se joue des convenances, puise sans compter dans l’argent de son père pour réaliser les souhaits des uns et des autres, jusqu’à s’endetter. Elle est connue pour ses frasques – sans doute pour attirer l’attention de son père et aussi exprimer sa révolte contre lui – et sa réputation en pâtit. Son père l’inscrit en médecine, ce n’est pas pour elle. Après deux semestres, elle se tourne vers la musique, mais manque de motivation pour les études.
« L’élément où elle se sent véritablement chez elle, ce sont les rues et les cafés, où se font les échanges humains par le dialogue et la discussion. » Au café Arco, par exemple, fréquenté par les intellectuels juifs. Elle y rencontre Ernst Polak, traducteur, de dix ans son aîné. Son grand amour. Pour lui, la littérature et les idées passent avant tout. Jesensky tentera en vain de mettre fin à cette relation : ils se marient et s’installent à Vienne.
A Prague, Milena était quelqu’un, à Vienne elle est « la femme de … » Polak lui fait comprendre très vite qu’il ne va pas changer pour elle sa façon de vivre. A nouveau, c’est dans les rues qu’elle se ressource : « la Vienne des petites gens, cochers, coursiers, bonnes… » L’effondrement de l’Autriche en octobre 1918 et la naissance de la République tchèque l’exaltent, bien que la vie quotidienne en soit compliquée. Le couple manque d’argent. Milena donne des leçons de tchèque, traduit, porte les bagages à la gare, sert comme dame de compagnie, rédige des articles…
Milena écrit à Kafka qu’elle voudrait traduire sa prose en tchèque. C’est le début de leur fameuse correspondance, la « joie secrète » de Milena. Après trois mois d’échanges, ils se rencontrent, Kafka rompt ses fiançailles avec Julie Wohryzek. Mais leur relation mène à une impasse. Milena respecte sa rigueur morale, sa quête d’absolu, de vérité et de pureté, pour elle un idéal impossible à atteindre.
Wagnerova suit le travail journalistique de Milena, de plus en plus affirmé, et aussi sa vie de couple « à distance », chacun habitant désormais une moitié de la maison, le chat allant de l’une à l’autre. Après leur rupture, Milena rentre à Prague en 1925 : elle incarne la femme moderne, émancipée, participe à la vague d’optimisme d’après-guerre. « Soleil, air, espace, mouvement, tels sont les mots magiques qui expriment les besoins vitaux de l’homme moderne » pour les nouveaux architectes comme Jaromir Krejcar qu’elle épouse en 1927.
Enceinte de Honza, en plein bonheur, Milena est frappée par une première attaque d’arthrite, dont un genou ne se remettra jamais, elle boitera. « Malheureuse n’est pas le mot juste, fichue, voilà comme je me sens et comme je suis en effet », écrit-elle à Jaroslava. La morphine l’aide à revenir à la vie, mais crée une nouvelle dépendance. De gauche, elle se rallie au parti communiste « avec l’idée de pouvoir faire encore quelque chose d’utile en ce monde ».
Nouveau divorce, rupture avec le Parti, désintoxication, Alena Wagnerova suit les différents fils de la vie d’une femme passionnée, entière, active, engagée,qui refuse de quitter Prague malgré le danger nazi, trop occupée à aider les autres. En novembre 1939, la Gestapo l’arrête, l’emprisonne. Malgré l’acquittement prononcé au procès de Dresde, elle est transférée à Ravensbrück. Elle y sera jusqu’à la fin une femme « debout ».