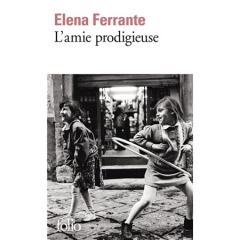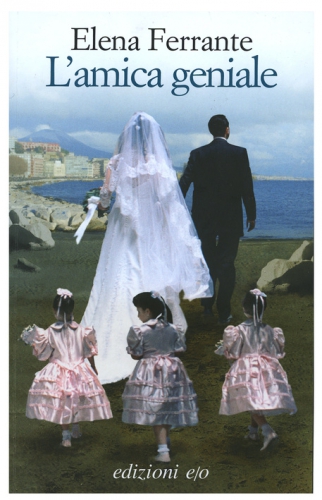Le tabac Tresniek de Robert Seethaler a déjà fait le tour de la blogosphère. J’y poserai tout de même ma petite pierre à propos de ce roman (Der Trafikant, traduit de l’allemand (Autriche) par Elisabeth Landes) qui raconte l’histoire de Franz Huchel, un jeune homme de dix-sept ans qui quitte la cabane de pêcheur où il vit avec sa mère pour aller travailler au service d’un ami à elle, Otto Tresniek, qui tient un tabac dans le centre de la capitale autrichienne.
Vienne, 1937. Dans la boutique minuscule bourrée de journaux, revues, cahiers, livres, cigares et cigarettes « et autres menus articles », le buraliste assis derrière le comptoir lui fait bon accueil. Pour faire le tour du magasin, il se déplace sur des béquilles (il lui manque une bonne partie de la jambe gauche), indique à Franz sa place – un tabouret près de l’entrée – et sa première activité : « aiguiser sa cervelle et (…) élargir son horizon, autrement dit, (…) lire les journaux » – selon Tresniek, « le fondement même de l’existence du buraliste ». Le garçon logera dans la remise à l’arrière.
Depuis qu’on lui a attribué ce bureau de tabac en 1919, Tresniek est devenu « une institution » fréquentée par des clients de passage mais surtout par des habitués. Franz apprend à les observer, à retenir « leurs habitudes et leurs marottes », à connaître ceux qui demandent à jeter un coup d’œil dans le « tiroir » des « revues galantes ». Comme promis, il écrit chaque semaine une carte postale à sa mère.
En octobre, le buraliste pense encore que l’engouement pour Hitler est une bonne chose pour le commerce des journaux et que tout cela n’empêche pas les gens de fumer. C’est alors que l’entrée d’un vieux monsieur à barbe blanche bien taillée dans le magasin fait se dresser Tresniek « comme un diable de sa boîte » pour servir à « monsieur le Professeur » ses cigares préférés et le journal : Sigmund Freud en personne.
Le jeune Franz veut tout savoir de ce « docteur des fous » à qui Tresniek prévoit des ennuis (« c’est un youpin »). En ville, il a vu pour la première fois des Juifs en chair et en os et ne sait trop que penser à leur sujet, mais ce professeur célèbre l’attire et quand il voit qu’il a laissé son chapeau sur le comptoir, il se précipite pour le rattraper, le lui rendre et même lui porter son paquet jusque devant sa porte.
Leur conversation en chemin sera la première d’une longue série. Voilà quelque chose d’intéressant à raconter à sa mère ! Sur les conseils du professeur, qu’il a interrogé sur l’amour, Franz se décide à sortir plus souvent en ville « pour tenter de trouver son bonheur avec une fille à son goût ».
Au Prater, près de la Grande Roue, on peut boire une bière, visiter le palais des glaces, observer les attractions et les promeneurs du dimanche. Sur une balançoire, il voit le plus beau visage de fille qu’il ait jamais vu, « petite tache rose dans le bleu immense du ciel », celui d’une fille rieuse à l’accent de Bohême, vite d’accord pour qu’il l’accompagne au stand de tir où elle lui déclare effrontément : « T’sais pas tirer, mais t’as un beau p’tit cul ! »
Voilà les ingrédients de cette histoire qui tient surtout par l’évocation de Vienne au temps de la montée du nazisme. On se doute que les personnages n’en sortiront pas indemnes. C’est le personnage du buraliste Tresniek qui m’a le plus touchée. Les naïvetés du garçon qui fait ici son apprentissage de la vie et de ses rencontres avec Freud ne sont pas tout à fait à la hauteur du sujet, mais Le tabac Tresniek de Robert Seethaler (né en 1966) est un roman agréable à lire, peut-être davantage pour de jeunes lecteurs.