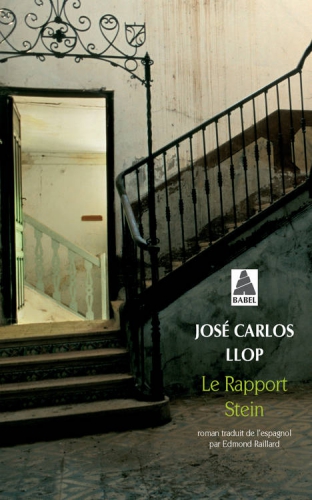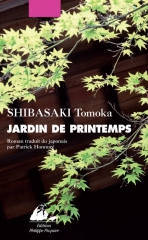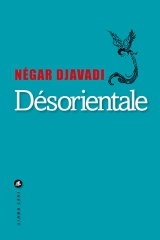« Guillermo Stein est arrivé au collège au beau milieu de l’année scolaire, à bicyclette. Aucun d’entre nous n’allait à bicyclette. » D’emblée, José Carlos Llop (né à Majorque en 1956), nous introduit dans un collège de Jésuites à Majorque, dans les années soixante, et dans la vie de Pablo Ridorsa, un garçon solitaire et sensible, élevé par ses grands-parents. Le Rapport Stein (El Informe Stein, 2000, traduit de l’espagnol par Edmond Raillard, 2008), en moins de cent pages, raconte leur amitié.
José Carlos Llop donne un rythme très particulier à son récit – répétitions, explicitations, précisions : « On ne le voyait presque pas, le nouveau, Stein, sur sa bicyclette, n’eût été cet imperméable rouge qu’il portait sur les épaules, une pèlerine en plastique nouée autour du cou, sur laquelle la pluie dégoulinait jusqu’au sol. » En classe, Stein, avec ses pulls colorés, ses pantalons à poches, tranche avec eux tous habillés de gris ou de brun, « de la couleur des plumes de perdrix ».
Son arrivée coïncide avec la mort du père Azcárate, que les élèves de onze à seize ans, organisés par sections, doivent veiller dans la crypte de demi-heure en demi-heure, une coutume du collège pour leur tremper le caractère. Pablo est « consul d’histoire » et son groupe hérite du premier tour, suivi par celui de Palou, « consul de mathématiques » et « capitaine de la classe ». Pendant l’étude, Pablo surveille le nouveau, qui range ses affaires dans son pupitre, « pour avoir quelque chose à raconter à Palou quand il remonterait de la crypte ».
Tout les intrigue chez Stein, et en particulier la plaque ovale sur sa bicyclette, marquée des lettres « C. D. » et d’un blason « avec une devise en latin, des licornes et des fleurs de lis ». Rien qui ressemble à aucun drapeau de leur Atlas universel. Palou a décrété que c’était « un type bizarre ». Quand Stein referme son pupitre, il sourit à Pablo, qui lui sourit en retour.
A la maison, il raconte l’arrivée de Stein à ses grands-parents chez qui il vit, ses parents étant toujours en voyage : « Mes parents étaient des cartes postales couleur d’ambre (…) » postées à Nice ou à Marseille, au Caire ou à Tanger, remplies de formules creuses. Ses grands-parents échangent un drôle de regard quand il prononce le nom de Stein – « et Stein, pour la première fois, m’a paru être le sifflement d’un cobra, le son d’une balle avant qu’elle atteigne la cible. » Mais ils ne disent rien.
Blond aux yeux bleus, le nouveau sidère ses camarades de classe curieux en lâchant sans sourciller que son père « a été l’ami du comte Ciano » et que lui est « un agent secret de Sa Sainteté ». Alors les garçons décident de s’adresser à Planas, leur condisciple spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, dont un oncle a combattu dans la división Azul. Planas sait que Ciano avait imaginé d’italianiser Majorque, d’en faire « une base militaire et un lieu de repos pour les chefs du Fascio », mais il doute que Stein soit un espion, « aspirant camerlingue, tout au plus ». Et aucun n’ose lui demander ce que le mot veut dire. Alors Palou commande à Planas « un rapport écrit sur la famille de Stein ».
Puis la routine scolaire reprend le dessus, avec les faits et gestes des professeurs plus typés les uns que les autres, souvent brutaux ou de parti-pris. Stein invite Pablo à passer un dimanche après-midi chez lui et son grand-père ne dit pas non, mais « Méfie-toi de ce que tu ne connais pas et sois à la maison à huit heures ». La maison lumineuse de Guillermo Stein, située dans un quartier aux jardins luxuriants, est très différente de ce que connaît Pablo : « on voyait la mer depuis toutes les fenêtres ». Il est ébloui par la vue sur le port et sur la ville de Palma, « étalée en éventail sur la baie argentée », avec au centre le « fantastique vaisseau de pierre ocre » de la cathédrale.
Ce n’est pas le seul sujet d’étonnement pour Pablo, et cette après-midi chez les Stein va nourrir ses rêves pour longtemps. Mais sa grand-mère, lui dit son grand-père, n’aime pas qu’il aille là-bas – « Moi, ça m’est égal, dans cette vie tout ce qui doit arriver finit toujours par arriver. » Il rôde bien des secrets autour de Stein, le nouvel ami de Pablo Ridorsa.
L’arrivée d’un nouvel élève fascinant, les débuts d’une amitié hors du commun : de grands noms de la littérature ont traité ce sujet. Le Rapport Stein de José Carlos Llop, « comparé par la critique au Grand Meaulnes et aux Désarrois de l’èlève Törless » (quatrième de couverture) est un récit hanté par les histoires de guerre et les secrets de famille. Ce premier roman qu’on n’oubliera pas (merci, V.) donne envie de lire plus avant cet écrivain, « un Modiano majorquin » (selon Olivier Mony dans Le Figaro) pour qui la littérature la plus intéressante s’appuie sur la mémoire et sur le temps.