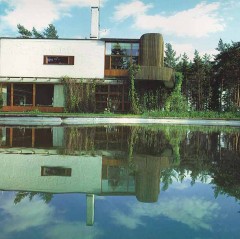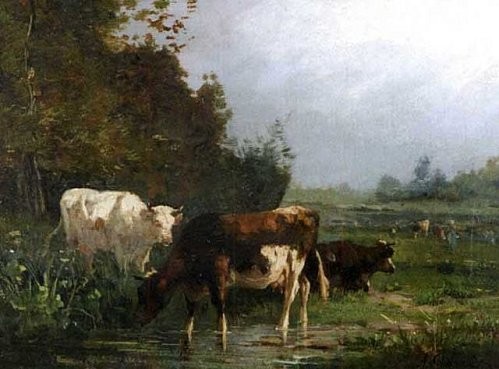« Mon ami Jacinto naquit dans un palais, avec cent neuf millions de réaux de rente en terres arables, vignoble, chênes-lièges et oliviers. » Ainsi commence 202, Champs-Elysées (A Cidade et as Serras), roman posthume de José Maria Eça de Queiroz (1845-1900), écrivain et diplomate portugais. La fabuleuse histoire d’un héritier né à Paris, protégé du mauvais sort par le fenouil et l’ambre répandus par sa grand-mère près de son berceau, doté de toutes les qualités du corps et de l’esprit, racontée par son meilleur ami, Zé Fernandez.
C’est au temps de l’université que celui-ci a rencontré « le Prince de Grande-Fortune », comme l’appelaient ses amis, chantre de la Civilisation : « Maximum de science x Maximum de pouvoir = Maximum de bonheur », voilà la formule de Jacinto, une idée inséparable de la Ville « dont tous les immenses organes fonctionneraient puissamment ».
Rappelé par son vieil oncle à Guiães, Zé Fernandez y passe sept années de bonne vie campagnarde puis revient à Paris. Au numéro 202 de l’avenue des Champs-Elysées, le jardin n’a pas changé, mais à l’intérieur, que de nouveautés ! Jacinto y a fait installer un ascenseur, bien qu’il n’y ait que deux étages, avec divan, peau d’ours et étagères. Sa bibliothèque en ébène massif compte au moins vingt mille volumes reliés. Dans son cabinet de travail où tout est vert, Jacinto dispose de toutes sortes d’appareils modernes, de « pas mal de commodités » comme le téléphone et le télégraphe, un conférençophone et un théâtrophone, des plumes électriques… Eberlué, Zé observe qu’entretemps son ami a maigri, s’est un peu voûté, et a perdu l’appétit malgré son incroyable salle à manger.
Après s’être installé au 202, Jacinto y tenait absolument, Zé Fernandez jouit de toutes les facilités du lieu et du service de Grillon, le valet noir de Jacinto. Jour après jour, il est initié à la vie supercivilisée et assiste aux rituels de la salle de bain équipée de toutes sortes de jets, aux coups de téléphone incessants, à la lecture d’innombrables journaux et, quand les obligations sociales de Jacinto le permettent, sort avec lui à pied dans Paris. « Quelle scie ! », répète à présent son ami, quelque peu las des « flétrissures » de la vie urbaine. Lui qui adorait « aller au Bois » se promène dans son coupé au Bois de Boulogne sans ferveur, sombre, insatisfait.

Paris (VIIIème arr.) L'avenue des Champs-Elysées, vers 1910 © ND / Roger-Viollet
Eça de Queiroz, on l’a compris, propose dans 202, Champs-Elysées une satire de la vie parisienne à la fin du dix-neuvième siècle et de la foi dans le progrès technologique. Jacinto jouit de tous les privilèges, reçoit les dames du grand monde, mais un problème de canalisation, une inondation, une panne, et tout son bonheur s’écroule. Ainsi, la fête somptueuse pour son ami le grand-duc qui lui a fait livrer un poisson délicieux pêché en Dalmatie prend un tour dramatique quand Jacinto apprend que le monte-plats est bloqué, le fameux poisson inaccessible. Le grand-duc ne lui en tiendra pas rigueur, amusé par la séance de pêche improvisée (et vaine) et rassasié des mets les plus délectables. « La barbe, tout ça ! Et en plus rien ne marche ! » rugit Jacinto après coup. Et pour l’accabler encore, arrive du Portugal la nouvelle d’une catastrophe : un glissement de terrain sur ses terres a entraîné avec un pan de la montagne la vieille église où étaient enterrés ses aïeux – son régisseur attend les ordres de son seigneur.
Au printemps, tandis que de grands travaux sont entrepris au 202 pour le rétablir dans toute sa splendeur, Zé Fernandez, de son côté, tombe amoureux d’une « créature d’amour » stupide et triste, « Madame Colombe ». Sept semaines de fièvre. L’accablement de Jacinto le désole, il prouve à quel point la Ville, « anti-naturelle » dessèche, inquiète, détériore tout. « Et tout un peuple pleure de faim » pour l’orgueil de la Civilisation. Zé décide alors de faire un tour des villes européennes, visite cathédrales et musées – « Je dépensai six mille francs. J’avais voyagé. » A son retour, il découvre que Jacinto est passé de l’optimisme au pessimisme radical, se plaignant de tout.
A la fin de l’hiver, le propriétaire du 202 usé jusqu’à la corde, « empêtré dans l’infime embarras de vivre », décide de retourner sur ses terres portugaises pour le transfert des restes de ses ancêtres dans la nouvelle chapelle qu’il y a fait construire. Les préparatifs du voyage – il faut aménager là-bas la vieille maison – provoquent un retour de passion pour la Ville et les plaisirs de la Civilisation. Malgré tous ses soins, après de fâcheux embarras de train, Jacinto et son ami arrivent à destination sans leurs bagages, égarés, dans une maison où rien n’est prêt – les trente-trois caisses envoyées de Paris ne sont jamais arrivées.
La suite, on s’y attend… Dans la seconde partie du roman, Jacinto va ressusciter sur ses terres, la vie simple à la montagne va le réconcilier avec le monde. Eça de Queiroz, avec beaucoup d’humour et une plume allègre, reprend dans 202, Champs-Elysées le thème de la décadence urbaine opposée à la régénération par la nature qu’il avait déjà abordé dans une nouvelle, Civilisation. Nommé consul du Portugal à Paris en 1888, il y est resté jusqu’à sa mort. Cette satire « violemment ironique et très drôle, caricaturale » de la société parisienne fin de siècle, comme l’écrit la traductrice Marie-Hélène Piwnik dans l’introduction, et ensuite d’une campagne-modèle idyllique dans un paradis montagnard, parle encore aux lecteurs du XXIe siècle, qui peuvent y retrouver certaines de leurs préoccupations. Merci à Dominique d’avoir recommandé ce livre « incisif, enjoué, où la décadence a du charme et de l’esprit. »