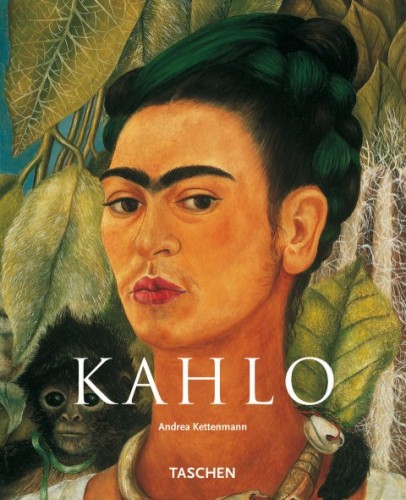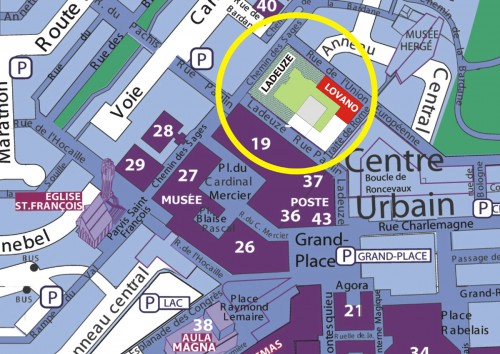Ouverte au public depuis le 23 avril 2010, la Villa Empain, au n° 67 de la prestigieuse avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles, retrouve enfin la fonction que lui destinait Louis Empain lorsqu’il en fit donation à l’Etat belge en 1937 : « servir de Musée des arts décoratifs contemporains ». La fondation Boghossian qui a acquis ce chef-d’œuvre de l’art déco en 2006 et l’a fait restaurer y présente une belle exposition intitulée « Itinéraires de l’élégance entre l’Orient et l’Occident » jusqu’au 31 octobre 2010.
Louis Empain n’a guère vécu dans cette maison. Après l’avoir reçue, l’Etat belge a confié à l’Ecole de la Cambre la direction d’un Musée des Arts décoratifs, comme prévu, mais l’armée d’occupation allemande a réquisitionné la villa en 40-45 et après la guerre, elle est devenue l’ambassade d’URSS, au grand dam du donateur qui a rappelé les conditions de la donation et a fini par récupérer sa propriété pour en faire un Centre multiculturel. Plus tard, elle sera vendue, puis louée à la chaîne RTL pour son siège en Belgique, jusqu’en 1993. Au début des années 2000, elle est à l’abandon, partiellement détruite et vandalisée. Une restauration de grande envergure
a donc été nécessaire.
Le résultat est somptueux. La villa même éblouit d’abord. Louis Empain, second fils du richissime Edouard Empain, homme d’affaires wallon au parcours remarquable (connu en France pour sa réalisation du métro parisien), a confié sa construction à l’architecte suisse Michel Polak au début des années 1930. Celui-ci avait conçu le fameux Résidence Palace et était devenu une figure marquante de l’art déco bruxellois. Pour la Villa Empain, il allie le luxe des matériaux et des détails aux lignes simples et symétriques de l’architecture moderniste sans ornementation superflue : façades en granit poli, cornières en laiton dorées à la feuille sur les angles de la maison et autour des baies vitrées, marbres et bois précieux à l’intérieur.
La ferronnerie des grilles côté rue annonce un portail d’entrée somptueux en haut de l’escalier, aux motifs géométriques réguliers en noir et or. A peine les portes franchies, c’est la lumière qui frappe le regard, celle de la grande verrière du hall central tout en marbres de diverses tonalités et, dans l’axe de l’entrée principale, celle des baies vitrées côté jardin. Les pièces sont disposées autour de ce grand hall, de façon classique et équilibrée, donnant une impression de calme et d’harmonie.
L’exposition débute au rez-de-chaussée dans le salon intime, à gauche, couvert jusqu’au plafond de bois sombre et poli, et puis se déploie dans les salles de réception d’où l’on découvre le jardin et son immense piscine entourée d’une pergola. Elle se poursuit à l’étage. Le thème de l’élégance, plutôt vaste, se décline ici dans l’optique
de « la qualité des choses » et de l’influence des cultures orientales sur l’Occident. Dans chaque pièce, l’ancien et le moderne se côtoient, des artistes contemporains aussi. Ainsi, près du bar du salon intime, où l’on a refait à l’identique une fontaine en argent en forme de poisson, on expose un narguilé contemporain très design de
Nedda El Asmar, dans une vitrine, un beau chat de bronze noir d’Edouard-Marcel Sandoz. Au mur, des miniatures persanes prêtées par le Musée des arts décoratifs de Paris, au milieu, des porcelaines turques anciennes. En sortant, j’admire encore les portes en bois de Cuba magnifiquement restaurées.
Dans le hall, un gigantesque collier de perles creuses mouchetées d’or de Jean-Michel Othoniel et au fond, se faisant face, un Bouddha et un Moine en bronze doré. Dans les pièces de réception, deux sculptures abstraites en granit noir d’Armen Agop dans le salon d'honneur, sous une superbe verrière de Max Ingrand. A gauche, de beaux objets divers : luth vietnamien à trois cordes, bijoux, petites sculptures, théière chinoise en porcelaine blanche du XVIIe siècle, flacons à sel, service à thé, nécessaire de toilette Vuitton… Suspendue, une robe chinoise en soie du XIXe siècle à fleurs roses sur fond mauve, surmontée d’une superbe collerette, au-dessus d’une jupe orange aux motifs végétaux. A droite, près d’un plat fleuri en faïence noire de l’atelier Gallé,
luisent de beaux vases asiatiques dans des tons de rouge foncé. Un reliquaire tibétain, une tasse à thé et sa soucoupe en cuivre argenté et jade, des objets prêtés par les Musées Royaux d’art et d’histoire de Bruxelles. Une jolie assiette fleur d’Auguste Delaherche. Une impressionnante théière ornée d’argent et de pierres précieuses (Tibet, XVIIIe), avec une anse dragon.
Près de l’escalier vers l’étage, un grand brasero aux émaux cloisonnés de couleur turquoise est surmonté d’un éléphant doré. Au-dessus des marches, de longs pans de papier peints par Bang Hai Ja, une artiste coréenne. Cela s’appelle « Lumière née de la lumière ». A l’étage, autour du puits central, un garde-fou en fer forgé reprend les motifs d’en bas. Les pièces qui se répartissent autour proposent encore plein de choses intéressantes : des photos (notamment des tirages délicats de Masao Yamamoto), des boîtes précieuses, des livres anciens, de très belles estampes signées Utamaro, Hiroshige, une robe finement plissée d’Issey Miyake… Un coup de cœur pour les grands plats bleus en semi-porcelaine de Kimura Yoshiro.
Vous aimerez peut-être aussi la salle consacrée aux peintres orientalistes, les mosaïques vertes et bleues du cabinet de toilette. Plus que les énormes bijoux asiatiques, j’ai admiré de petits objets précieux (briquets, poudriers, bijoux rares)
issus des collections Boghossian et Cartier - des salles surveillées de près. Et une jardinière de Zadok Ben David : dans une vitrine serre, un parterre de fleurs en silhouettes, noires devant, colorées derrière, qui se reflètent dans un miroir au fond, où elles se dédoublent. Leur ombre dessinée au sol accentue leur présence, l’effet est magique.
« Il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu’on les poursuit. » Jean Boghossian cite cette phrase de Faulkner dans sa préface à La Villa Empain, histoire et restauration, un livre édité par la région de Bruxelles-Capitale. Sa fondation familiale, vouée d’abord aux actions humanitaires, en Arménie, en Syrie et au Liban, a élargi son engagement à la défense de valeurs humanistes. Elle veut faire de la Villa Empain un Centre d’art et de dialogue entre l’Orient et l’Occident. L’art rapproche les hommes et est un facteur de paix, c’est son credo, alors que « les guerres ne sont gagnées par personne, elles sont toujours perdues », ajoute Jean Boghossian. La tunique originale des attachées au musée a été dessinée par des stylistes de La Cambre et brodée au point de croix par des brodeuses palestiniennes. C’est bien dans l’esprit de cette grande demeure bruxelloise, nouveau lieu de rencontre entre les civilisations.