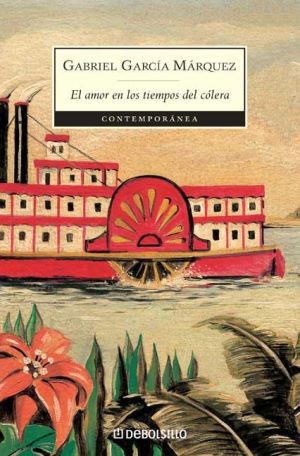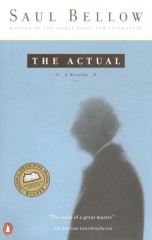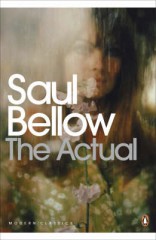De Saul Bellow, voici un court roman intitulé Une affinité véritable (The Actual, 1997, traduit de l’anglais par Rémy Lambrechts). En semi-retraite, bon observateur, l’air chinois, Harry Trellman a derrière lui une enfance à l’orphelinat (ses parents l’y ont placé), un don pour le commerce et de bonnes affaires en Birmanie qui l’ont « assuré d’un revenu jusqu’à (ses) vieux jours ».

Une vue de Sheridan Road à Chicago (Photo Wikimedia)
A Chicago, il possède un commerce d’antiquités et un appartement « en bordure de Lincoln Park ». Sa réputation « de bon connaisseur de l’Orient » lui vaut d’être invité dans de bonnes maisons et, à un dîner, il rencontre « le vieux Sigmund Adletsky et Mme » – l’homme est célèbre pour avoir fait bâtir des palaces sur la côte mexicaine et d’autres « palais de rêve pour plages subtropicales », avant de confier son empire à ses descendants.
Frances Jellicoe, qui a hérité d’une fortune et de tableaux de grands maîtres, divorcée à la demande de Fritz Rourke, le père de ses deux enfants, continue à l’aimer et à le recevoir. Au dîner qu’elle donne ce soir-là, celui-ci s’enivre et perd à nouveau le contrôle de lui-même – « Le vieil Adlestky était assis à ma table et lui non plus n’en perdait pas une miette. » Quelques jours plus tard, Harry reçoit un mot d’Adletsky qui voudrait le rencontrer.
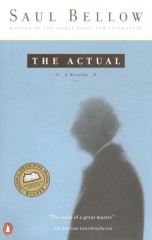
Quand ils se revoient au sommet d’un immeuble, Adletsky ne lui pose pas de questions personnelles : « Ma vie et mes œuvres avaient été passées au crible par ses collaborateurs. Manifestement, j’avais survécu au test préliminaire. » Le vieillard a été frappé par sa grande culture générale et lui qui est « riche au-delà de l’entendement de la majorité des gens » l’interroge sur ce qu’il a vu ce soir-là chez Frances Jellicoe, les autres invités, le manège des uns et des autres. Adletsky s’est très peu mêlé à la vie mondaine tant qu’il était actif, il souhaite à présent qu’Harry, « un observateur de première classe », fasse partie de son « brain-trust ».
D’un tout autre milieu, Amy Wustrin est la seule personne qui compte pour Harry ; ils sont brièvement sortis ensemble au lycée puis se sont perdus de vue, mais elle est restée son « objet d’amour » : « Un demi-siècle de sentiment est investi en elle, de fantasmes, de spéculations et d’obsessions, de conversations imaginaires. » Devenue décoratrice d’intérieur, Amy a rendez-vous avec les Adletsky dans un grand duplex qu’ils achètent aux Heisinger sur Sheridan Road – ceux-ci voudraient qu’ils reprennent aussi leur mobilier et Amy doit en estimer la valeur. Mme Heisinger avait été la cliente de Jay, le mari d’Amy, décédé un an plus tôt (l’ami de Harry depuis l’orphelinat).
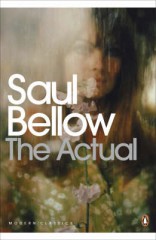
Ajoutez à ces relations et tractations un problème de caveau de famille au cimetière, et vous aurez les ingrédients d’Une affinité véritable. L’intrigue, assez embrouillée, y importe moins que les liens noués, dénoués, renoués entre les uns et les autres, le tout rapporté à la première personne par Harry, acteur et témoin. « Je n’aurais jamais osé penser qu’Amy attendait son heure tandis que je me rapprochais d’elle. » Une centaine de pages pour vérifier s’il existe ou non, entre Amy et lui, une véritable affinité, voilà le sujet du roman de Saul Bellow, qui avait une grande expérience en la matière (mariages et divorces).
Hasard de lecture, le Courrier international parle cette semaine des « nouveaux ghettos des milliardaires » – « Les ultrariches s’emparent des villes ». Dans One Hyde Park, « l’immeuble résidentiel le plus cher de tout Londres », 80% des appartements ont été « achetés par des sociétés basées dans les îles Vierges britanniques ». Alex Preston (The Guardian, 6/4/2014) en a fait le tour avec un agent immobilier.

On lui fait visiter les parties communes : « Premier arrêt, la bibliothèque, où l’on a manifestement voulu reproduire l’atmosphère d’un club. Aucun livre en vue. Et même s’il y en avait, il ferait trop sombre pour lire. Tout est bois sombre et pierre noire, et les coins de la pièce sont plongés dans les ténèbres. Il n’y a aucun être humain. » En suivant le journaliste des salles obscures et silencieuses (cinéma, piscine) aux appartements luxueux dont si peu de fenêtres s’éclairent le soir, je pensais aux vieux richards de Chicago observés par Saul Bellow, curieux de la comédie sociale et humaine.
 « La seule chose que je vous demande c’est d’accepter une lettre », lui dit-il.
« La seule chose que je vous demande c’est d’accepter une lettre », lui dit-il.