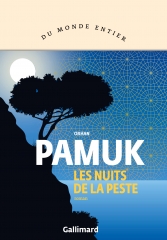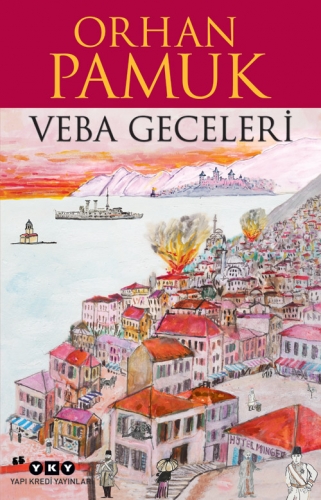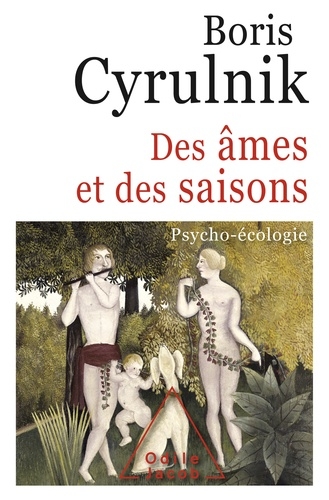Benoît Vitkine a obtenu le Prix Albert-Londres en 2019, un an avant la publication de Donbass, son premier roman. Correspondant du journal Le Monde à Moscou, il signe des reportages sur l’Ukraine depuis 2014, quand la guerre du Donbass éclate dans l’est du pays, juste après l’annexion de la Crimée par la Russie. Un conflit non résolu, comme l’a montré l’invasion russe en Ukraine cette année. Voilà pour le contexte de Donbass, qui ne raconte pas la guerre mais une intrigue policière dans la guerre.

Terrils miniers le long du Kalmious dans le Donbass, photo Andrew Butko (Wikimedia)
Après la mort de sa fille dans un accident, douze ans plus tôt, Henrik Kavadze, le « colonel », un policier vétéran de la guerre en Afghanistan, avait convaincu sa femme de venir s’installer dans une maison avec un petit jardin du Vieil-Avdiïvka (oblast de Donetsk) aux « faux airs de village », espérant une « cure de grand air et de « simplicité » ». A l’été 2014, une contre-offensive ukrainienne a libéré Avdiïvka des séparatistes, mais quatre ans plus tard, la guerre continue : « On se tirait dessus au canon, on s’enterrait dans des tranchées, on continuait en somme à mourir, mais le front ne bougeait plus. Manque de chance, il s’était stabilisé précisément à la sortie de la vieille ville d’Avdiïvka, là où Henrik avait entraîné Anna. »
A 54 ans, dont 25 dans la police, il n’est pas étonné, en interrogeant un jeune maraudeur, d’apprendre que son adjoint, l’a dépouillé de son argent – « trop d’expérience pour s’émouvoir de la corruption de ses hommes ». Le chef de la police a ses habitudes pas loin du commissariat, au café Out, où on vient le chercher pour un meurtre. Les cadavres de la guerre ne sont pas de leur ressort, mais on a trouvé dans un terrain vague le corps du petit Sacha Zourabov qui vivait chez sa grand-mère depuis trois semaines. « Aussi fou que cela puisse paraître, la nouvelle de la disparition de l’enfant était restée confinée aux deux appartements mitoyens occupés par Isabella et sa voisine. »
En voyant l’enfant de six ans presque nu, cloué au sol gelé par un poignard, « comme un papillon épinglé dans le carnet d’un entomologiste », Henrik reconnaît le couteau militaire des soldats d’Afghanistan, il en avait eu un semblable. La seule à qui il peut montrer ses états d’âme, c’est une jeune prostituée qui « accepte son grand corps osseux », Ioulia, « plus précieuse qu’un bataillon d’indices » et d’une « bienveillance absolue » envers tous les êtres vivants.
Le meurtre du garçonnet émeut particulièrement les habitants. Habitués aux tirs, aux bombardements, ils sont choqués par la nouvelle. La vieille Antonina Gribounova, une veuve qui fait régulièrement appel à Henrik pour de petits dépannages, a recueilli depuis deux ans le petit Vassili sans famille. Très curieuse, elle a préparé une tarte à la viande dont elle distribue les parts à ses voisines, qui lui offrent un verre de sherry pendant sa tournée en plus de se raconter leurs soucis et les nouvelles. Elle passe même chez « la triste Loussia », sèche et grise alors que les autres portent des couleurs et engraissent « pour tromper la mort et le froid ». Celle-ci préfère chauffer, elle se dit frileuse comme l’est son petit Aliocha (mort depuis trente ans) et ne réagit qu’à peine.
Anna s’inquiète quand Henrik la laisse seule à compter les obus qui tombent, mais leurs rapports se sont distancés, il ne se confie plus à elle. Quant au conflit larvé qui se poursuit, il convient « aussi bien à Kiev qu’aux rebelles et à leur parrain moscovite. Tant que le nombre de morts restait limité, personne n’était prêt à des concessions. Et les Occidentaux pouvaient oublier cette demi-guerre sur laquelle ils n’avaient aucune prise. » Il lui faut toute l’autorité de sa fonction et de son âge pour passer le check-point à l’entrée du village où habite Alina, la mère du petit Sacha, qu’il veut interroger. Cette ancienne comptable n’a plus d’emploi, à peine de quoi survivre. « Son fils était mort ; il n’avait rien à lui offrir. »
L’enfant n’a pas été violé. Aucune trace d’ADN ni d’empreinte digitale. Seul indice : des résidus de poussière de charbon sur le corps. Les différentes pistes sur lesquelles le policier enquête ne mènent à rien. A l’enterrement du petit Sacha, il y a foule. Le général de police est parvenu à négocier une trêve pour la durée de la cérémonie. A la sortie de l’église, quand le petit cercueil arrive au bas des marches, Henrik voit Ioulia s’agenouiller, tête baissée, et puis tous les autres, ce qui n’est pas une coutume dans le Donbass : « Elle existait donc, se dit le policier, cette unité qui faisait défaut à l’Ukraine, cette identité introuvable. Dans la mort. » Lui se contente de s’incliner et observe.
Un ancien camarade de combat, qu’on dit « revenu cinglé d’Afghanistan », Arseni Ostapovitch, très agité, vient alors le trouver : « Mon adjudant, ça ne te rappelle rien ? » Henrik ne se souvient pas. Ensuite c’est le gros Levon Andrassian, le patron de la ville, « aussi adroit dans la gestion des livres de comptes que dans le maniement des armes ». Henrik en profite pour l’interroger sur ses trafics : on a vu des camions déchargés en vitesse de sacs de charbon puis rechargés de caisses au contenu inconnu. L’Arménien ne nie pas la contrebande, puis le somme de trouver vite un coupable, pour que les esprits se calment.
Enfin la vieille Loussia s’adresse à lui qui a aussi perdu un enfant, lui parle de la mère de Sacha : « Elle est encore jeune, après tout… Mais ça ne va pas aller ! Jamais. Et vous, vous le comprenez, Henrik. » Anna ne l’a pas accompagné à l’enterrement, elle lui a repassé sa chemise à la perfection, son activité préférée pour ne pas penser.
Rumeurs et indices vont mener Henrik sur de fausses pistes, jusqu’à ce qu’il comprenne enfin le mobile du crime. Donbass raconte cette enquête policière et, tout autant, la façon dont on vit dans une région où la guerre est devenue routine, où la vie est devenue survie, au milieu des trafics, de la corruption, de la drogue et de l’alcool. Le roman de Benoît Vitkine nous bouleverse, tant l’histoire est triste et dure. Dans cette région que se disputent l’Ukraine et la Russie depuis tant d’années, tant de choses se sont passées que l’espoir d’une réconciliation paraît d’une fragilité extrême.