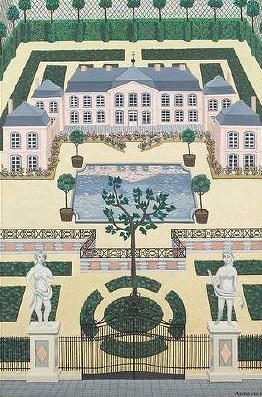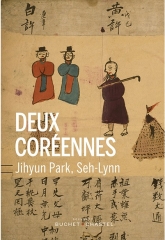Le Pays du Matin calme s’est scindé il y a presque quatre-vingts ans en deux Etats indépendants et ennemis : la Corée du Nord et la Corée du Sud. Sous le titre Deux Coréennes, Jihyun Park (du Nord) et Seh-Lynn (du Sud), qui se sont rencontrées en Angleterre où elles vivent à présent toutes les deux, témoignent des conditions de vie et des mentalités dans lesquelles elles ont grandi. Loin des parades médiatiques du dictateur Kim Jong-un et du président américain, ce récit fait découvrir une réalité plus terrible encore que je ne l’imaginais : dans un régime totalitaire bâti sur la propagande et la délation, les hommes, les femmes, les enfants sont broyés par un système qui les accable et les affame.

Source : The Other Interview (vidéo Amnesty International)
« Jihyun parle de la condition humaine en Corée du Nord, j’écris sur la culpabilité d’être née du « bon » côté de la frontière », écrit Seh-Lynn. Elles se sont rencontrées en 2014 à Manchester, « pendant le tournage d’un documentaire produit par Amnesty International » (The Other Interview). Seh-Lynn a remplacé une interprète en dernière minute. Fille de diplomates, elle se souvenait du poster « A bas les communistes » dans sa chambre et des sirènes annonçant « le début de la simulation de guerre tous les 15 du mois » en Corée du Sud. Malgré l’allure « normale » de Jihyun Park qui a à peu près son âge, Seh-Lynn est « terrifiée » la première fois qu’elle se trouve en face d’elle.
Deux ans plus tard, elles ont appris à se connaître, à se faire confiance. Jihyun lui demande si elle peut l’aider à écrire son histoire, pour « que ce soit écrit par une Coréenne car elle veut parler d’émotions qui sont inexprimables dans une autre langue », sans faire de politique. Elle veut toucher l’âme des humains, raconter l’histoire d’une famille nord-coréenne ordinaire, parler de leur « inimaginable souffrance ». Ensemble, elles espèrent faire ainsi un pas vers le rapprochement, voire la réunification des deux Corées.
Son histoire commence par un sentiment d’abandon : Chul, le fils aîné de Jihyun, lui a demandé pourquoi, quand il était tout petit, elle l’a abandonné un an en Chine « pour lui éviter la prison en Corée du Nord ». D’abord elle se rappelle sa vie à quatre ans dans la banlieue sud de Chongjin, une ville portuaire sur la mer du Japon. Avec ses parents (chauffeur de tracteur excavateur et mère au foyer), elle habitait un appartement de seize mètres carrés. Sa sœur aînée Unni était partie vivre chez sa grand-mère, son frère n’était pas encore né.
L’immeuble « Division mécanique n° 2 » comportait dix appartements par étage, d’une ou deux chambres. La chef d’immeuble, membre du Parti, terrorisait les résidents. A l’entrée, on trouvait le plan de rotation des équipes de nettoyage (les familles nettoient à tour de rôle), les horaires de simulations d’attaque aérienne. Armoire à chaussures dans l’entrée, cuisine, salle d’eau (toilettes sans chasse d’eau, seau pour se laver). Tout le monde dort par terre dans l’unique pièce, sur des nattes rangées dans une armoire. Au mur, « Le Portrait » : on ne fête pas les anniversaires des enfants (seul cadeau, un bol de riz blanc pour elle seule), mais seulement celui de Kim Il-sung, le 15 avril.
De quatre à sept ans, les enfants sont envoyés chez leur grand-mère à la campagne. Là, Jihyun mange à sa faim. Mais sa grand-mère meurt subitement, ses parents la ramènent chez eux. Son père s’occupe de ses deux filles et aussi d’un « grand » oncle et d’un « petit » oncle qui vivaient avec sa mère. Puis vient l’âge d’aller à l’école, de s’y faire des amies, de s’amuser, de chanter « la lutte glorieuse » et d’apprendre la vie de Kim Il-sung, « la personne la plus importante au monde et qu’il fallait aimer ». Depuis son retour, Jihyun a tout le temps faim, une obsession. On leur dit qu’en Corée du Sud, les enfants sont si pauvres qu’ils ne peuvent aller à l’école et meurent de faim. Elle découvrira plus tard que cela s’applique surtout aux enfants du Nord.
Le bonheur tient en trois points : « solidarité, vie collective, optimisme ». Un petit frère naît en janvier 1976, elle devient « la troisième » après la fille aînée et le garçon. Ils appartiennent à la « classe supérieure », celle de la lignée de Kim Il-sung et des combattants contre le Japon (son grand-père paternel), au-dessus de la « classe moyenne » (des gens ordinaires) et de la « classe inférieure » (des familles dont un membre est passé dans le Sud, a fait du tort au Parti, ou des criminels). Son père est membre du Parti et Jihyun, fière d’adhérer à l’Association des Jeunes Pionniers. « On nous apprenait la haine. » Elle rompt avec une amie quand elle apprend que sa famille a été maudite pour avoir possédé des terres. Elle ne sait pas encore que dans cette société hiérarchisée par le statut social, sa propre famille n’est pas à l’abri.
En Corée du Nord, pour la plupart, la nourriture, rationnée, est insuffisante. Sa mère, « entrepreneuse-née », se met à élever des cochons puis à en faire commerce, ce qui les sauve. Le lycée va de pair avec des expéditions semestrielles à la campagne pour aider aux moissons : le travail forcé est rude, les lycéennes s’endorment affamées – « C’était un village où les enfants s’endormaient en pleurant. » Dès le plus jeune âge, on apprend à résister, à « compter sur ses propres forces », à se débrouiller seul : cela forge le caractère.
Quand sa sœur, élève modèle et première au concours, n’obtient pas le poste pour lequel elle a postulé, leur mère leur confie un secret bien gardé : son grand-père, propriétaire terrien refusé par le Parti, est passé dans le Sud pendant la guerre et sa propre mère l’a abandonnée. Le monde de Jihyun s’écroule. Elle rêvait d’étudier les mathématiques à l’université de Pongyang, elle se retrouve en faculté d’agronomie.
« Le reste du monde n’a aucune idée. C’est une vie inimaginable dans un pays où personne n’a le droit de se plaindre. » La suite du récit va crescendo : le froid, la sécheresse des années 1990, la famine, la crise cardiaque de son père, l’arrestation de sa mère pour « activités commerciales illégales », la mort de Kim Il-sung à qui succède un tyran encore pire, la mort de son oncle. Les usines ne fonctionnent plus ; ses élèves (elle est devenue enseignante) meurent de faim. Libérée, sa mère part en Chine rejoindre une cousine éloignée – pour toujours. Ils survivent de racines et d’herbes cueillies sur la colline.
Désespérées, Jihyun et sa sœur avec mari et enfant vont laisser leur père très malade pour aller en Chine en 1998, avec l’aide d’un passeur, soi-disant pour se marier avec un Chinois. Quand ils traversent le fleuve gelé à la frontière, c’est la stupéfaction : « Nous avions côtoyé la mort pendant des années en Corée et, à cent mètres de la frontière, il y avait un autre monde. A peine cent mètres pour baigner dans l’abondance. »
Très vite, elle se rend compte de ce qui attend les Nord-Coréennes là-bas : de la nourriture, enfin, mais aussi le mariage forcé, l’exploitation. Vendue à un ivrogne, elle déchante. « Arrachée à ma terre natale dans l’espoir d’une vie meilleure, j’étais devenue une esclave. » Vous lirez la suite dans Deux Coréennes, pour savoir comment Jihyun s’en est sortie après bien des épreuves épouvantables (arrestation, extradition, prison) puis un second passage en Chine.
Dans un « souci réel de partager et d’informer », Jihyun Park et Seh-Lynn retracent un pan de l’histoire de la Corée contemporaine à travers la vie quotidienne qu’elles y ont connue. C’est terrible et bouleversant.

 « Dans ses toiles, les souvenirs de jeunesse, les lieux aimés sont prétextes à des rêveries méticuleuses où l’humour et la gentillesse trouvent leur place. »
« Dans ses toiles, les souvenirs de jeunesse, les lieux aimés sont prétextes à des rêveries méticuleuses où l’humour et la gentillesse trouvent leur place. »