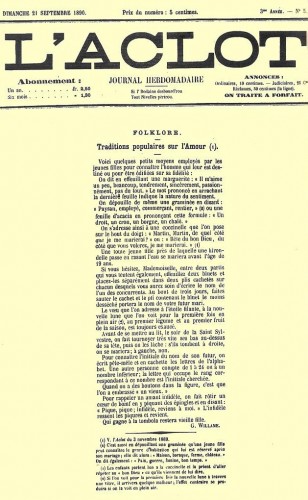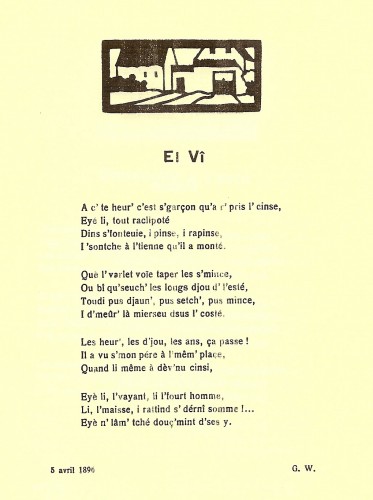Dans Ames et corps, Nancy Huston a rassemblé des textes publiés entre 1981 et 2003 (« plus ou moins la suite de Désirs et réalités. Textes choisis 1979-1994 ») : « Ces textes sont des jalons sur mon chemin de romancière et d’expatriée, de mère et d’intellectuelle, de rêveuse et de réaliste, d’âme et de corps. » Elle commence par y dessiner un « soi pluriel » à travers un parcours en six étapes intitulé « Déracinement du savoir » (2001). Ses parents, un père scientifique, émotif, très présent, une mère « portée sur les arts » et rationnelle très tôt absente de la vie de ses enfants, voilà pour l’origine.
Après avoir quitté le Canada, elle reçoit ses premiers cours de littérature dans un lycée du New Hampshire, formidables : « On a appris que la littérature parlait de mort, de sexe, de folie, de peur, de nous, et que, pour peu qu’on aborde la page (blanche ou imprimée) avec toutes nos forces vivantes, elle était à notre portée. Pas une once de théorie littéraire. » A l’université, Nancy Huston rêve et désespère d’être artiste. A Paris, en troisième année, son désir d’écrire de la fiction se heurte aux mots d’ordre de la Théorie et de la Révolution. Acceptée en 1975 au « petit séminaire » de Barthes – « une période d’apprentissage exaltante » –, elle commence à publier des textes dans des revues, puis se lance dans la fiction. Elle partage dès 1980 la vie de Tzvetan Todorov.
Professeur de sémiologie et de « théorie féministe », elle souffre ensuite d’une maladie invalidante qui remet tout en question. « Mon critère, maintenant que j’ai eu la chance de prendre conscience de ma mortalité, est devenu : « Cela m’aide-t-il à vivre ? » » Alors vient le choix délibéré de la fiction, en parallèle avec la lecture de tout Romain Gary. La romancière nourrit à son tour les études théoriques, mais rien ne peut la détourner de ce que seule la fiction offre : « la vie changeante, fluctuante, pleine de secrets et d’impalpable et de contradictions et de mystères. »
« Festins fragiles » rapproche l’écriture et la cuisine, « mais sans recette », et « tout cela n’est rien sans la musique ». « Toutes les mères sont étrangères » est la première phrase de « La pas trop proche », où elle confronte la figure de sa mère à sa propre expérience de la maternité. Dans Libération, elle s’étonne de ceux qui ont des opinions sur tout, « éberluée par la facilité avec laquelle ils les acquièrent et la violence avec laquelle ils les défendent. » Un séjour en Bretagne chez une femme cultivée qui « zappe » d’un sujet à l’autre lui fait écrire : « Le rôle des intellectuels et des écrivains (…) serait maintenant, au contraire, de rétrécir. D’isoler. D’ériger des cloisons. De concentrer. D’écarter le flux affolant d’images et de bruits, de choix miroitants, d’informations et d’influences parasites. De faire le vide, le silence. De dire une chose, une seule. Ou deux… mais en profondeur. » (Le déclin de l’« identité » ?)
En deuxième partie, « Lire et relire », Nancy Huston va de l’Evangile selon saint Matthieu à Duras, rapproche Tolstoï et Sartre – « bonne foi, mauvaise conscience » –, questionne Romain Gary. Dans la troisième partie, qui donne son titre au recueil, se trouve son texte « le plus largement diffusé dans le monde », « traduit dans treize langues » et même en braille : « La donne » (1994). Nancy Huston le commence par « Je suis belle. Je n’ai encore jamais rien écrit à ce sujet, mais tout d’un coup j’ai envie d’essayer de le faire. » Au paragraphe suivant : « Par ailleurs, je suis intelligente. Moins que Simone Weil. » Elle examine ce que cela a signifié jusque alors dans sa vie, comment cela a joué dans ses rapports avec ses professeurs, avec les Français, avec les Américains qui mettent hypocritement le corps entre parenthèses. C’est une réflexion personnelle sur « les mille langages muets des corps », pour conclure : « On joue selon sa donne. »
Les derniers textes tournent autour de « La maman, la putain… et le guerrier » (quatrième partie). Elle y défend l’hypothèse suivante : « la guerre est un phénomène culturel au même titre que la prostitution, qui essaie de se faire passer pour un phénomène naturel au même titre que la maternité. » Comment la guerre est racontée aux femmes, quel y est leur rôle. Elle y revoit et adapte des propos tenus dans A l’amour comme à la guerre (1984). Nancy Huston est une passionnée qui passionne. Dans Ames et corps, j’ai particulièrement aimé les textes où elle revient sur son propre parcours de femme et d’écrivain. Une lecture stimulante.