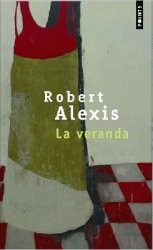« Véranda », ce mot qui nous vient du portugais par l’intermédiaire du hindi et de l’anglais, m’a toujours attirée par sa promesse de lumière et d’échange intime entre le dedans et le dehors. Il m’avait déjà poussée vers un roman plutôt mélancolique de Salvatore Satta (La véranda, 1981), auquel j’ai nettement préféré La véranda de Robert Alexis (2007), découverte en ce début d’année.
Klimt, Chambre sur l’Attersee
« La neige. Un paysage sous la neige. » Les premiers mots du récit, qui semblent évoquer notre hiver, correspondent aux visions d’un passager de train, peut-être en son dernier voyage, ce qui laisse infiniment de place aux souvenirs. Constantinople, Cassis… Dans sa rêverie, le narrateur garde les yeux ouverts : une jeune femme qui descend à Vienne, après avoir essayé en vain d’engager la conversation avec lui, ramène les images de nuits passées dans l’un ou l’autre grand hôtel viennois, de concerts, de restaurants, de soirées au cabaret. « Ma vie avait suivi le cours habituel réservé aux riches héritiers. Mais ce que certains prenaient pour les méandres d’une oisiveté privée de fin, je le considérais comme une recherche sans limite. »
Lors de la traversée d’un lac autrichien, comme il savourait le paysage, il avait aperçu pour la première fois, dans un panorama qu’il pensait connaître, une haute bâtisse dans les bois à flanc de colline, une terrasse à balustres avec, sur la gauche, « une véranda soutenue par des colonnettes ». Plutôt qu’au sentiment de « déjà vu » qui lui avait fait soudain battre le cœur, alors qu’il n’était jamais venu en cet endroit par le passé,
il préférait croire à une « fulgurance » du hasard, née d’une affiche « vantant la beauté de Steinbach » sur le quai d’une gare et à cause de laquelle il s’était rendu dans cette région. « Cette paix intérieure, cette tranquillité de l’âme, je les dois à ce que je vécus au bord de l’Attersee. »
Le roman de Robert Alexis – un mystérieux écrivain lyonnais édité chez Corti - conte l’étrange relation entre l’éternel voyageur et cette maison « reconnue » pour la sienne, d’emblée. Il se renseigne. La villa appartient à un comte, un original que personne n’a jamais vu, un homme « sans âge ». Deux femmes, l’une de vingt-cinq ans, très belle, une autre plus âgée, toutes deux en sombre, s’en occupaient. L’adresse d’un notaire figure sur la grille, pour un éventuel acquéreur. « Je me souviens de ce moment comme l’un des plus forts de ma vie. » Aux sensations et aux réminiscences provoquées par sa première visite se mêlent une voix de femme, des rires, des silhouettes. « Une telle fantasmagorie ne m’étonnait pas. Je reconnaissais les hallucinations provoquées par la prise régulière d’Ayahuasca » - cette poudre des shamans en Amérique du Sud à laquelle un ami l’a initié.
S’il accepte d’entrer dans ces mystères, le lecteur de La véranda embarquera dans une intrigue très romanesque, de la visite chez le notaire à la rencontre avec la propriétaire de la villa. La comtesse habite à Salzburg un immense appartement très dépouillé, suivant la volonté paternelle, à l’inverse de la maison de Linz où se superposent les tissus et les tapis, les bouquets et les meubles – « Les femmes, plus que les hommes, aiment la compagnie des choses. » Ils s’entendent parfaitement, Alicia et lui, et se réapproprient ensemble la charmante demeure, dans une complicité rare.
Jusqu’à ce que l’appel du voyage entraîne à nouveau l’incurable vagabond à Bucarest, où l’attend la jeune Clara, puis en Orient, malgré l’épidémie de choléra à Istanbul. Reverra-t-il Linz un jour ? A-t-il vécu ? A-t-il rêvé ? Sans chronologie véritable, éveillée par le spectacle du monde, nourrie des élans de l’imaginaire, c’est une collection de tableaux vivants qui nous est proposée par Robert Alexis. Avec le goût du mot rare, parfois précieux, il trace peu à peu les lignes de force d’un destin partagé entre le mouvement et l’immobilité, entre le dehors et le dedans d’une vie, entre le présent et le passé, où même l’identité des êtres reste incertaine.