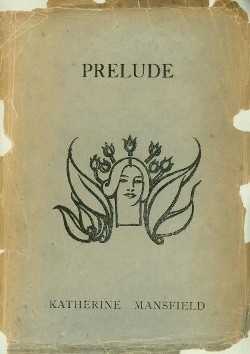Dans l’eau je suis chez moi est le premier roman d’Aliona Gloukhova : le récit par fragments, en une centaine de pages, de la disparition d’un père. Ou plutôt une reconstitution de l’homme que fut Youra Gloukhov pour sa fille, avant de disparaître dans le naufrage d’un voilier. Un portrait puzzle dont les pièces sont ses propres souvenirs d’enfant – elle avait onze ans quand son père a disparu –, ceux de sa famille, sa recherche d’indices dans les endroits qu’il a fréquentés.

La Svislotch à Minsk (Biélorussie)
La narratrice les revoit tous les cinq à bord de la voiture « orange, moche, bossue », une Zaporozhets : son père au volant, sa mère à côté, sa sœur Tania, son demi-frère Slavka et elle-même, cinq ans, sur le siège arrière avec la chienne. Ils vont camper comme chaque été près de la forêt. Là, quand son père entre dans l’eau du lac, « il est dauphin » dans sa combinaison noire imperméable.
Tous les souvenirs ne sont pas si heureux. Son père buvait, comme tout le monde à Minsk, une ville où il faut « boire pour trouver du courage ». Il souffrait de « dipsomanie », un désir irrésistible de boire pendant des jours, jusqu’à devenir « parfaitement immobile ». Quand il arrive à se passer d’alcool pendant un mois, ils mènent une vie de famille « normale », il l’emmène à la piscine, jette des pièces de monnaie dans le bassin, qu’elle va chercher les yeux ouverts. « J’ai appris à nager avant d’apprendre à marcher. » Dans l’eau, elle se sent plus en confiance.
Elle avait onze ans, en novembre 1995, lorsque son père qui en avait cinquante a disparu « sur un voilier, en mer Méditerranée ». Le lendemain, quelqu’un leur téléphone pour le leur annoncer, une voix d’homme inconnue, qui parle de tempête. Les deux autres hommes à bord ont survécu. Pour sa fille, il va revenir : « disparaître ce n’est pas mourir ».
Désormais, à chaque démarche administrative, il lui faudra choisir la mention adéquate pour le statut du père : « mort » ou « disparu ». Cocher la première deviendra plus simple, rien à expliquer. En 2003, à l’université de Minsk, elle perçoit « une allocation, une pension de réversion », de l’argent qui la lie encore à son père.
De quoi se souvient-elle précisément ? De sa barbe qui pique, de ses cheveux durs dont elle a hérité, ainsi que de ses yeux gris bleu. Une fille dresse la liste des choses que son père faisait, disait, aimait. De moments gardés en mémoire. De ce qu’on lui a raconté à son sujet. En 2009, quatorze ans après sa disparition, elle commence à écrire sur « l’indicible », contre cette image floue dans ses souvenirs. Elle interroge sa mère sur leur rencontre, leur vie d’avant, mais sa mère « ne peut pas en parler beaucoup ».
Tania, sa grande sœur, et surtout Slavka, l’aîné, ont leurs propres images de ce père qui disparaissait déjà souvent de chez eux avant de disparaître pour de bon. Il travaillait au contrôle de la radioactivité des équipements médicaux. Le 26 avril 1986 (Tchernobyl), il a tout de suite vu sur ses instruments que « quelque chose s’était passé » et les a tous fait rentrer à la maison, fenêtres fermées et torchon mouillé sur le pas de la porte.
« Je ne sais pas comment j’ai pu m’habituer à son absence, peut-être que je ne m’y suis jamais habituée. Quand j’y pense, je vois à nouveau quelqu’un au milieu d’une chambre, quelqu’un qui tente de parler et n’y arrive pas, parce qu’il faut trouver les mots, et les mots sont rangés dans des endroits inaccessibles. »
Dans l’eau je suis chez moi est l’évocation troublante par Aliona Gloukhova, née en 1984, de son père « dauphin » disparu, imaginé, attendu, rêvé depuis tant d’années. D’origine biélorusse, la jeune romancière l’a écrit en français, dans le cadre d’un Master de Création Littéraire à l’Université Paris 8. Elle explique son parcours sur son site et ce qu’écrire veut dire pour elle : « chercher de nouvelles significations pour les mots et questionner ce qu'ils cachent, mais aussi donner sensibilité et force aux paysages intérieurs des autres ».











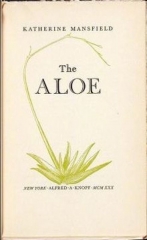 « La dernière à se coucher fut la Grand-Mère.
« La dernière à se coucher fut la Grand-Mère. 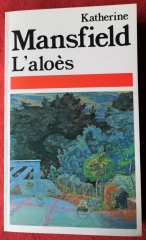 Dans le jardin, de minuscules hiboux poussaient des cris – perchés sur les branches d’un rubanier. ‘Core du porc, ‘core du porc ; et de la brousse, là-bas au loin, surgissait un jacassement vif et criard – Ha Ha Ha
Dans le jardin, de minuscules hiboux poussaient des cris – perchés sur les branches d’un rubanier. ‘Core du porc, ‘core du porc ; et de la brousse, là-bas au loin, surgissait un jacassement vif et criard – Ha Ha Ha