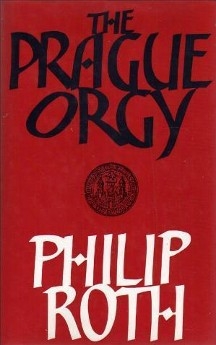L’homme qui observe ses semblables dans le métro, un soir d’automne, le narrateur du roman Etat limite de Pierre Assouline, est généalogiste. Tanneguy de Chemillé l’a invité à la soirée qu’il donne pour fêter l’établissement de son arbre généalogique. François-Marie Samson, l’œil curieux, est attentif aux moindres détails en pénétrant dans leur immeuble du square Albinoni, préférant l’escalier à l’ascenseur pour se rendre au cinquième étage où il est attendu.

Le viaduc de Passy et le métro aérien, où débute Etat limite (source YouTube)
Avec l’impression de marcher dans une page du Figaro, celle du « Carnet du jour », il découvre cette famille française fière de son ascendance. Le fils de Tanneguy et Inès de Chemillé, un adolescent, reste à l’écart de ces réjouissances, le regard plongé dans la contemplation d’un splendide tapis d’Aubusson. Sixte s’avère assez excentrique aussi dans la conversation, brillant élève, souligne sa mère, pour qu’on le laisse tranquille, expliquera le jeune homme.
De la porte-fenêtre, la vue sur la station de Passy, le pont de Bir-Hakeim, le métro aérien va jusqu’à l’autre côté de la Seine où Samson loue un deux-pièces depuis sa séparation d’avec Agathe. La ligne 6 qu’il vient d’emprunter, sa ligne, relie le XVe où il habite et le XVIe des Chemillé dont il envie un peu « la durée, la pérennité, la continuité ». Son regard revient sur les invités et surtout sur la gracieuse Inès, en passant par le décor où ils se tiennent : « Rien qui sentît l’effort, chez les personnes non plus que dans les lieux. »
Invité à rester après le départ des autres, Samson fait la connaissance de son hôte, 51 ans, « grand serviteur de l’Etat » au Quai d’Orsay, en attente d’une ambassade européenne, et de sa femme, études d’HEC, soucieuse de la scolarité de sa fille Pauline. Inès de Chémillé le surprend par la simplicité troublante avec laquelle elle enlève ses chaussures et se masse les pieds sur le canapé en sa présence, tandis que son mari sort les labradors.
François-Marie Samson s’occupe de généalogie familiale et successorale, depuis qu’il travaille à son compte. Quand Tanneguy de Chemillé lui commande en secret l’arbre généalogique de son épouse, les Créanges de Vantoux, pour son anniversaire, il est ravi d’en apprendre davantage sur elle. Il la découvre très efficace dans le cadre de sa profession, à la conférence de presse au Ritz du grand groupe pharmaceutique où elle est directrice de la communication. Il est question de recherches génétiques à partir de l’ADN de tous les Islandais, ce qui suscite questions et protestations parmi les journalistes. Après leur départ, Inès s’approche de lui et avoue que leur rencontre l’a troublée aussi, l’autre soir. Il ne lui en faut pas plus pour passer une nuit blanche.
Ainsi commence une certaine intimité entre Inès et lui, qu’elle lui demande bientôt d’oublier, par un petit mot. Les recherches sur les Créanges de Vantoux ne sont pas faciles, en particulier pour la branche alsacienne où Samson rencontre des difficultés imprévues. Ne pouvant interroger Inès, Samson en fait part au commanditaire tout en le rassurant : « un arbre est possible ». Tanneguy, satisfait de ses travaux, lâche un « j’ai ce que je voulais » qui l’intrigue et lui fait éprouver quelque culpabilité à l’égard d’Inès.
Pour ce généalogiste toujours à l’affût d’une faille, d’une fêlure dans les belles apparences, cette famille devient une obsession. Une manière aussi de ne plus penser à Agathe, qui le harcèle de demandes. Quand il emmène sa mère à la Comédie française et qu’il y croise Inès avec son fils, celle-ci lui confie son inquiétude : Sixte ne parle plus du tout. Il lui laissera l’adresse d’un ami psy qui pourrait l’aider, même si son mari n’en veut pas.
Etat limite, qui s’ouvre sur une visite mondaine, s’emplit peu à peu de mystère. Chacun des Chemillé en porte une part, Sixte d’abord, puis Inès, si belle, si proche de Samson par moments. Déstabilisée par l’attitude de son époux et inquiète du renfermement de son fils, elle n’a que cet homme suspendu à son bon vouloir avec qui en parler ouvertement. La peinture d’un milieu social – la noblesse, comme souvent chez Assouline – se double d’un suspense psychologique. Etat limite porte bien son titre.
Dans le style classique qu’on lui connaît, Pierre Assouline nous embarque agréablement dans ce récit où affleurent ses centres d’intérêt, à en croire son portrait dans l’Express, comme le goût de la discrétion et des bonnes manières, ou encore ces pages sur la Société sportive du jeu de paume. Dans chacun de ses romans et de ses biographies, au fond, ce qui mène le jeu, c’est la curiosité, le goût des autres et de leur histoire.