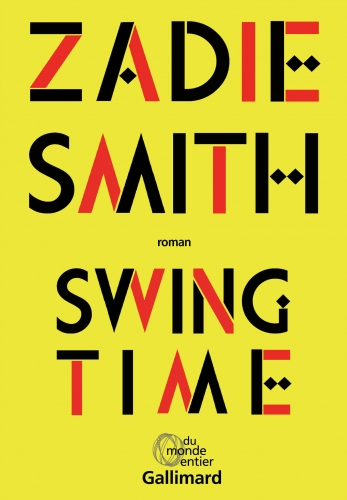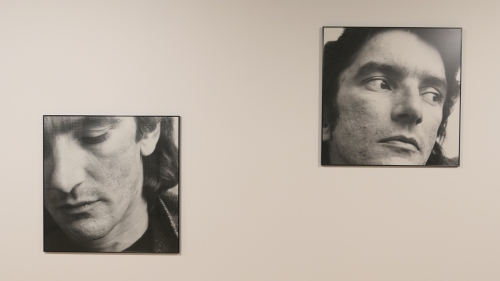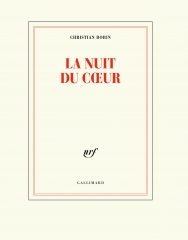Retrouver Zadie Smith avec Swing Time (2016, traduit de l’anglais par Emmanuelle et Philippe Aronson, 2018), c’est retrouver une conteuse attachée à dire les choses de la vie dans tous leurs détails. Ce roman (parfois trop bavard) s’ouvre sur un jour d’humiliation : en 2008, la narratrice, licenciée, est renvoyée en Angleterre. Quand elle revoit à Londres un extrait éblouissant de Swing Time où Fred Astaire danse avec trois silhouettes, elle comprend que c’est lui-même en fait, ce qu’enfant, elle n’avait pas observé. Avec les années, la perception change.
Le récit commence vingt-six ans plus tôt, en 1982, quand elle est encore une petite fille métisse à la peau « marron clair », comme Tracey qui habite une tour pas loin de leur appartement, dans la banlieue nord ouest de Londres, mais dont la mère (blanche) affectionne un style glamour à l’opposé de celui de la sienne (noire) qui prône la sobriété. Toutes deux vont au cours de danse de Mlle Isabel, la fillette au visage long et sérieux en chaussons tout simples alors que la séduisante Tracey aux jolis cheveux bouclés, porte des chaussons de satin.
Leurs familles sont très différentes. Enfant unique, la narratrice peut compter sur un père aux petits soins, sa mère consacrant la plus grande partie de son temps à lire, à étudier. Le père de Tracey est presque toujours absent, elle prétend que c’est un danseur de Michael Jackson. Difficile de rivaliser avec elle, première au cours de danse, alors que la narratrice aux pieds plats aime surtout chanter des airs de comédie musicale.
Elles deviennent amies, se voient beaucoup, jouent et dansent ensemble, puis l’école les sépare, jusqu’à ce que la mère de Tracey décide de l’inscrire à la même école, d’un niveau supérieur. Tracey, « secrète et explosive », s’y fait bientôt remarquer par son insolence et rejeter par les autres, mais elles se retrouvent après l’école pour visionner des séquences de film en boucle et imiter les pas des danseurs.
Swing Time alterne les moments complices et les jalousies d’enfance et d’adolescence avec leur vie d’adultes. Contrairement à Tracey, qu’elle enviait d’être acceptée dans une école de danse, la narratrice, boursière, a obtenu un diplôme universitaire en communication. Elle devient l’assistante personnelle d’une star australienne, Aimee, entourée de toute une équipe vingt-quatre heures sur vingt-quatre : celle-ci l’a prise en amitié quand elle l’a accueillie à Londres pour une chaîne musicale. Sa nouvelle vie l’oblige à une disponibilité totale, au gré des caprices d’Aimee et de ses tournées internationales à grand succès.
A quarante-deux ans, ses enfants confiés à une nounou qui l’accompagne partout, Aimee est incroyablement jeune et énergique aux yeux de son assistante de trente ans qui ne veut pas d’enfants, en bonne héritière de sa mère qui considère la maternité comme un piège. Celle-ci est devenue conseillère municipale, dévouée à l’action sociale et fière de ses racines jamaïcaines (comme sa mère à qui Zadie Smith dédie ce roman).
Aimee chante et danse, rencontre beaucoup de gens, sort la nuit. Son grand projet est de faire construire une école pour filles en Afrique, dans un village sénégalais. C’est là que la narratrice découvre les conditions réelles de la vie des gens ordinaires, pour qui « les choses sont difficiles ici ». Les femmes y travaillent sans cesse. Un jeune enseignant tout vêtu de blanc, Lamin, lui explique les us et coutumes et la bonne manière de se comporter. Elle habite chez Hawa, une enseignante d’anglais.
Ensemble, ils préparent le terrain avant l’arrivée d’Aimee et de son cortège de 4 x 4 – partout où elle se rend, ses assistants ont tout prévu pour que son voyage se passe continuellement dans l’aisance. Préparatifs, contretemps, fêtes, inauguration en grande pompe, il faut sans cesse s’ajuster en tenant compte du grand écart entre la culture des « Américains » (les anglophones d’où qu’ils viennent) et celle des habitants.
Entre-temps, la vie de Tracey connaît des hauts et des bas, les parents de la narratrice divorcent, tandis qu’elle continue, malgré les rivalités dans l’équipe, à « garantir la simplicité de l’existence » d’Aimee. Quid alors de sa vie personnelle ? Sa mère comprend mal qu’elle se contente de vivre dans l’ombre. Elle devient peu à peu plus critique envers son employeuse qui n’hésite pas à s’approprier le travail des autres et abuse parfois de ses amis africains.
La danse, la musique, le spectacle et leurs coulisses occupent une grande place dans la comédie sociale de Swing Time. On s’attache au parcours des deux amies (pour certains critiques, à la manière de L’amie prodigieuse) et à la lente prise de conscience, chez la narratrice, des réalités de la vie. « Ce monde d’ambitions et de convictions qui s’enroule autour d’elle met constamment la narratrice en position, au mieux d’accompagnatrice, sinon d’observatrice. Elle reste cette fille qui se cherche. » (Stéphanie Janicot, La Croix)