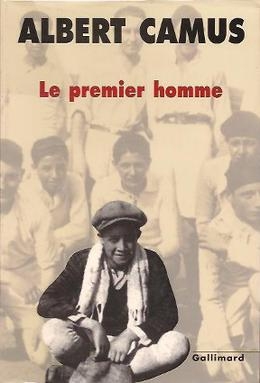Devenir Matisse, la belle exposition du musée Matisse dans la ville natale du peintre, Le Cateau-Cambrésis, vient de fermer ses portes. La semaine dernière, ce parcours dans les années de formation du peintre m’a enchantée : j’y ai vu beaucoup d’œuvres que je ne connaissais pas, peintures et sculptures prêtées par d’autres musées et de collections particulières, en France et à l’étranger.


Deux autoportraits de Matisse (1900 / 1918)
Le Journal de l’exposition est disponible sur le site du musée. Après le rappel des origines et de la révélation qu’a été la peinture pour l’étudiant en droit de vingt ans lors d’une convalescence, on y suit le séjour de Matisse à Paris où il fréquente des académies, des ateliers, des écoles. Ce sont les cours de Gustave Moreau, qui encourage ses élèves à copier les grands maîtres au Louvre, qui vont le faire progresser le plus. Vers 1894, il s’y lie d’amitié avec Evenepoel, dont La petite Matisse (1896), un portrait de sa fille, contraste avec celui que Matisse a fait de son fils Pierre (1909), à la modernité patente. Quelle évolution aussi de son Autoportrait de 1900 à celui de 1918 !

Evenepoel, La petite Matisse, 1896 (Musée Dhont-Daenens, Deurle)
Matisse, Portrait de Pierre, 1909
De deux natures mortes aux livres peintes en 1890, retrouvées dans le grenier de la maison familiale, Matisse dit : « On est dans tout ce qu’on fait, dans ses premières toiles aussi bien que dans ses dernières. » Près de Jeune fille lisant de Corot est accrochée La liseuse de Matisse de 1895, de facture encore classique, qu’on peut comparer à une Etude de Marguerite lisant de 1906 – à nouveau le grand écart entre son travail d’avant et d’après 1900.

Corot, Jeune fille lisant, vers 1868 (National Gallery of Art, Washington)
Matisse, La liseuse, 1895
Il lui a fallu beaucoup de persévérance dans les dernières années du XIXe siècle. A Paris, Matisse a dessiné dans la rue avec Marquet. De belles encres de Chine de l’un et de l’autre montrent des passants, des carrioles, des chevaux, des autoportraits. Ce travail sur le vif les a beaucoup aidés. Aux grands dessins de nus d’académie succèdent de nombreuses copies réalisées au Louvre : des natures mortes, des antiques, puis Chardin, Philippe de Champaigne, Ribeira…

Devenir Matisse, "Les copies au Louvre"

Chardin, La Pourvoyeuse, 1739 (Le Louvre, Paris) / Matisse d'après Chardin, 1896-1903
La grande nature morte de Jan Davidsz. de Heem, La Desserte, que Moreau lui a conseillé de copier, lui donne un mal fou. C’est passionnant d’observer, à côté de la peinture prêtée par Le Louvre, la copie qu’en fait Matisse (Musée Matisse de Nice) et puis la reprise de ce sujet d’une façon tout à fait moderne, presque cubiste, en 1915, « amplifiant la présence des lignes de construction du tableau et s’affranchissant totalement de la réalité » (Journal de l’exposition). De grands bronzes sont présentés de salle en salle : le Louvre a prêté entre autres le magnifique Apollon de Piombino et Jaguar dévorant un lièvre de Barye près de sa copie par Matisse.

Jan Davidsz. de Heem, La desserte, 1640 (149 x 203 cm)

Matisse, Nature morte d'après La Desserte de Jan Davidsz. de Heem, 1915 (MOMA, New York)
Les voyages vont considérablement l’influencer. D’abord en Bretagne, à Belle-Ile-en-Mer, avec son voisin à Paris, le peintre Wéry. Deux vues de Paris peintes dans les années 1900 illustrent un changement radical dans le choix des couleurs, plus lumineuses, avec l’irruption du blanc dans sa peinture. Inspiré par les aquarelles de Turner, les tableaux de Monet, Matisse abandonne la palette des maîtres anciens.

Matisse, Belle-Ile-en-Mer, pochade, 1896 (Collection particulière)

Matisse, Vue de Notre-Dame, 1904 (Collection particulière)
En 1904, « grâce à Signac qui leur trouve une location à bas prix », Matisse découvre Saint-Tropez, puis Collioure. Divisionnisme, fauvisme : « Voici les idées d’alors : construction par surfaces colorées. Recherche d’intensité dans la couleur, la matière étant différente. » Comme en témoignent une petite toile superbe de Manguin (collection particulière), Cavalière, femme endormie ou une aquarelle de Cross, Etude pour le Cap Layet.

Matisse, Paysage de Saint-Tropez au crépuscule, juillet 1904 (Collection de Bueil & Racct-Madoux, Paris)

Henri Manguin, Cavalière, Femme endormie, printemps-été 1906 (Collection particulière)
Que de belles choses à cette exposition, de Matisse et d’autres ! Elle continue au premier étage, avec des portraits, des bronzes, des œuvres d’élèves de Matisse dans la section appelée « La transmission ». Mais l’Académie ouverte un temps par Matisse à Paris, fréquentée surtout par des élèves nordiques, ne durera pas, elle ferme en 1911. Cela lui prend trop de temps et d’énergie, il choisit d’être peintre et non professeur.

Max Weber, Les Baigneuses, 1906 (Collection particulière)

Aperçu de la collection permanente
Retrouver ensuite les Matisse du musée – peintures, dessins, sculptures – est chaque fois un grand plaisir. La collection permanente vaut par elle-même le voyage dans cette ville du Nord où Matisse est cité et illustré de tous côtés. On ne peut quitter le musée Matisse sans revoir la magnifique collection Tériade dont je vous ai déjà parlé (Rouault, Léger, Chagall…). Les restaurants en face du musée affichant complet, nous avons trouvé une table accueillante un peu plus haut, à l’Hostellerie du Marché, qui propose une cuisine fraîche et bio.