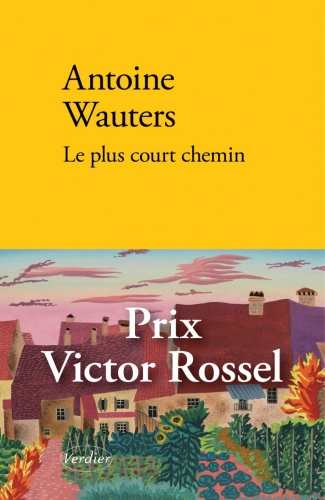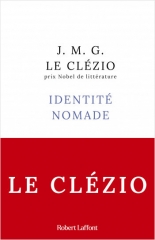De vieilles maisons et leurs jardins vus de l’arrière, l’illustration de la jaquette me rappelle irrésistiblement la maison de ma grand-mère paternelle, les grandes vacances pendant lesquelles nous, enfants de la ville, passions tant de temps à la ferme, où les enfants avaient notre âge. Le plus court chemin, dernier roman d’Antoine Wauters (°1981), prix Rossel 2023, est ma première rencontre avec cet écrivain belge dont Mahmoud ou la Montée des eaux (2021, roman composé en vers libres) a reçu de nombreux prix.
Sans le savoir, après avoir lu Nicole Malinconi, j’ai emprunté à la bibliothèque des livres qui avancent ainsi par fragments, séquences, signés Emma Doude van Troostwijk, J.M.G. Le Clézio, et maintenant Antoine Wauters : un paragraphe par page dans Le plus court chemin, roman autobiographique où tout découle de la première phrase : « J’ai vécu jusqu’à mes dix-huit ans dans un petit village d’Ardenne où mon imagination se trouve encore. »
Ce monde « presque disparu » de son enfance l’a « marqué à vie », l’emplit « et de peine et de joie ». Il écrit pour « ne pas arrêter de faire signe » à celui qu’il a été, à ce temps où son frère jumeau qu’il considérait comme son aîné vivait tout cela avec lui. C’est la campagne : la ferme, les vaches, leur maison dans le bas du village, le bois… C’est sa mère, « fan absolue d’Elvis Presley et des Beatles », qui enseigne les langues, peint, et son père banquier, que tout intéressait.
« On vivait la vie que les gens vivaient alors, une vie où s’il y avait bien une chose qui n’existait pas, c’était l’envie de se mettre en avant », une vie effacée, sobre, sans confort, sans voyages à l’étranger. « Le cri, le tu, le chant, la morsure, le chaos. Et s’il ne s’agissait que de ça ? Tenter de laisser ressurgir, dans tout ce qu’on a écrit, ce que la faculté de nommer nous a pris ? »
A présent l’homme qui écrit entre aujourd’hui et ce temps-là d’avant les études, les livres, les films, les villes, tend vers ce présent-là, « avec le sentiment que les mots sont la seule vraie présence en [lui] ». L’écriture n’est pas une activité, mais « un pays » : « le seul endroit où l’on peut me trouver – et le seul où je me trouve. Partout ailleurs, je n’y suis pas. » Il cite Joan Didion ouvrant son carnet, son « Péage de retour vers le monde d’alors » et commente : « L’écriture comme un raccourci ? Oui. L’écriture comme le plus court chemin. »
Vers ce qu’ils disaient alors, ce qu’ils faisaient là-bas, les oncles flamands, les Pépé, Mémé, Papou, Nénène, sa famille, et lui, avec ses colères et son asthme – « Etrange de passer sa vie à s’effacer, à tracer des signes. Etrange que les gens lisent ces signes comme des signes nous appartenant, alors qu’ils appartiennent à autre chose, à nous en tant qu’oiseaux, rapaces, silex, enfant. »
A présent il a ses propres enfants, une famille qui ont leur place dans le récit, ainsi que son travail d’écrivain chargé de promouvoir ses livres. J’aime ce qu’il dit de la lecture : « Avant d’écrire, je lis, une heure au moins, tous les matins. Je prépare mon cerveau. […] Lire prépare à faire face au bruit général. C’est une armure de sens. Je ne vais nulle part sans avoir lu. »
Ce livre-ci, écrit « sans réfléchir », c’est pour lui comme faire un puzzle sans avoir de modèle, « un mélange de mémoire et d’oubli ». Des noms de village lui reviennent, Antoine Wauters nous en donne à la page 131 une liste de joie toponymique à la JEA – vous vous souvenez ? – qui se termine par « Becco, où nous vivons. »
Le plus court chemin se présente comme un roman, ce qui laisse à l’auteur, sans doute, plus de liberté dans la manière d’évoquer un univers si personnel. Non par nostalgie mais pour une quête plus essentielle. Pour le lire, peu importe d’où l’on est. Ce qui compte, c’est d’entendre une voix, des silences. Ici une enfance se ranime en même temps qu’Antoine Wauters s’interroge, tout du long, sur le sens de ce travail qu’est l’écriture, son chemin pour y aller et pour se retrouver.