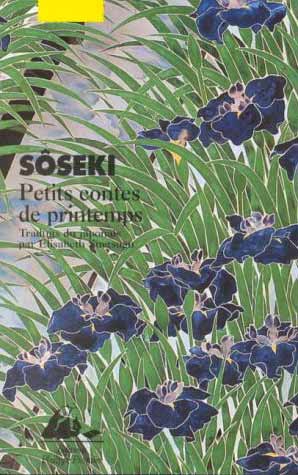« Nous cherchions une maison qui ait du caractère » , a raconté la propriétaire d’une belle demeure schaerbeekoise, à l’angle de la chaussée de Haecht et de la rue de l’Est, qui a accueilli avec amabilité le petit groupe inscrit à la première des « Estivales 2015 » – huitième édition des promenades guidées gratuites proposées tout l’été par l’asbl PatriS, avec le soutien de la commune.
Si souvent, en passant sur la chaussée, j’ai admiré la loggia d’angle et les belles façades de cette maison néo-Renaissance flamande. Aussi je me suis inscrite tout de suite à l’annonce de cette visite guidée organisée jeudi dernier. (Une seconde visite de cette maison est prévue le 3 septembre prochain.)
Emmanuelle Dubuisson, notre guide, rappelle que la rue de l’Est (nom lié à la proximité de l’ancien Observatoire) a été percée à la demande de propriétaires privés, en 1881. A cette époque, la commune attire les bourgeois et les artistes. Ce sont les héritiers Verboeckhoven (Eugène Verboeckhoven, peintre animalier et sculpteur, est mort à Schaerbeek en 1881) qui possèdent le terrain où cette maison va être bâtie et les suivantes, où seront aménagés plusieurs ateliers d’artistes.
Cette grande maison d’angle construite en 1890 pour un avocat (Maître Campioni-Balasse) disposait à l’origine d’un grand jardin, mais durant la première guerre, des voisins s’en sont approprié des parcelles. Juste en face, une maison du même style, avec tourelle d’angle, a été démolie dans les années soixante pour faire place à un immeuble de bureaux. Ici, heureusement, les propriétaires successifs ont résisté aux sirènes du progrès, qui suggéraient même de la remplacer par une station-service !

« Schaerbeek - Rue de l'Est n°2 - 002 » par Lumixbx (Wikimedia Commons)
Pourquoi ce style Néo-Renaissance flamande, avec le mélange des briques rouges et de la pierre bleue, des vitraux et des croisées en pierre ? La visite s’intitule « Plongée dans l’éclectisme » : en façade on voit aussi des éléments néo-gothiques, un pignon en escalier sur le toit, des lucarnes dans le goût pittoresque, ainsi que des épis de faîtage. Au bout des nombreuses travées – la maison est large mais peu profonde – une frise lombarde achève le décor.
Les archives de Schaerbeek ayant brûlé avec l’Hôtel communal en 1911, on attribue cette maison à un architecte formé à Saint-Luc, qui a conçu d’autres belles demeures dans le quartier des squares et travaillé pour de nombreux couvents et églises. Après 1870, les libéraux de la « nouvelle Belgique » appréciaient ce style néo-Renaissance flamande par opposition au style néo-classique français.
Il est temps d’entrer, après avoir appris que le bossage des pierres au bas des murs convient au caractère rustique de l’endroit à la fin du XIXe siècle, c’était encore campagnard. La porte est magnifiquement décorée et garnie de ferronneries d’époque. On monte cinq marches pour accéder au premier niveau d’où on peut admirer les vitraux art nouveau qui encadrent l’entrée, dans des tons orangés, puis les vitraux plus pâles autour de la seconde porte.
Le vestibule a été transformé (confort, chauffage,…) et dans toute la maison, dont l’intérieur aussi est classé aux Monuments & Sites depuis 2004, des éléments qui ne sont pas d’origine ont été intégrés harmonieusement au fil du temps – parfois récupérés dans les chantiers de démolition des belles maisons de maître en pleine période de « bruxellisation ».
Dans le salon de réception qui a conservé son mobilier d’origine, les médaillons des vitraux sont inspirés de tableaux anciens. Les vitraux intérieurs portent aussi des devises, une date : 1831, des motifs illustrant les quatre saisons. Sous le plafond à caissons (dont la peinture s’écaille en attendant un budget de restauration), des poutres se terminent par les têtes sculptées des archiducs Albert et Isabelle.
Toutes les pièces visitées portent des lambris d’origine. De l’autre côté de l’entrée, après un charmant petit bureau, un grand salon de musique, pièce d’angle très lumineuse a des vitraux refaits dans les années 60, portant le blason azur et or de la famille Scribe (deux plumes croisées, quatre escargots), et sur une fenêtre rue de l’Est, un blason de réemploi non identifié qui m’a intriguée, montrant sous une couronne, un oiseau noir avec un anneau d’or dans son bec, juché sur un fer à cheval. Comme les murs peints de ramages et de couronnes de ce salon, ceux de la belle cage d’escalier, éclairée par une verrière à décor floral, ont conservé leur peinture d’origine, de très beaux tons rouge cuivre.
On découvre à l’étage les pièces d’habitation familiale, le salon à l’angle avec ses vitraux refaits sur le modèle d’origine, sa loggia, et une belle cheminée en bois récupérée dans un château – le bois est présent partout dans la maison : les lambris, les parquets dont les motifs varient de pièce en pièce.
Des murs clairs mènent à une jolie cuisine toute en longueur, équipée à la manière actuelle en face des vitraux, avec un coin à manger – tout ce qu’il faut pour une famille ; elle a été conçue en harmonie avec le lieu, la cheminée ancienne. Les cuisines d’origine, comme autrefois à Bruxelles, se trouvaient en cave, reliées au rez-de-chaussée par un monte-plats.
Ensuite on accède à une chambre qu’habite également un chat roux, endormi en rond sur le couvre-lit blanc. Placide, il ne semble pas vite dérangé, accepte même quelques caresses. La cheminée – chaque pièce a la sienne – est imposante, une grande tapisserie d’époque agrémente le décor.
Cette maison qui donne l’impression de voyager dans des temps anciens est contemporaine de la maison Autrique, construite en 1892 par Horta à deux pas d’ici. Un choix architectural et esthétique très différent. Débordant du temps prévu pour la visite, la propriétaire a bien voulu confier les avantages et inconvénients d’habiter une maison classée. Le plus inattendu, ce sont les coups de sonnette d’inconnus qui se croient à la maison communale !