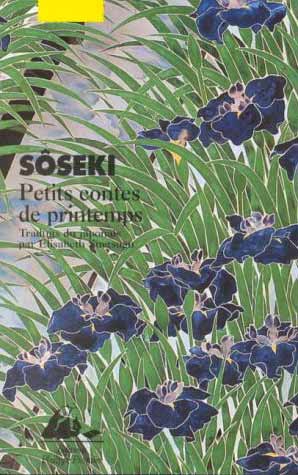C’est en 1909 que Sôseki écrit les Petits contes de printemps (traduits du japonais par Elisabeth Suetsugu), de janvier à mars, en feuilleton pour un journal. A quarante-trois ans, il a déjà publié Je suis un chat et aussi Botchan, entre autres. Ce recueil de vingt-cinq textes courts (le plus long compte sept pages) livre comme des « fragments de journal intime » : « la tonalité de chacun est différente, tantôt intime et familière, tantôt d’une drôlerie délicate, étrange, ou encore empreinte de nostalgie » (quatrième de couverture).
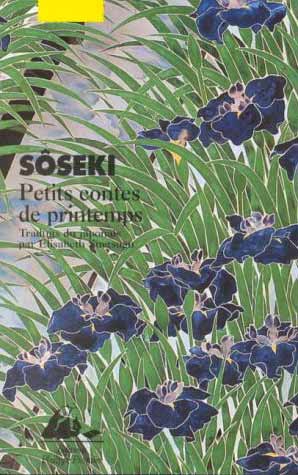
En couverture, un détail d’une peinture de Heihachiro Fukuda (1892-1974)
« Jour de l’an » raconte la visite que lui font quelques jeunes gens vêtus comme d’habitude sauf un, venu en redingote, puis de Kyoshi (poète et ami) en tenue de cérémonie : « haori noir et kimono noir aux armes de sa famille, on n’en attendait pas moins de lui ». Comme celui-ci pratique le nô, il propose à Sôseki de chanter. L’écrivain réalise que sa voix devient incertaine, ce que confirment ses hôtes : « La redingote notamment déclara que j’avais une voix chevrotante. » Il faut lire comment se poursuit cette séance de chant, l’encens pour l’un, les quolibets pour l’autre, jusqu’à cette conclusion : « Pour ma part, tant la nuance des manches de Kyoshi que leurs ondulations pendant qu’il jouait, m’ont laissé totalement froid. »
Une étrange rencontre – un serpent, une voix – lors d’une sortie de pêche avec son oncle sous la pluie, un vol de ceintures brodées, la ruse d’une petite-fille nommée Kii-chan pour se venger de la méchanceté d’un petit voisin, les sujets sont les plus divers. Sôseki anime des scénettes de la vie quotidienne, campe rapidement le décor, et nous, lecteurs, nous regardons, nous écoutons, comme si nous y étions.
Un jour de neige et de grand froid, son fils de deux ans pleure quasi sans discontinuer. Avec les pleurs de l’enfant, le froid, Sôseki se sent incapable de travailler – « je n’ai le cœur à rien, et je n’arrive pas à éloigner mes mains du brasero » – et en plus, sa femme ou un visiteur imprévu ne cessent de le déranger. Il lui faudra attendre le soir pour retrouver le silence et la paix. (Le brasero)
L’écrivain raconte aussi des souvenirs, notamment d’un séjour à Londres en 1900 : « La pension », « L’odeur du passé », « Impressions », « Brouillard »... Ou de son enfance, quand un élève a osé se lever pour corriger au tableau le caractère « ki » écrit par le maître au début d’un mot – c’est lui, bien sûr. (Le 11 février)
L’art du conteur se révèle dès la première phrase : « Depuis notre installation à Waseda, le chat s’est mis à dépérir à vue d’œil. » (La tombe du chat) ; « O-Saku avait-elle été trop matinale, toujours est-il qu’elle s’agitait en tout sens en répétant : « La coiffeuse n’est pas encore arrivée ? Elle n’est toujours pas là ? » » (L’être humain) ; « Hors d’haleine, je me suis arrêté et j’ai levé la tête : déjà, des étincelles passaient au-dessus de moi. » (L’incendie)
Dans ses Petits contes de printemps, l’écrivain japonais glisse ses préoccupations de tous ordres, y compris ses maux d’estomac, et surtout une fine observation des êtres humains. L’humour, l’inquiétude, toutes les émotions sont rendues avec justesse et pudeur. Et aussi avec poésie, comme lorsqu’il regarde un oiseau dans l’air printanier – un moment d’émerveillement. (Les replis du cœur)
 « D’un seul battement d’ailes, l’oiseau vola jusque sous l’appui de fenêtre. Il resta un moment sur la fine branche d’un grenadier, mais on le sentait apeuré. Deux ou trois fois, il changea de position ; dans le mouvement qu’il fit, il m’aperçut accoudé à la balustrade, et s’envola soudain. J’eus à peine le temps de me dire que le haut de la branche avait bougé, légère comme de la fumée, que l’oiseau avait posé ses pattes délicates sur un des barreaux de la balustrade.
« D’un seul battement d’ailes, l’oiseau vola jusque sous l’appui de fenêtre. Il resta un moment sur la fine branche d’un grenadier, mais on le sentait apeuré. Deux ou trois fois, il changea de position ; dans le mouvement qu’il fit, il m’aperçut accoudé à la balustrade, et s’envola soudain. J’eus à peine le temps de me dire que le haut de la branche avait bougé, légère comme de la fumée, que l’oiseau avait posé ses pattes délicates sur un des barreaux de la balustrade.