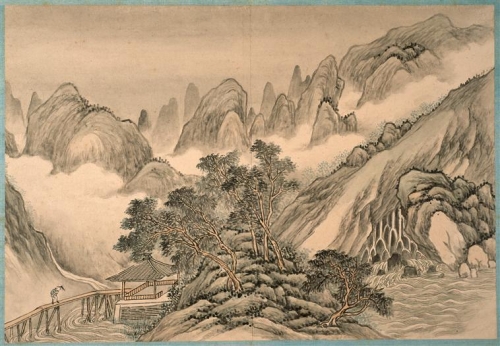Depuis longtemps, quand je vois jouer Isabelle Carré dans un film, elle m’intrigue, toute à son rôle et pourtant avec quelque chose de plus, d’indéfinissable, qui laisse deviner derrière un sourire, une espièglerie ou un regard une grande sensibilité. Aussi ai-je été attentive dès que j’ai appris la publication de son premier roman. Les Rêveurs, ce sont ses parents, et elle-même. Isabelle Carré lève un peu le masque sur une enfance, une famille où il ne lui a pas été facile de grandir. En épigraphe, une phrase d’Aragon : « Le roman, c’est la clé des chambres interdites de notre maison. »

Ses rêves sont parfois des cauchemars, comme celui, récurrent, de sa mère poussant un landau et ne faisant pas attention à elle, la fillette qui a lâché sa main, sans s’inquiéter de la perdre. Sans transition, retour en arrière, à Pantin, où les parents de sa mère l’avaient installée pour cacher une grossesse indésirable. A seize ans, dans les années 60. Pas question de se montrer dans Paris, où quelque connaissance pourrait la reconnaître et ruiner la réputation de la famille ; l’enfant sera proposé à l’adoption, point final.
Mais la jeune femme, déçue du garçon qui l’a mise enceinte, désobéit, va voir une amie, rencontre chez elle un étudiant des Beaux-Arts bientôt prêt à l’épouser et à garder cet enfant avec elle. Sa famille sera furieuse. Après l’accouchement, elle va vivre avec lui. – « Cette histoire est bien réelle et j’en connais chaque instigateur. » Ce n’est que quelques années plus tard, quand leur mère aura de nouveau accès au château de ses parents, que son frère et elle découvriront le cadre où elle a grandi.
« Loin d’eux, nous vivions autrement. » Chez eux, les murs sont rouges, les plafonds colorés, le grand appartement est plein d’objets de toutes sortes, de collections, de tableaux crus du père, de musique. Isabelle joue avec son frère aîné et avec le petit frère ; le dimanche, ils vont tous à Orly regarder les avions. Mais la mère a des absences, elle ne mange plus, elle souffre de dépression, parfois elle va mieux. Le père se teint les cheveux, soigne son corps, ouvre une agence de design. C’est un homme pressé. Isabelle rêve d’une famille « classique, banale ».
A quatorze ans – pas d’ordre chronologique dans Les Rêveurs, des séquences entre lesquelles on perçoit vite le lien – l’adolescente se retrouve à l’Hôpital des Enfants malades après une tentative de suicide aux médicaments. Elle s’y fait une amie, repousse un amoureux, souffre du manque d’air dans sa chambre à double fenêtre. Les enfants obtiennent le droit de sortir pour fumer, le droit de danser une heure par jour. C’est là, en entendant Romy Schneider dire, dans Une femme à sa fenêtre, qu’elle préfère « les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort », qu’Isabelle a pour la première fois l’idée de faire du théâtre ou du cinéma.
Après sa sortie, elle ira au cinéma tous les deux jours. Elle s’identifie aux actrices, reprend les mots de Charlotte Gainsbourg dans La petite voleuse : « C’est toujours vrai, je fais du cinéma pour qu’on me rencontre ou plutôt pour rencontrer des gens. » A travers toutes ces vies imaginaires, elle s’exerce « à ne plus avoir peur » de la sienne. Son rêve de rencontrer des gens se réalise sur les tournages, sur les planches, mais il est rare qu’on se revoie une fois que c’est fini : « Alors je m’offre une seconde chance, j’écris pour qu’on me rencontre. »
La mésentente de plus en plus grande entre ses parents débouche sur une séparation et une révélation : son père est « viré » par sa mère parce qu’il est « homo, pédé », il l’annonce brutalement à ses enfants, qui en décèlent après coup les signes avant-coureurs. Le frère aîné ira vivre avec le père et son compagnon, Isabelle et le petit frère restent avec leur mère, mais celle-ci est trop triste, trop indifférente : Isabelle fêtera ses quinze ans dans un petit appartement meublé chez Ikea où son père l’installe et lui rend visite avec Alice, qui s’est ajoutée au duo.
Alice devient une amie, presque la sœur dont elle rêvait, mais le soir, seule, l’adolescente a peur, dans son appartement en désordre. Et puis Alice s’en va, le père se sépare, déprime. Quand ils vont ensemble à la montagne, Isabelle trouve refuge auprès des arbres, comme dans le bois près de chez ses grands-parents où elle s’était cachée pendant des heures mais où personne n’est venue à sa recherche.
Son frère rêvait de rencontrer son père biologique ; quand il y arrive, malgré qu’ils se ressemblent, son rêve d’un père idéal se fracasse. Isabelle rêve d’« un endroit où aller », où elle se sente chez elle, aimée. Mais comme son père le disait, « On ne réussit bien que dans ses rêves ». Aux cours de danse, elle a échoué à devenir la danseuse qu’elle rêvait d’être, « le théâtre est un lot de consolation merveilleux ».
On lit dans Les Rêveurs des scènes et phrases fortes sur le sentiment d’abandon, le manque d’appui, des moments heureux aussi. Ce roman – puisqu’elle raconte « ce qu’elle sait » et invente le reste – est écrit par « une actrice connue que personne ne connaît ». Sa part « discrète et lumineuse » n’est que « la partie émergée de l’iceberg ». Isabelle Carré écrit depuis ses onze, douze ans, elle cite certains extraits de sa trentaine de cahiers.
« Mon récit manque d’unité, ne respecte aucune chronologie, et ce désordre est peut-être à l’image de nos vies, en tout cas de la mienne, car il existe certainement des gens capables d’ordonner la leur. Toutes les époques subsistent en nous à la façon des matriochkas, c’est sans doute pourquoi, malgré l’expérience et les connaissances accumulées, nos propres réactions, parfois si infantiles, continuent de nous surprendre. »
Née en 1971, Isabelle Carré a trouvé au théâtre et au cinéma les « cadres » dont elle a besoin. Dans Les Rêveurs, un roman-récit qui n’a rien de convenu ni de posé, elle revient sur le mal d’enfance, l’amour qui a manqué, l’amour qui a été donné, les batailles pour « vivre » et garder l’équilibre. On imagine que pour ses trois enfants, elle est une mère formidable, Isabelle. On aimerait la rencontrer.
 « Au bout de tout, voici ce que j’ai saisi : la vraie vie n’est pas seulement ce qui a été donné comme existence ; elle est dans le désir même de vie, dans l’élan même vers la vie. Ce désir et cet élan étaient présents au premier jour de l’univers. Au niveau de chaque être cependant, ils sont fondés sur ce que son âme – par-delà les épreuves, les souffrances, les chagrins, les effrois, les blessures reçues ou infligées aux autres – aura préservé de sensations éprouvées, d’émotions vécues, d’inlassables aspirations à un au-delà de soi, de soifs et de faims aussi infinies que le besoin sans borne d’amour et de tendresse. »
« Au bout de tout, voici ce que j’ai saisi : la vraie vie n’est pas seulement ce qui a été donné comme existence ; elle est dans le désir même de vie, dans l’élan même vers la vie. Ce désir et cet élan étaient présents au premier jour de l’univers. Au niveau de chaque être cependant, ils sont fondés sur ce que son âme – par-delà les épreuves, les souffrances, les chagrins, les effrois, les blessures reçues ou infligées aux autres – aura préservé de sensations éprouvées, d’émotions vécues, d’inlassables aspirations à un au-delà de soi, de soifs et de faims aussi infinies que le besoin sans borne d’amour et de tendresse. »