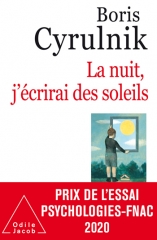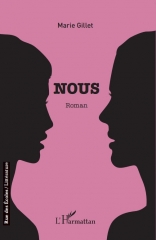« Marcher, c’est écouter, suivre une trace, sentir la douceur de la terre ou l’arête des pierres, boucler une boucle, aller en ligne droite ou faire un détour, chercher le chemin, trouver le chemin, revenir en arrière, repartir en avant… […] » Ainsi commence Aussitôt que la vie de Marie Gillet, qui vient de paraître.

Entre ciel et terre (source)
Ce journal d’une marcheuse « entre Maures et Garlaban » en Provence, tenu durant le mois de février, est écrit « sur le tracé des mots », ceux qu’elle note dans son carnet « promeneur » – écrire et marcher sont inséparables pour la narratrice. Cette amoureuse des carnets précise qu’ils « ne servent pas pour la nostalgie seulement mais pour l’action d’écrire », ce sont « des herbiers de mots, des dictionnaires personnels, des bibliothèques de traces ».
Des listes de mots à propos des fleurs, des arbres, des couleurs, aident à raconter le chemin, les imprévus, les paysages. Marie Gillet se promène « sur la colline et au-delà », comme indiqué en sous-titre : des phrases naissent ensuite de ses pas, où réapparaissent les mots des listes, balises pour rendre ce qu’elle a ressenti tout du long.
Ce sont les observations d’une visuelle qui aime nommer les choses du monde vivant avec justesse (le blog Bonheur du jour en témoigne à sa façon). La promeneuse ne se limite pas à décrire. En avançant, elle marche avec ceux envers qui elle se sent redevable, par-delà les souffrances de son enfance. Le mistral ravive des souvenirs : « Dès que j’ai habité chez Mètou, j’ai appris à vivre comme on vit ici : avec le vent. »
« Pendant longtemps, j’ai aimé sans me poser trop de questions cette nature que j’ai beaucoup fréquentée plus pour moi-même que pour elle. » A présent, la marcheuse regarde la nature autrement, attentive à la palpitation des choses, se refusant à cueillir quoi que ce soit, à prendre des photos, tout entière disponible pour les rencontres et les éblouissements du jour.
Enfant, elle a beaucoup appris en accompagnant « le Chef ». Quand elle a pu se promener sans lui, elle lui rapportait des « butins » dans l’espoir d’un « satisfecit ». Elle ne connaissait pas encore la joie de marcher tranquillement, « gratuitement, pour le plaisir, pour la beauté du monde ». Le bonheur de répondre librement à l’appel du dehors, du champ, de la colline, des arbres.
Le chêne occupe une place maîtresse dans la mémoire de celle qui a grandi en Ile de France. Après son installation dans le Var, près de Toulon, elle a découvert le chêne kermès, le chêne-liège et surtout le chêne vert au doux nom de « yeuse ». Là où elle vit, la couleur bleue, la préférée, offre tant de nuances qu’elle cherche toujours comment nommer exactement « le bleu du ciel et le bleu de la mer ». Le mot « azur » ne suffit pas.
« L’air était pur et calme. Il allait faire très beau. Rien ne s’opposerait à la lumière. ». Dans le sac à dos de la marcheuse, en plus du carnet, il y a toujours un livre, pour accompagner les pauses, les moments de contemplation. Le texte s’interrompt parfois pour de courtes citations, comme cette troisième strophe des Arbres d’Yves Bonnefoy (dans Ce qui fut sans lumière) où bat le cœur du récit.
Aussitôt que la vie doit son titre à un passage de l’Odyssée dont Marie Gillet s’est souvenue devant « une immense prairie d’asphodèles » sur une terre brûlée par un incendie deux ans auparavant. Là aussi – dans le texte et devant les fleurs – les mots vibrent, indiquent une direction : laisser derrière soi ses propres enfers pour aller vers la lumière.
Voici une œuvre d’une profonde sérénité, d’un grand calme intérieur, en contraste avec la tension dramatique de Nous, long roman d’un conflit familial. Tout en mouvement, regard, mémoire, accueil de ce qui se présente et méditation, Aussitôt que la vie est aussi, d’une autre manière, le journal d’une résiliente. En quelque deux cents pages, Marie Gillet nous invite à regarder la beauté où qu’elle soit et à retrouver dans la nature un chemin de vie.
 « J’avais devant moi une image parfaite du printemps : un magnifique vieux pommier en fleurs au milieu d’un pré d’un vert éclatant. J’étais heureuse de pouvoir éprouver cette joie de le voir et de n’en être point blasée. Cette beauté était là avant que j’arrive et si je n’étais pas venue, elle aurait quand même existé parce qu’elle est une vie en elle-même : les fleurs qui deviendront des fruits, les abeilles butinant pour nourrir leur reine féconde, emportant du pollen ailleurs et tout ce qui va avec, les saisons qui s’écoulent, la pluie, le vent, le soleil, les oiseaux, cette vie à laquelle je n’ai pas d’autre part que la contemplation. J’ai repris la marche mais sans me presser pour l’aller voir de près. Je me suis arrêtée à quelques pas pour le saluer encore, de loin encore, comme on le faisait à la Cour pour le Roi. »
« J’avais devant moi une image parfaite du printemps : un magnifique vieux pommier en fleurs au milieu d’un pré d’un vert éclatant. J’étais heureuse de pouvoir éprouver cette joie de le voir et de n’en être point blasée. Cette beauté était là avant que j’arrive et si je n’étais pas venue, elle aurait quand même existé parce qu’elle est une vie en elle-même : les fleurs qui deviendront des fruits, les abeilles butinant pour nourrir leur reine féconde, emportant du pollen ailleurs et tout ce qui va avec, les saisons qui s’écoulent, la pluie, le vent, le soleil, les oiseaux, cette vie à laquelle je n’ai pas d’autre part que la contemplation. J’ai repris la marche mais sans me presser pour l’aller voir de près. Je me suis arrêtée à quelques pas pour le saluer encore, de loin encore, comme on le faisait à la Cour pour le Roi. »