Son arrestation le 10 janvier 1944 à l’âge de six ans, alors enfant juif sans le savoir, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik y revient régulièrement dans ses livres et quand on l’invite à prendre la parole, comme encore à La Grande Librairie le 16 mars dernier. Il en avait déjà été l’unique invité en avril 2019 pour La nuit, j’écrirai des soleils.

Boris Cyrulnik parle résilience dans « La nuit j’écrirai des soleils » - YouTube
La Grande Librairie, 19/4/2019
Pourquoi tant d’enfants orphelins, d’enfants négligés ou rejetés, sont-ils devenus écrivains ? Quel rôle a joué pour eux l’écriture ? C’est le sujet de cet essai, tourné vers la mémoire traumatique de l’enfance et vers la résilience, concept qu’il a considérablement vulgarisé même s’il n’en est pas l’inventeur. « On parle pour tisser un lien, on écrit pour donner forme à un monde incertain, pour sortir de la brume en éclairant un coin de notre monde mental. Quand un mot parlé est une interaction réelle, un mot écrit modifie l’imaginaire. »
Cyrulnik s’attache à montrer comment la « niche sensorielle » d’un nouveau-né, le corps de sa mère ou une autre « figure d’attachement » (père, grand-mère, tante…) peut être altérée par toutes sortes de malheurs « qui ne sont pas rares dans l’aventure humaine ». De grands romans ont témoigné des carences affectives qui en résultent. Le cas de Jean Genet, bébé abandonné puis placé dans une gentille famille, est un de ceux sur lesquels Boris Cyrulnik revient volontiers, pour montrer la complexité des parcours. Lui-même sans famille depuis le début de la seconde guerre mondiale, il croit que ses premiers mois de vie ont été bien entourés et lui ont donné un socle plus fiable.
« Dans un même contexte de carence affective, certains enfants parviennent à se nourrir d’un minuscule indice émotionnel alors que d’autres, pour obtenir le même résultat, auront besoin de tonnes de nourritures affectives pour être rassasiés. » Villon, Rimbaud, Verlaine : « Les voyous littéraires, avec leurs jolis mots et leurs histoires tragiques, métamorphosent l’horreur. Ils la transforment en beauté quand ils déposent des pépites verbales dans la fange du réel. »
Après s’être ennuyé durant ses études à Paris où il vivait dans une « solitude sordide », Cyrulnik rêvait – la rêverie étant son grand refuge – d’un avenir où il serait médecin, « un métier tellement utile que tout le monde [l’] accepterait ». De chapitre en chapitre, il approfondit son analyse du développement affectif et neuronal de l’enfant, décrit ce qui se passe et comment certains réagissent en recréant leur monde alors que d’autres ne s’en sortent que par la transgression.
Suffirait-il d’écrire pour ne plus être malheureux ? Ce serait trop simple. Outre sa propre expérience, Boris Cyrulnik évoque de nombreux écrivains et artistes – Perec, Charles Juliet, Romain Gary, Anne Sylvestre, Depardieu, par exemple –, mais ils sont bien plus. Il s’attache à décrire comment l’enfant accède aux mots, comment la fiction peut donner une forme réelle à notre imaginaire, notre besoin de sens.
« Quand le malheur entre par effraction dans le psychisme, il n’en sort plus. Mais le travail de l’écriture métamorphose la blessure grâce à l’artisanat des mots, des règles de grammaire et de l’intention de faire une phrase à partager. » Le sujet de La nuit, j’écrirai des soleils, est développé en spirale : je veux dire par là que Cyrulnik raconte un parcours, passe à un autre, témoigne pour lui-même, revient en approfondir certains. Sa logique est de montrer les enjeux, à chaque étape.
Nicole Bétrencourt rend compte sur son blog des éléments scientifiques exposés par Boris Cyrulnik dans cet essai, bien mieux que je ne pourrais le faire, voici le lien vers Un autre regard sur la psychologie. Pour ma part, j’ai été surtout attentive à la manière dont l’auteur approche la littérature de son point de vue particulier, se penche sur des parcours d’écrivains ou analyse le rôle de l’écriture qui, dans son cas personnel, lui a permis de raccommoder son « moi déchiré ».
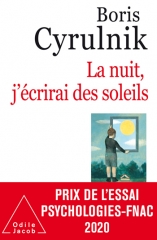 « Nous ne sommes pas maîtres du sens que nous attribuons aux choses, mais nous pouvons agir sur le milieu qui agit sur nous et façonne les sentiments qui donnent du sens aux choses. Le récit de soi qui donne une forme verbale à la manière dont on ressent les événements dépend de son articulation avec les récits d’alentour, familiaux et culturels. Comme le sujet n’arrête pas de vieillir et comme les expériences de sa vie modifient sans cesse sa manière de voir les choses, comme les familles ne cessent de changer avec les mariages, les naissances et les morts, comme les cultures ne cessent de débattre, d’envisager les problèmes différemment et comme la technologie est en train de provoquer une évolution culturelle fulgurante, vous pensez bien qu’il est impossible de ne pas remanier, de ne pas voir autrement la représentation de son passé. »
« Nous ne sommes pas maîtres du sens que nous attribuons aux choses, mais nous pouvons agir sur le milieu qui agit sur nous et façonne les sentiments qui donnent du sens aux choses. Le récit de soi qui donne une forme verbale à la manière dont on ressent les événements dépend de son articulation avec les récits d’alentour, familiaux et culturels. Comme le sujet n’arrête pas de vieillir et comme les expériences de sa vie modifient sans cesse sa manière de voir les choses, comme les familles ne cessent de changer avec les mariages, les naissances et les morts, comme les cultures ne cessent de débattre, d’envisager les problèmes différemment et comme la technologie est en train de provoquer une évolution culturelle fulgurante, vous pensez bien qu’il est impossible de ne pas remanier, de ne pas voir autrement la représentation de son passé. »

