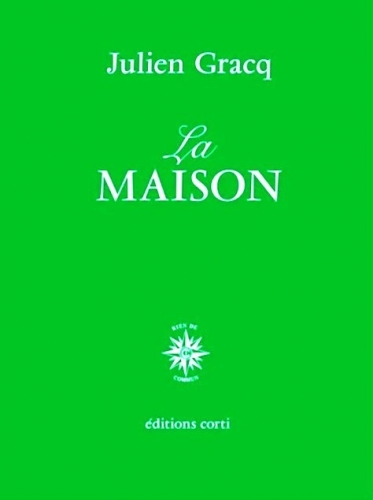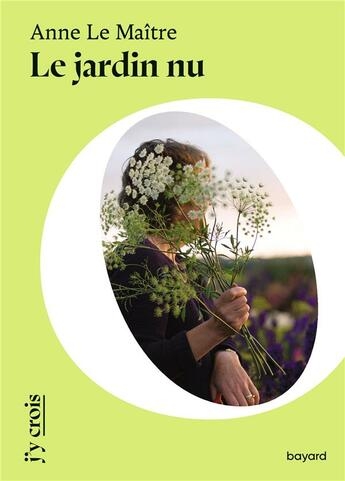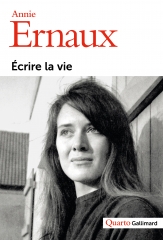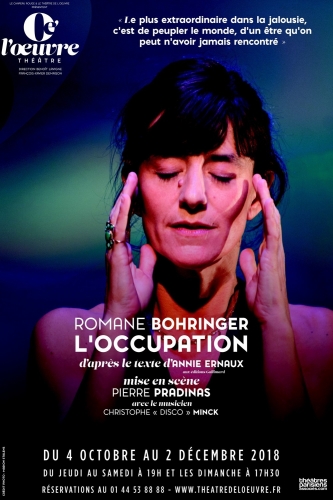Avec La maison, un inédit de Julien Gracq publié cette année, on entre en même temps dans le texte et dans un paysage. Durant l’occupation allemande, le narrateur prenait régulièrement l’autocar pour aller de V… à A… et remarquait à chaque fois « une tache lépreuse au milieu du paysage bocager, une étendue de campagne remarquablement hostile et déserte ».
L’auteur cherche à décrire au plus juste cette sorte de « friche » où son regard était attiré par une « construction inattendue » à trois ou quatre cents mètres de la route, de loin pareille à une villa de plaisance de second ordre, à l’abandon. Une après-midi de novembre fraîche et pluvieuse, une panne de moteur avait immobilisé le car ; l’envie lui était venue d’aller jeter « un simple coup d’œil à la bâtisse » malgré la pluie et le soir qui tombait déjà.
Ce qui fascine, chez Gracq, c’est le style : le choix des mots, leur ordre dans la phrase, le rythme. (Le plan du récit d’abord intitulé « La maison du taillis », puis le premier et le second état du manuscrit reproduits après le texte montrent combien il retravaillait le texte.) Avec le narrateur, on perçoit la lumière qui baisse, les bruits qui rompent le silence, les sensations de la marche dans les taillis « gorgés d’eau » d’où il n’aperçoit plus la maison, la tristesse ressentie qui le transforme en « statue glaiseuse et enfondue de l’écœurement ».
« Sur le fond de mon humeur très sombre, bien plutôt et même avant qu’elle ensoleillât la lande, il se fit tout à coup dans le plein sens du mot une embellie. » Le voilà tout à coup dans « un autre monde », à quelques pas de la maison. L’impression de ruine s’éloigne, la façade paraît « éteinte plutôt que morte ». Malgré l’impression d’abandon, il y guette des signes de vie. A l’arrière, des traces de présence « immédiate et toute proche » le font reculer, par discrétion.
Je n’en dirai pas plus sur la manière dont le récit glisse de la description narrative du début vers autre chose qui se manifeste au visiteur curieux. Comme sous l’effet d’un charme, un « éveil » plutôt qu’un rêve, la maison devient une sorte de théâtre par la magie des choses vues et entendues.
Dans la postface, Maël Guesdon et Marie de Quatrebarbes (à la tête des éditions Corti) rappellent que quatre-vingt-cinq ans séparent la publication d’Au château d’Argol (que je n’ai pas lu) et celle de La maison. Ils voient le texte comme « un pont (…) jeté à travers l’œuvre publiée. » J’ai trop peu lu Gracq pour en juger, mais j’ai apprécié leur fine analyse de ce court récit littéraire, « un concentré lumineux de littérature » comme l’écrit Jean-Philippe Cazier (Diacritik). Merci à celle qui m’a fait la grâce de cette surprise amicale dans ma boîte aux lettres.