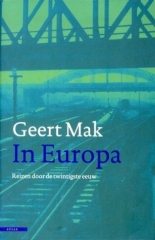Arrivée à la page 515 du Voyage d’un Européen dans le XXe siècle, j’ai parcouru avec Geert Mak les années 1900-1942 d’Amsterdam à Vienne, de Vienne à Versailles, de Stockholm à Riga, de Berlin à Vienne, de Predappio à Munich, de Fermont à Londres, de Berlin à Moscou. De janvier à juillet 1999 (soit 7 chapitres sur 12), l’auteur s’est rendu chaque mois dans quatre à six villes, à la recherche des traces laissées par l’histoire.

Exposition universelle, Paris, 1900 (source)
Avant chaque chapitre, il indique son itinéraire sur une carte de l’Europe telle qu’elle se présentait à l’époque. Dans sa valise, « un ordinateur portable, un téléphone mobile pour transmettre [sa] chronique quotidienne au journal, des affaires de toilette, quelques chemises, le CD-ROM de l’Encyclopædia Britannica et une bonne quinzaine de kilos de livres pour [se] passer les nerfs. »
Autour de 1900, l’Europe, c’est « l’insouciance de l’Exposition universelle à Paris », la reine Victoria, « souveraine d’un empire de certitudes » et Berlin « en pleine ascension ». Avant de se mettre en route, Mak s’est entretenu avec Marinus van der Goes van Naters, né en 1900, pour l’entendre sur les changements qu’il a connus. L’homme tire de sa bibliothèque un livre paru en 1890 dont il discutait avec ses amis : Cent ans après ou l’An 2000 d’Edward Bellamy : l’utopie d’un monde parfait, d’un « siècle doré ».
L’histoire ici est un voyage, une exploration de ce qui fut à partir de ce qui est visible (ou pas), avec le concours de témoins, de textes d’écrivains mais aussi de journaux, de correspondances, d’extraits de discours, choisis pour la pertinence avec laquelle ils parlent de leur temps ou parfois se fourvoient complètement. Sur place, l’historien visite les musées, les monuments et les lieux de mémoire, cherche les traces visibles des conflits passés, rencontre des personnes qui s’en souviennent, parfois des descendants de ceux qui se sont engagés activement.
Un « court extrait filmique du Derby de juin 1913 » fait apparaître le nom d’Emily Davison, la suffragette britannique qui a payé de sa vie son engagement en faveur du vote des femmes. Nombreuses sont les Européennes à qui Geert Mak réserve une place non anecdotique, comme Käthe Kollwitz, « femme sculpteur, caricaturiste » dont il cite le Journal tenu à Berlin au début du siècle. Cela aussi, c’est une manière contemporaine de lire l’histoire, sans ignorer la moitié du monde comme le faisaient trop souvent nos livres scolaires.
Ce n’est pas seulement d’une capitale à l’autre que l’auteur se déplace, en Europe et même jusqu’à Constantinople. Voyage d’un Européen à travers le XXe siècle nous emmène dans des lieux moins connus, comme Doorn, par exemple, dans la province d’Utrecht, où Guillaume II s’exila en 1919, après la première guerre mondiale qui mit fin à son empire.
1914-18. Ypres, en février 1999, a « l’air d’une ville ancienne comme les autres », bien que reconstruite presque entièrement. Bataille après bataille. Verdun, « le hachoir ». Moments de répit au milieu des atrocités. La grippe espagnole en 1918 fera davantage de morts encore. Dans l’Europe réorganisée, les Allemands ne digéreront pas la défaite.
En 1917, l’Allemagne s’intéressait aux révolutionnaires « susceptibles d’empoisonner la vie de ses ennemis » et après la révolution russe de février, a autorisé Lenine, le chef des bolcheviks, à rentrer au pays (train Zurich-Petrograd) et lui a procuré des fonds énormes qui lui permettront, en huit mois, de prendre la tête de la révolution d’octobre pour donner « tout le pouvoir aux soviets ».
Que c’est intéressant de suivre l’histoire non seulement à l’Ouest, mais aussi à l’Est. De 1918 à 1920, Kiev, la capitale de l’Ukraine, a changé seize fois de régime ! (Je repense à Lviv, dans le magistral Retour à Lemberg de Philippe Sands.) Après le krach boursier de 1929, coup fatal pour l’économie allemande, le parti national-socialiste devient le deuxième parti d’Allemagne. Année après année, Mak décrit l’émergence de la seconde guerre mondiale.
Saviez-vous que déjà dans les années 1930, le régime hitlérien avait pratiqué l’euthanasie des handicapés par gazage, sans grande résistance ? A Predappio, ville natale de Mussolini, on continue à faire commerce d’objets fascistes. La fin des livraisons d’armes soviétiques (vendues au prix fort par Staline) a sonné le glas de la guerre d’Espagne.
1939-1945. Geert Mak raconte les faits marquants, explique les causes et les conséquences, décrit les personnalités (Churchill, Staline), continue ses allers-retours dans le temps (il visite à Londres la « Britain at War Experience », une expo immersive). Je découvre Zamosc, petite ville du sud-est de la Pologne, dont les nombreux habitants juifs furent exterminés et les autres habitants chassés pour former la première colonie SS.

Expulsion des Polonais des villages de la région de Zamość par les SS en décembre 1942 (Wikimedia)
De l’antisémitisme à l’Holocauste : qui savait ? qui ne voulait pas savoir ? Tous les Etats n’y ont pas prêté la main – refus net du Maroc et de la Bulgarie. Geert Mak fait les comptes et décomptes, analyse les causes. Erreurs militaires, erreurs politiques, idéologies au nom du peuple et contre les populations… Terrible première moitié du XXe siècle.
(A suivre)