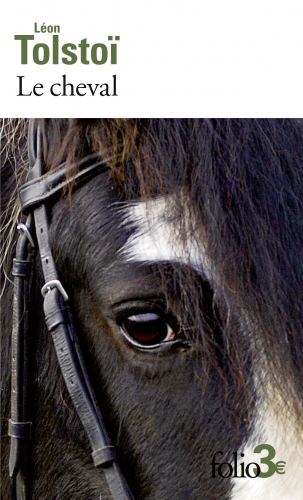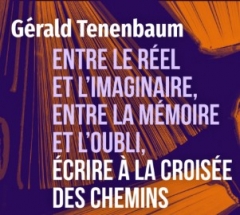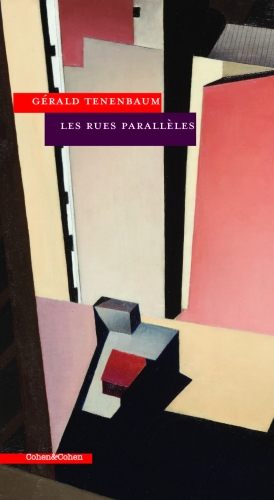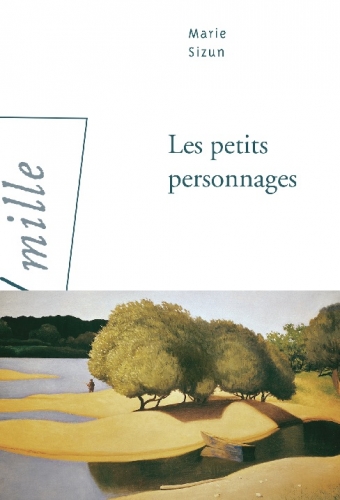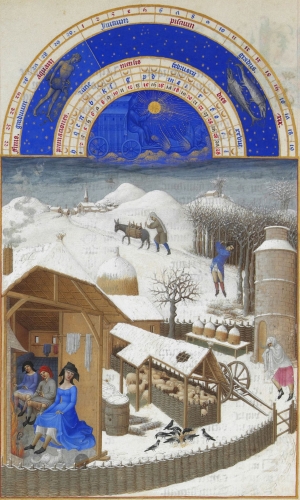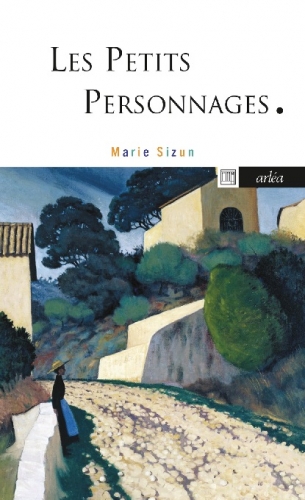Le Cheval et Albert sont deux nouvelles de Tolstoï publiées ensemble dans un autre petit Folio (extraites de La Tempête de neige et autres récits, traduites du russe par Boris de Schlœzer et Michel Aucouturier). Le cheval est un hongre (cheval castré) ; Albert, un musicien qu’on dit « un peu dérangé ». Tous deux remarquables dans leur genre, tous deux confrontés à la déchéance.
Au lever du jour, Nester, le vieux gardien, s’occupe des chevaux réunis dans la cour – « celui qui montrait le moins d’impatience était un hongre pie qui seul sous un auvent, les yeux mi-clos, était en train de lécher la porte de chêne de la grange. » C’est lui que Nester monte pour suivre le troupeau vers la prairie où ils doivent paître, et si le cheval lui est reconnaissant de le gratter un peu sous le cou, il doit aussi encaisser les coups, ce qui le peine, mais il en a l’habitude.
Dès le début, Tolstoï exprime les sentiments du hongre, dont la vieillesse est « à la fois laide et majestueuse ». Les trois taches devenues brunes de son pelage noir-pie ne sont qu’un des nombreux signes de décrépitude de ce cheval de haute taille, « pareil à une ruine vivante », qui garde « l’attitude calme et assurée d’un animal conscient de sa force et de sa beauté. » La vieille jument grise Jouldyba marche toujours en tête du troupeau où de jeunes cavales, des poulains et des pouliches, se montrent plus espiègles.
« Il était vieux et ils étaient jeunes ; il était maigre et eux étaient bien en chair ; il était morne et eux toujours gais. » Le hongre les observe avec tristesse, même s’il sait que tous perdront un jour leur jeunesse. Les jeunes chevaux descendant de « la célèbre Crème » sont fiers de leur ascendance aristocratique, alors que lui est « un étranger », « d’origine inconnue ». Certains chevaux sont cruels avec lui, le frappent, le dérangent, aussi est-il heureux lorsque le gardien remonte sur son dos puis laisse le troupeau dans l’enclos du village pour aller retrouver ses amis.
Durant cinq nuits, quelque chose d’extraordinaire se produit : la jument la plus âgée s’approche du hongre, rétablit le calme autour de lui, et « le fils d’Aimable Ier et de Baba », nommé Moujik Ier, surnommé l’Arpenteur pour sa foulée large et rapide, leur raconte sa vie, la manière dont les hommes l’ont considéré ou déconsidéré, les périodes heureuses et les malheureuses, d’un maître à l’autre. La fin de la nouvelle, qui est aussi celle du cheval, réserve une surprise.
La nouvelle Albert commence « après deux heures du matin dans un petit bal de Saint-Pétersbourg » : jeunes messieurs, jolies demoiselles, piano et violon jouant « polka sur polka ». Un des jeunes gens, Délessov, fuit cette « gaieté affectée », « encore pire que l’ennui ». Dans l’antichambre, il entend des voix, une dispute, puis une porte s’ouvre sur « une étrange silhouette masculine ». Très maigre, les cheveux en désordre, mal vêtu, c’est « un musicien un peu dérangé, de l’orchestre du théâtre » qui veut entrer dans la salle de bal, titube et tombe. La maîtresse de maison a pitié de lui et lui permet de « musiquer » avec son violon.
Une fois annoncée une Mélancolie en ré majeur, « un son pur et plein traversa la pièce, et le silence se fit. » Le jeu du musicien les transporte, il n’a plus rien de grotesque ni d’étrange, « un flot exquis de poésie » s’empare de tous. Délessov, que les traits du musicien fascinent, est ému et séduit par sa prestation. On fait la quête pour le remercier. Albert demande surtout à boire. Alors Délessov le ramène chez lui, espérant lui être utile. Dans la calèche où le musicien s’endort, il admire son beau visage : « En cet instant, il aimait Albert d’un amour sincère et chaleureux, et avait fermement décidé de lui faire du bien. » Y arrivera-t-il ?
On peut lire intégralement l’histoire du cheval Kholstomer (l’Arpenteur, en russe) sur le blog de M. Tessier, « traducteur très amateur de littérature russe », précédée d’une notice sur Tolstoï qui chevauchait « de l’aube au coucher du soleil ». Albert est aussi disponible en ligne, Wikisource propose cette nouvelle dans une traduction de J.-Wladimir Bienstock. Deux récits poignants à découvrir, où la voix et les préoccupations sociales et morales de Tolstoï se font entendre.