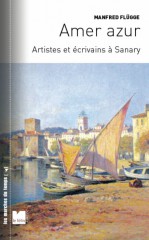Ecrire, aimer : Apollinaria, une passion russe, tourne autour de ces deux obsessions de l’aînée des filles Souslova. Capucine Motte a placé son roman sous l’égide de Dostoïevski : « Nous ne savons pas où aller, à qui nous adresser, ce qu’il faut aimer ou haïr, respecter ou mépriser. » C’est lui, « l’Ecrivain », comme elle l’appelle en elle-même, qu’Apollinaria va écouter à l’université de Pétersbourg, avec Nadia, sa sœur cadette. Certains étudiants chuchotent au passage de ces filles connues pour être nées en servage autant que pour les résultats brillants de Nadejda.

Peinture de Vassili Koltzinski en bandeau de couverture
En lisant Humiliés et offensés, Apollinaria s’est identifiée à Natacha Nikolaïevna qui quitte sa famille pour devenir la maîtresse d’Alexeï, le fils du prince Valkovski. Et la voilà en train d’observer Dostoïevski, qu’elle trouve laid et plus vieux que ses quarante ans, mais peu importe, il est « son frère d’âme – élevé loin de la vie, comme elle, éternellement blessé, comme elle. » Sa conférence la bouleverse. Elle le suit hors de l’amphithéâtre et ose fendre la foule qui l’entoure pour solliciter un rendez-vous, elle voudrait lui parler seul à seul. De quoi ? « Je voudrais vous montrer ce que j’écris. »
Devenir une femme de lettres ou, selon ce que sa nourrice a lu dans le marc de café, une muse célèbre, voilà son destin. Le grand-père d’Apollinaria, moujik devenu domestique, a fait instruire ses fils. Prokov, le père d’Apollinaria, et son frère, intendant et régisseur, sont ainsi devenus « les véritables maîtres du domaine » de Panino : le seigneur a accepté de les affranchir à condition qu’ils restent à son service. Prokov épouse alors la belle Alexandra, et après Apollinaria, née en 1840, ils ont eu quatre autres enfants.
L’aînée, une fille « pensive et rêveuse », est la plus compliquée. « Apollinaria était rétive à la musique, Apollinaria aimait les mots ». Elle écrit des poèmes, lit de jour et de nuit les livres empruntés à la bibliothèque seigneuriale. Lermontov est son auteur préféré : elle est « la Tamara du Démon et la Bella d’Un héros de notre temps ». Quant à Nadia, « pasionaria des amphithéâtres », elle prône la liberté morale et sexuelle, mais sa sœur ne croit pas que Tchernychevski et elle soient amants ; le rédacteur en chef du Contemporain est trop occupé par « l’avènement de la Raison » et Nadia par ses études de sciences – elle suit en auditrice libre les cours de médecine interdits aux filles.
Depuis leur installation à « La Cité des Brumes », leur mère est obsédée par l’idée de recevoir et d’être reçue, ainsi que par le désir de bien marier ses filles, qui n’en ont cure. Apollinaria est souvent malade, refuse de manger, se fait gronder par ses parents. Elle croit en une espèce de transmission de la capacité d’écrire d’un auteur expérimenté vers un plus jeune et, en ce mois de janvier 1861, tous ses espoirs sont dans ce rendez-vous accordé par Dostoïevski.
Elle demande à Nadia de l’accompagner au Temps, la revue qu’il a créée à son retour d’exil, et là, celle-ci le bombarde de questions, avant qu’Apollinaria lui remette son manuscrit. « Apollinaria Prokovna, je sais, je sens d’ores et déjà quelque chose de bon et de beau vibrer dans ces pages », dit alors l’écrivain, et elle comprend qu’il va la publier, sans savoir si c’est pour sa beauté ou pour son talent. Dès lors, les deux sœurs vont être invitées régulièrement chez Michel, le frère de Dostoïevski, qui habite « à deux pas de chez elles ».
Alternant avec le récit, le journal d’Apollinaria dévoile l’évolution de ses sentiments. Elle aime la façon qu’a l’Ecrivain de discuter avec elle, tantôt abrupte, tantôt pudique. Elle s’était promis en pension de ne jamais ressembler « à ces jeunes filles qui essaient de dire quelque chose de gracieux, prennent conscience de leur nullité et finissent par se taire dans une confusion gênante ». Le 19 février 1861, Alexandre II signe le décret affranchissant tous les serfs russes, « un coup de tonnerre ». Des troubles s’ensuivent, et Dostoïevski, comblé par cette nouvelle, lui conseille de se mettre à l’abri quelque temps. Prokov, du même avis, envoie ses filles au domaine de Panino.
Quand Apollinaria rentre, ses retrouvailles avec l’Ecrivain sont marquées par la correspondance passionnée qu’ils ont échangée. Ils se voient souvent. Pour lui, les gens du peuple « sont simples, ils sont préservés de la culture, des conventions sociales, du mensonge. Ils ont le sens de la fraternité, ils ne craignent pas de montrer leurs sentiments, leur humilité, et même leur férocité. » Elle ne se reconnaît pas dans ce portrait, mais ses confidences sur son enfance, les crises d’épilepsie, son attachement envers sa femme l’émeuvent.
Le départ de Dostoïevski pour l’Europe, qu’il critique sans y avoir jamais mis les pieds, un départ sans promesse ni serment, plonge la jeune fille dans le désarroi. Des lettres la réconfortent bientôt : il se réjouit de ses gains à Wiesbaden, déplore la tristesse de Paris s’il n’y avait ses monuments admirables, relate sa rencontre à Londres avec Alexandre Herzen. A son retour, au premier rendez-vous, il se jette sur elle : Apollinaria subit l’assaut, la douleur, s’évanouit, puis s’étonne d’être encore en apparence la même « que la vierge qu’elle a été pendant vingt-trois ans ».
Apollinaria, une passion russe (ce second roman de Capucine Motte, née en Belgique, a obtenu le prix Roger Nimier cette année) est l’histoire de cette fascination pour l’Ecrivain mise à l’épreuve par la violence de l’homme. Quand il sent la jeune femme prête à rompre, Dostoïevski lui propose de l’emmener avec lui en Europe, son rêve depuis longtemps. A Paris, seule et libre d’aimer, d’écrire ! Apollinaria espère s’y accomplir, la réalité va la mettre à l’épreuve.

Apollinaria Souslova a écrit son journal intime, Mes années d’intimité avec Dostoïevski, pendant les années 1863-1865. (Nadia Souslova, sa sœur, a été la première femme médecin russe.) Dans un entretien, Capucine Motte dit avoir ressenti en lisant ces mémoires, où la jeune Russe décrit sa liaison passionnelle avec l’écrivain, le désir d'écrire une biographie romancée de celle qui a inspiré les traits de Pauline dans Le Joueur de Dostoïevski et sans doute plusieurs de ses héroïnes.
***
Trois jours d'absence, mais je serai heureuse de lire
vos réactions et d'y répondre à mon retour. A bientôt !
Tania