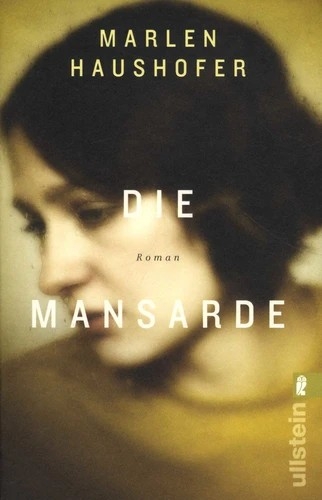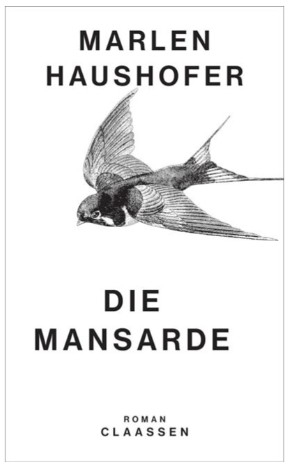Le mur invisible de Marlen Haushofer (1920-1970) m’avait fait forte impression : comment oublier l’histoire d’une femme qui se retrouve complètement isolée à la montagne, séparée du reste du monde par un mur invisible ? La narratrice de Dans la mansarde (1969, traduit de l’allemand par Miguel Couffon) est aussi une femme solitaire, sans être coupée du monde pour autant.
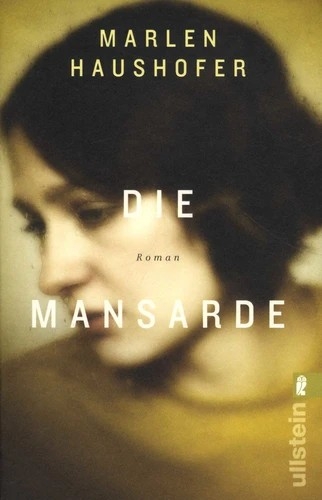
D’un dimanche au suivant, c’est le récit d’une semaine dans la vie d’une femme mariée : « De la fenêtre de notre chambre à coucher, nous apercevons un arbre à propos duquel nous ne parvenons pas à nous mettre d’accord. » Pour Hubert, son mari avocat, c’est un acacia ; pour elle, un orme ou un aulne, « Bel-arbre » lui suffit pour le désigner. « Il ne sait pas que j’existe. Sa particularité la plus étonnante est de n’être visible qu’en hiver. Dès qu’il bourgeonne et se couvre de feuilles, on ne le voit plus, jusqu’au jour où son tronc et ses délicats branchages s’élèveront de nouveau, dans leur nudité, sur le fond gris d’un ciel de novembre, et où se reposera l’énigme de son nom. » La contemplation de l’arbre qui se dessine sur le gris du ciel l’apaise, lui rend des forces.
Le même désaccord surgit entre eux quand il s’agit d’identifier un oiseau qui s’y pose. Hubert préfère se plonger dans le récit de la bataille de Saint-Gotthard-Mogersdorf (1664), son genre de lecture préféré. La cinquantaine, en bonne santé, cet homme aux cheveux bruns est « tempérant ». Hubert et elle évitent de se déranger dans leurs occupations respectives, vieux couple où chacun se réfugie dans sa routine.
De la même façon, ils restent à distance des autres, même de leur fille Ilse, quinze ans, qui écoute de la musique ou reçoit ses amies dans sa chambre. Quant à Ferdinand, leur fils de vingt-et-un ans, « né, lui, avant ces événements », il reste au centre de leur vie, vient déjeuner le dimanche et passe parfois prendre un café. Sa grand-mère paternelle lui a légué son argent, et à Hubert, son fils, la maison dont elle n’avait que l’usufruit. Rien pour sa petite-fille ni pour sa bru.
Souvent, le couple se promène le dimanche jusqu’à l’Arsenal où ils trouvent tous les deux au musée de quoi les intéresser. Au retour, elle monte dans la mansarde ; là elle peut « dessiner ou peindre » ce qui lui plaît. Elle a été illustratrice de livres. Elle ne dessinait que des insectes, des poissons, des reptiles et des oiseaux. A présent, elle voudrait réussir « un oiseau qui ne serait pas le seul oiseau sur la terre », qu’on s’en rende compte au premier coup d’œil, mais estime ses dessins ratés, seul Hubert y voit « de petites œuvres d’art ».
Le lundi, elle reçoit un courrier inattendu : une grosse enveloppe jaune contient des feuilles de son journal d’antan. Choquée, elle va la cacher dans la mansarde : « les choses et les pensées qui concernent ma vie dans la mansarde n’ont pas à pénétrer dans le reste de la maison. » Enfant de parents tuberculeux, bien qu’en bonne santé, elle n’avait pas plu à sa future belle-mère, la femme du Conseiller, et Hubert en avait voulu à sa mère. La seule personne qui l’ait aimée, c’est son grand-père chez qui elle a vécu à la campagne après la mort de ses parents qui l’avaient tenue à distance.
Quelques années heureuses avec Hubert, épousé après la guerre, puis la naissance de Ferdinand, c’était leur vie d’avant. Mais un jour, elle est devenue sourde (on lira plus tard comment c’est arrivé et comment cela a pris fin). Alors Hubert et l’enfant sont retournés vivre chez la Conseillère. Par bribes, la narratrice évoque son passé, son séjour dans une cabane au cœur de la forêt autrichienne, les personnes chez qui elle s’est réfugiée pendant cette période traumatisante.
Jour après jour, la vie quotidienne est racontée en détail, avec ses routines, en alternance avec les pages du journal déposées chaque matin par le facteur, lues puis brûlées. Comme elle dort mal, elle aimerait parfois dormir dans la mansarde, mais Hubert s’y oppose. Il lui arrive d’avoir « des pensées mansardières » qu’elle ne devrait pas avoir. A une certaine époque, la narratrice ne voyait personne. A présent, elle va chez la coiffeuse, entre dans un salon de thé, rend visite à des connaissances. Mais elle s’ennuie. Il n’y a que dans la mansarde qu’elle se sent vraiment elle-même ou bien dans ses rêves.
Portrait d’une femme solitaire même au milieu des autres, Dans la mansarde est le récit lent, répétitif, d’une vie apparemment normale, mais dont elle est comme absente. Elle joue son rôle d’épouse, de mère, se plie aux conventions, sans plus. Seules les heures dans la mansarde sont vraiment vécues, ressenties. Elle peut y songer à son passé et chercher en dessinant son oiseau idéal – à moins que ce soit un dragon ? Ce roman étrange m’a semblé pesant, comme si Marlen Haushofer nous entraînait avec son personnage dans son monde à part et figé. Elle était déjà gravement malade quand elle l’a écrit.
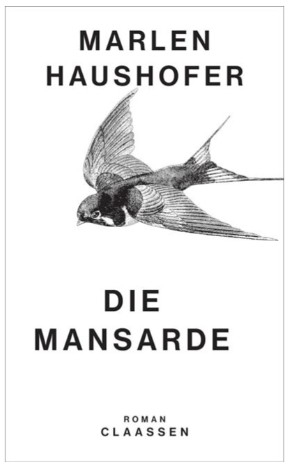
Considéré comme une critique du mariage ou en tout cas de l’usure dans une vie de couple, de la difficulté à communiquer, de l’enfermement féminin sous une apparence sociale, le dernier roman de cette romancière autrichienne retient par l’éloge d’une « mansarde à soi » où dessiner, penser librement, et par son ton original pour décrire une vie ni joyeuse ni malheureuse mais acceptée.
 « Je suis né et j’ai grandi dans un pays dont la culture politique fait en sorte que la soumission générale à un ordre de faits devenu prééminent tende à éliminer ou à écraser les voix individuelles ; et je continue à y vivre, à essayer d’y vivre en tout cas le plus honnêtement possible, en me faisant un habitant solitaire d’un royaume intermédiaire où l’on parle à la fois japonais et français, et en me demandant comment un jour on pourra faire advenir un monde meilleur plus soucieux de la valeur de chaque voix singulière et, par conséquent, de chaque individu. »
« Je suis né et j’ai grandi dans un pays dont la culture politique fait en sorte que la soumission générale à un ordre de faits devenu prééminent tende à éliminer ou à écraser les voix individuelles ; et je continue à y vivre, à essayer d’y vivre en tout cas le plus honnêtement possible, en me faisant un habitant solitaire d’un royaume intermédiaire où l’on parle à la fois japonais et français, et en me demandant comment un jour on pourra faire advenir un monde meilleur plus soucieux de la valeur de chaque voix singulière et, par conséquent, de chaque individu. »