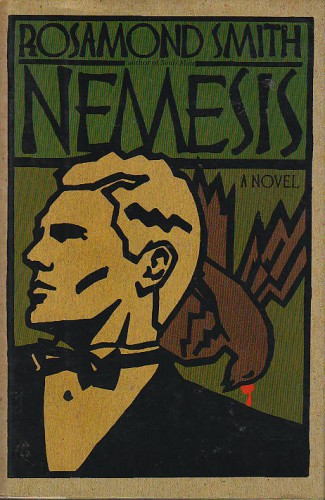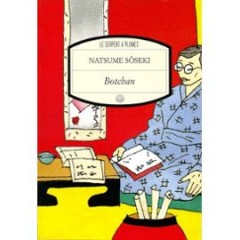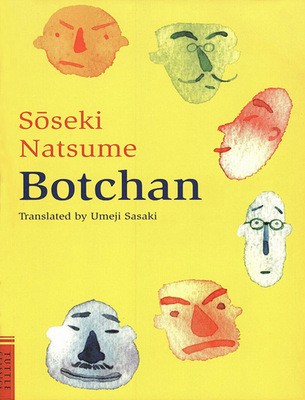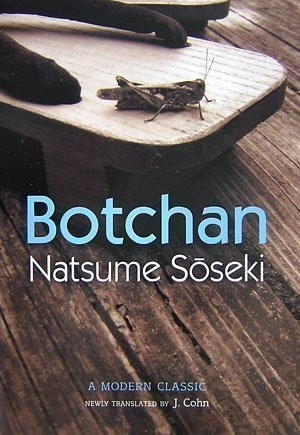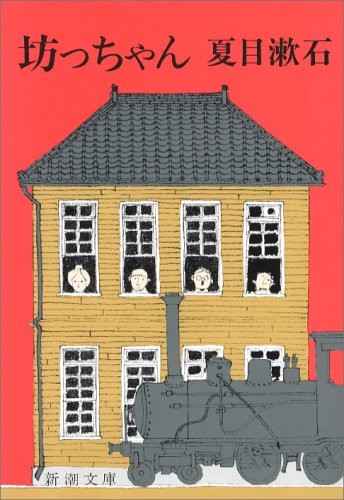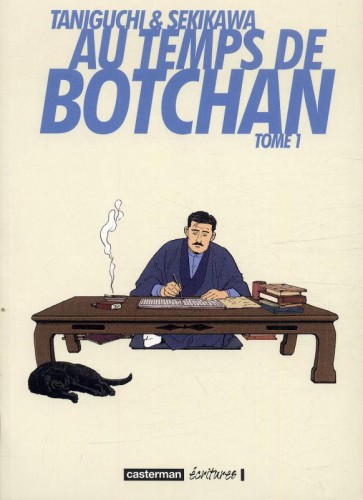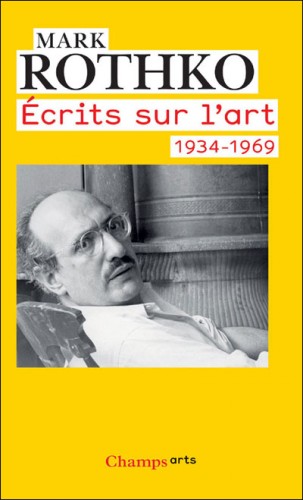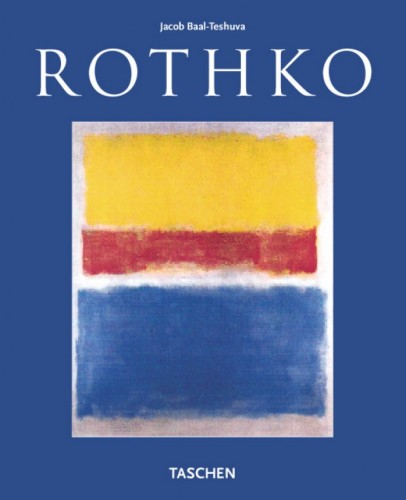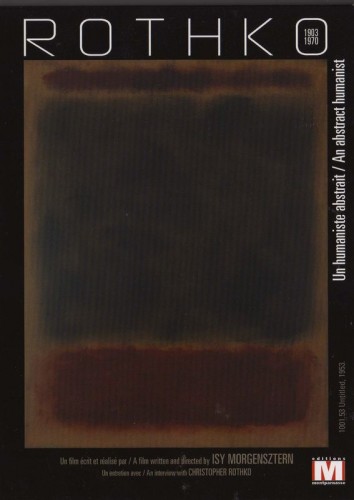Pas de musique qui adoucit les mœurs dans Le département de musique (Nemesis, traduit de l’anglais par Boris Matthews), roman publié par Joyce Carol Oates sous le pseudonyme de Rosamond Smith en 1990. Mais de la cruauté, certes. Ce thriller s’ouvre sur un étonnant extrait d’une lettre de Chopin : « Ce n’est pas de ma faute si je ressemble à un champignon qui paraît comestible, mais qui vous empoisonne quand vous y goûtez en le prenant pour un autre. » (1839)
Maggie Blackburn, « femme d’une grande intégrité », célibataire, est « une pianiste douée » mais manque de confiance en soi. Professeur au Conservatoire de Forest Park (Connecticut) depuis six ans, elle vient d’être nommée à 34 ans « directrice du département de formation musicale pour étudiants avancés ». Son style vestimentaire (des couleurs toujours neutres), ses bijoux coûteux (héritage de famille), son attitude « parfois distraite, voire absente », sa discrétion sur sa vie privée la rendent mystérieuse aux yeux des autres.
Elle ne parle à personne des visites qu’elle rend à son père en maison de retraite jusqu’à sa mort, ni des « crises d’amnésie » qui la saisissent parfois. En septembre 1988, Maggie organise une grande soirée dans sa maison pour présenter les nouveaux étudiants et enseignants à la communauté du Conservatoire. Soirée fatale.
Calvin Gould, le recteur, 39 ans, est son invité le plus désiré : elle est secrètement amoureuse de lui. Sa femme déteste les mondanités, et comme prévu, il viendra sans elle. Les canaris de Maggie, Rex, un mâle au chant extraordinaire et une femelle, Sucre d’orge, sont des oiseaux délicats qu’un courant d’air froid pourrait tuer, aussi a-t-elle déplacé leur cage à l’arrière de la maison, loin de l’agitation.
Puis c’est le défilé des invités, l’attention pour chacun, pour le service, un stress continu pour Maggie qui a du mal à se détendre et observe tout son monde, soucieuse que tout soit parfait. Vingt minutes avant la fin, Calvin Gould arrive enfin, la trouve « merveilleuse », puis est rapidement accaparé par les autres. Le recteur est un « personnage controversé » au sein du département de musique, mais Maggie le défend toujours « bec et ongles ».
Au moment où ses derniers invités prennent congé, Maggie remarque Rolfe Christensen, 59 ans, compositeur renommé, en grande conversation avec un compositeur novice de 27 ans, Brendan Bauer, un étudiant timide qui a tendance à bégayer. Christensen lui propose de le raccompagner en voiture et Calvin, de son côté, reconduit une étudiante à sa résidence sur le campus. Le calme revenu, Maggie découvre que quelqu’un a fumé dans son bureau et y a ouvert la fenêtre en grand : Sucre d’orge gît sur le sol de la cage, morte.
Ce petit drame n’est rien en comparaison de celui qui se déroule dans la majestueuse demeure de Christensen, qui a ramené Brendan chez lui sous prétexte de lui faire écouter un enregistrement de son « Adagio pour piano et cordes ». Jeune, maigrichon, « charmant », l’étudiant est le genre de garçon qui attire Christensen, un costaud. Il le fait boire, use et abuse de son autorité naturelle, de sa logorrhée de moins en moins contenue, pour retenir sa proie.
Le lendemain, Maggie enterre Sucre d’orge. Plus tard dans la journée, elle aperçoit quelqu’un derrière chez elle : Brendan Bauer, hagard, apeuré, la peau éraflée, les lunettes cassées, est si agité qu’il refuse de s’asseoir quand elle le fait entrer. Comme fou, le jeune homme déambule dans le salon, touche le piano, finit par accepter une tasse de café. Il ne veut ni médecin, ni qu’elle l’emmène aux urgences, et finit par dire l’abominable : il a été violé, pense au suicide, regrette de n’avoir pas tué Christensen, renonce à ses cours.
Stupéfaite, compréhensive, patiente, Maggie parvient à lui faire raconter ce qu’il a vécu, la manière monstrueuse dont il a été traité. Elle veut prévenir la police, mais Brendan refuse, l’humiliation a été trop grande et il ne supporterait pas qu’on le prenne pour un homosexuel qu’il n’est pas. Elle le reconduit chez lui en le priant de l’appeler en cas de besoin, elle est sa conseillère après tout.
Le lundi matin, elle se rend dans le bureau du recteur pour l’informer. Calvin Gould est écœuré, il craint que Brendan ne mette fin à ses jours et convainc Maggie de l’appeler pour qu’il dépose une plainte au département, en toute confidentialité – Brendan accepte. Maggie apprend un peu du passé trouble de Christensen, qu’elle ignorait. Pendant quelques jours, celui-ci reste invisible, et quand il réapparaît, convoqué chez le recteur, il est accompagné de son avocat. Sans vergogne, il parle de rapports entre adultes consentants, prétend que Brendan l’a provoqué, joue les scandalisés.
La vérité sur cette nuit-là ne sera dévoilée, on s’en doute, qu’à la fin du roman, après la mort de Christensen, empoisonné, et le meurtre d’un autre musicien. Brendan est suspecté, seule Maggie reste convaincue de son innocence. La découverte du véritable assassin devient son obsession. Nemesis (titre original) est la déesse de la vengeance, de la colère divine. Joyce Carol Oates, pour qui la lecture de Crime et châtiment fut une révélation, sème évidemment des indices, ouvre de fausses pistes, tient ses lecteurs en haleine, mêle avec brio à ces violences les secrets intimes et la musique, tissant page après page le portrait d’une femme à l’air fragile, terriblement obstinée.