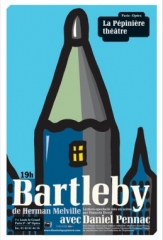Le premier exil (2021) est ma première rencontre avec l’univers de Santiago H. Amigorena. Né en Argentine en 1962, celui-ci reconstitue en français, depuis 1998 (Une enfance laconique), les différentes époques de sa vie marquée par deux exils. Le premier, raconté ici (avec la mention « roman » sous le titre), est celui de sa famille de Buenos Aires à Montevideo ; le second les mènera tous à Paris et le fera passer de l’espagnol au français.
L’incipit du Premier exil, que vous avez pu lire ici, se rapporte au décès de son arrière-grand-père maternel à cent quatre ans, en présence de toute la famille – l’auteur avait six ans : « Je regardais fixement son visage. Je regardais – et j’attendais. Tout le monde attendait. Tout le monde attendait – et il n’y avait plus rien à attendre. » Voulant demander à sa mère si son grand-père était mort, il lui dit : « ¿Me mori? » Une « erreur enfantine » révélatrice, il me semble. J’ai failli abandonner ce premier chapitre qui compte cent dix pages, tant il m’a paru égocentrique, voire égotiste.
La prise de conscience du temps qui passe ou est passé est au cœur du récit de cet écrivain admirateur de Proust. La mort ouvre « une nouvelle ère de notre existence, celle de l’absence de l’être cher et disparu », écrit Amigorena, ajoutant bientôt qu’alors il ne savait pas encore « que le temps caresse la mémoire et que l’oubli atténue le manque, apaisant la première morsure de la disparition ». Cherchant à restituer le regard et la sensibilité de ses six ans, il ne masque pas pour autant la voix du narrateur de soixante ans, l’âge auquel il écrit ces souvenirs-là.
Passer les vacances d’été en Uruguay était habituel pour sa famille comme pour beaucoup d’Argentins, mais cette fois, ils avaient fui leur pays après le coup d’Etat militaire de 1966 et une attaque de l’université : « Il y avait, dans cette manière explicitement fasciste de s’attaquer non seulement à la jeunesse, non seulement aux étudiants, mais à la pensée, aux penseurs – quel que fût leur âge, quelles que fussent leurs opinions politiques –, une violence nouvelle qui fit fuir d’Argentine des centaines et des centaines de professeurs. » Son père professeur de psychologie et sa mère exerçaient tous deux comme psychanalystes. « Autant dire que le chemin de l’exil nous ouvrait grand ses bras. »
L’Uruguay était « un petit havre de démocratie égaré dans un continent que le feu et le sang commençaient de dévorer de toutes parts ». La compagnie de Celeste, un cocker « noir comme l’encre » que ses parents lui avaient offert peu de temps avant le départ, et celle de son grand frère avec qui il allait sur la plage (au bord du Rio de la Plata) ont permis à l’enfant de six ans de ne pas trop souffrir de ce bouleversement. « Sentais-je déjà, enfant, que la passion pour la mer ne s’arrêterait jamais ? que semblable à celle de Tiepolo pour le ciel elle me ferait tourner sans cesse mon regard d’adulte vers l’azur partout répandu ? »
Le nom du chien a été choisi par ses parents en hommage à Proust. Son père a-t-il voulu lui forger un destin d’écrivain ? – « cet Autre, Marcel, dont je ne cesserais jamais de suivre les pas, pastichant jusqu’à ses pastiches, avide de devenir l’ombre de son ombre, l’ombre de sa main, l’ombre de son chien. » Un mot des italiques : elles sont souvent utilisées par l’auteur pour citer et aussi se citer, en intercalant entre deux paragraphes des phrases retrouvées dans ses cahiers ou dans d’autres de ses livres. Ce sont parfois des vers :
« On ment plus qu’il ne faut
par manque de fantaisie :
la vérité s’invente aussi. »
Amigorena décrit l’univers de ses six ans : le quartier, la première et la deuxième maison où ils habitent à Montevideo – celle-ci, de quatre étages, « parmi les plus cossues » avait un jardin « riquiqui », mais un arbre « immense », son « gomero » (un gommier des Malouines ou de Magellan) auquel il consacre de très belles pages, son terrain de jeu, de lecture, de repos, où il lui arrivait de s’endormir malgré que ce fût interdit par sa mère.
« Je croyais, il y a trente ans, qu’il me fallait tout écrire avant de publier, et je rêvais d’un seul ouvrage, de quelque trois ou quatre mille pages, qui mériterait le titre que je lui avais déjà attribué : Le Dernier Livre. Que j’avais tort ! Et que j’avais raison. Que j’avais tort et raison, et que – j’étais prétentieux. Presque aussi prétentieux qu’aujourd’hui où, ayant déjà publié quelques milliers de pages – et ayant compris que jamais je ne trouverai la pierre philosophale, que jamais je ne transformerai mon sombre silence en or trébuchant et sonore –, j’écris encore. » Plus loin : « ce n’est qu’en écrivant – ou en décrivant seulement comme c’est le cas ici – que les espaces du passé resurgissent dans la pensée. » On découvrira à la fin du livre le plan général de l’œuvre d’Amigorena en six parties. Il répète souvent ceci : « J’écris pour ne plus écrire. »
Le thème de l’écriture, le seul enseignement sans lequel il ne serait pas ce qu’il est, sa « raison sociale », écrit-il, est omniprésent dans Le premier exil. A l’école, leur goût commun de la solitude le rapproche d’Abu, fils de diplomates africains. C’est aussi à six ans qu’il commence à suivre une analyse – il y gardera le silence, autre leitmotiv de son enfance « d’un mutisme farouche » – et à passer des après-midi chez le dentiste. Après ce long chapitre consacré à « la première année du premier exil », viendront la deuxième, la troisième et la quatrième.
Au récit des amitiés d’école, des événements politiques, des jeux, de l’écriture, s’ajoute la souffrance de savoir son frère amoureux, « heureux avec quelqu’un d’autre » que lui. Au surnom ironique que lui donnent ses camarades, « le dieu du silence », répondra la déclaration de son « futur meilleur ami » : « Moi, je sais pourquoi il ne parle pas. C’est parce que tout ce qu’il a à dire il le dit à sa façon : en écrivant. » L’auteur instille dans son texte un rythme personnel à l’aide de tirets, de répétitions, de subjonctifs ou d’associations de mots fantaisistes, qui jouent sur les sonorités surtout.
Donnant peu à peu plus de place à ce qui se déroule autour de lui durant ces années-là, Amigorena poursuit sa recherche du temps perdu qu’il résume ainsi dans le dernier chapitre : « Si nos seules patries sont l’enfance et la langue, l’amour et l’amitié sont nos seules nations : ce sont les seules contrées où notre errance sur terre trouve un sol ferme où poser les pieds. Un sol ferme et mouvant : vivant – comme le sable, comme l’océan. »