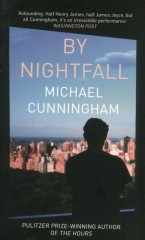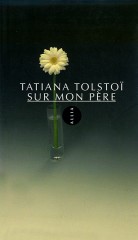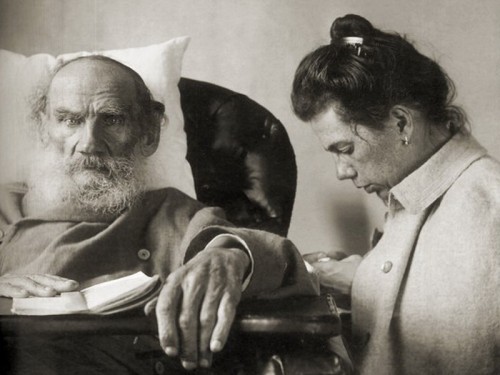Loin de la vie de bohème, les personnages d’Angela Huth, dans De toutes les couleurs (Colouring in, 2004), tiennent à leurs habitudes. Isabel et Dan Grant forment un « couple sympa » sans histoire aux yeux de leur fille, Sylvie, comme de Gwen, leur femme de ménage. Isabel vient d’avoir quarante ans et n’aime pas qu’on perturbe son « train-train quotidien ». Sylvie et Dan partis, elle monte à son atelier sans parler à qui que ce soit, elle n’y a pas de téléphone, pendant que Gwen commence à passer l’aspirateur en bas.

http://orlane.artblog.fr/737392/masque-venitien/
Dans le grenier, toute la matinée, Isabel confectionne des masques, les commandes ne manquent pas. Il suffit d’un message sur le répondeur pour l’agacer : Dan a invité Bert Bailey à dîner et ils tombent d’accord pour proposer à Carlotta, une amie d’enfance, trente-six ans et célibataire, de se joindre à eux. Dan se réjouit de revoir son vieil ami qui a travaillé à l’étranger, d’abord pour l’armée, puis pour une compagnie pétrolière, sans jamais se marier. Il vient de rentrer de New York pour se réinstaller à Londres. S’il gagne bien sa vie dans l’import-export, Dan cultive une autre passion dont il aime parler avec Bert : le théâtre. Sa première pièce a remporté un succès inattendu, mais depuis, il en a écrit plein d’autres dont personne ne veut.
Pour faire entendre le point de vue de ces six personnages, Angela Huth leur donne la parole tour à tour, comme si chacun tenait une sorte de journal. Les impressions de Gwen, qui adore travailler chez les Grant – elle ne se sent nulle part ailleurs aussi bien que dans leur maison où elle travaille depuis neuf ans – donnent un aperçu extérieur de cette famille bourgeoise : une femme posée, aimable, parfois un peu dans la lune ; un homme digne et charmant, courtois ; une fille « bonne fille, mais lunatique et têtue comme une mule ».
La mise en situation est assez lente, le temps de présenter les uns et les autres. Le bonheur serait-il de trouver une place, un endroit où l’on se sente bien ? Pour Isabel, c’est très clairement son atelier – « mes plumes, les perles, tous ces bouts de tissus sont toute la couleur qu’il me faut. » Pour Bert, heureux de retrouver l’Angleterre, ce n’est sans doute plus sa maison londonienne qui a grand besoin d’être rafraîchie. Carlotta lui propose ses services, elle a été décoratrice d’intérieur avant de se lancer dans le marketing. Elle l’agace, mais il n’ose refuser.
Carlotta va-t-elle réussir à séduire Bert ? Cette question récurrente dans la première partie du roman va peu à peu s’insinuer dans les rapports entre les quatre amis. Carlotta sent qu’Isabel la discrète, la fidèle épouse, la femme secrète, ne lui dit pas tout à propos de ses contacts avec Bert. Quant à Dan, il n’est pas tout à fait insensible aux provocations de la tapageuse amie de son épouse bien-aimée.
De toutes les couleurs suit surtout cette trame sentimentale. A l’opposé des ambiances feutrées, on découvre aussi les problèmes de Gwen, harcelée par un homme avec qui elle s’est liée un certain temps, et qu’elle craint à tout moment de retrouver sur ses pas. Il l’espionne partout, se campe même parfois en face de la maison des Grant. Elle n’ose en parler à personne.
« C’est une chose de vivre seul quand vous êtes dévoré par une passion telle que la peinture, l’écriture, la musique ou autre – mais c’est tout autre chose quand vous n’avez rien de particulier à faire », remarque Rosie, une vieille et sympathique artiste-peintre qui habite une « petite maison de silex et de briques » près des marais à Norfolk ; enfant, Bert jouait dans son jardin, qu’elle a considérablement embelli.
Est-ce la structure fragmentée du roman ? la manière dont l’auteur aborde les émotions, sans y toucher vraiment ? Je suis restée à distance de ces chassés croisés amoureux, mêlés ici aux tournants de l’âge. A relire quelques-uns de ses titres – L’invitation à la vie conjugale (1991), Une folle passion (1994), Tendres silences (1999) –, on comprend qu’Angela Huth a choisi les affaires de cœur comme thème de prédilection.
Mais voici le résumé de Pierre Maury, plus enthousiaste : « Cachotteries : le titre d'une pièce que Dan commence à écrire. Inspiré, pour une fois, par sa vie réelle. Car les six personnages du roman ont tous quelque chose à cacher aux autres. Alors qu'ils ne sont pas coupables. Autour de petites tentations sans importance, Angela Huth déstabilise des existences tranquilles. Les questions que chacun se pose prennent des dimensions inattendues. Et on observe cette danse du désir avec un sourire au coin des lèvres tant elle est plaisante. » (Le Soir, 27/10/2006)