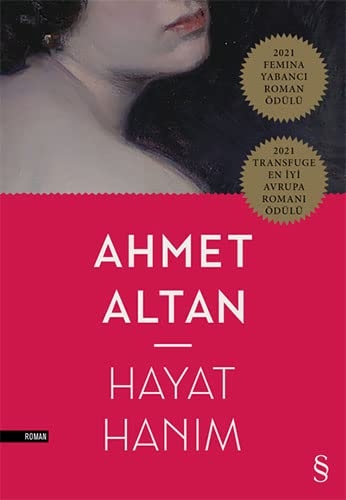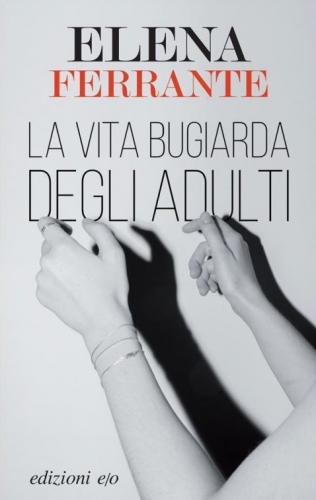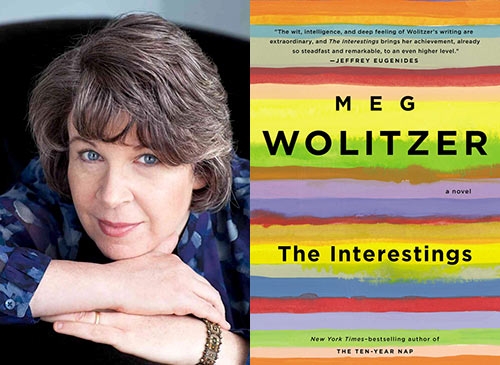Quand j’ai lu Je ne reverrai plus le monde, Ahmet Altan était encore en prison. C’est là qu’il a écrit Madame Hayat (Hayat Hanım, traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes), avant d’être libéré par la Cour de cassation en avril 2021. Prix Transfuge du meilleur roman européen et Prix Femina étranger, Madame Hayat raconte la vie de Fazil, le narrateur, étudiant en lettres, qui a changé du jour au lendemain.
« La société se trouvait dans un tel état de décomposition qu’aucune existence ne pouvait plus se rattacher à son passé comme on tient à des racines. » Son père, qui avait investi toute sa fortune dans la production de tomates, est ruiné par de nouvelles mesures économiques et meurt peu après. Sa mère n’a plus d’autre source de revenus que le maigre rapport de ses serres florales. Fazil obtient une bourse, mais sa nouvelle condition d’étudiant n’a plus rien à voir avec le train de vie facile qu’il menait auparavant.
Il loue une petite chambre dans un vieil immeuble « d’une rue de la soif » qu’il peut observer d’un petit balcon et partage la cuisine commune avec les autres locataires. C’est là qu’on lui propose un jour de se faire un peu d’argent comme figurant pour une émission de télévision : dans une salle en sous-sol, il s’agit de s’installer à une des tables près de la scène, un plateau où chantent des femmes mûres plantureuses dans des tenues colorées et aguichantes. Un écran géant montre les chanteuses filmées et de temps à autre les spectateurs.
C’est à l’écran qu’il remarque d’abord un visage « d’une espièglerie malicieuse » entouré de longs cheveux « roux-blond », une « robe au décolleté profond, couleur de miel », puis les belles hanches d’une femme gracieuse et très excitante. « Jusque-là, je n’avais jamais imaginé que les femmes âgées puissent être aussi attirantes. J’étais émerveillé, abasourdi. »
A la fin du tournage, quand tout le monde sort, cette femme d’une cinquantaine d’années le remarque et l’invite à l’accompagner au restaurant. Le serveur les installe dans un petit jardin intérieur et l’appelle « madame Hayat » – un nom qui enchante l’étudiant : « et je me répétais dans toutes les langues : Madame Hayat, Lady Life, Madame la Vie, Signora la Vita, Señora la Vida… »
Elle s’intéresse à lui, l’interroge sur ses études – elle ne lit jamais de romans, qui ne lui apprennent rien sur l’humanité, dit-elle, qu’elle ne sache déjà. Mme Hayat préfère regarder des documentaires. Elle dirige la conversation, le taquine, le surprend, « certainement la partenaire la plus charmante qu’un homme puisse souhaiter pour un dîner ». Elle ne sait rien de la littérature mais connaît beaucoup de choses sur les hommes, les insectes, le monde. Quand elle repart en taxi, Fazil se reproche de ne pas avoir su lui plaire assez pour qu’elle le retienne.
Une fois son amant, la revoir devient son obsession. Leur relation occupe toutes les pensées de l’étudiant, même après avoir rencontré Sila, une étudiante de bonne famille qui a subi les mêmes revers de situation que lui, du jour au lendemain. Belle, cultivée, elle est la partenaire idéale pour échanger sur leurs lectures, les cours et les professeurs de lettres. Quand leur complicité devient plus intime, il ne lui parle pas de Madame Hayat, qu’il continue à voir chez elle.
Dans la rue, de plus en plus de bastonnades visent ceux qui ne vont pas à la mosquée. Les revues sont mises sous pression. Le quartier des bouquinistes est rasé. A l’université, étudiants et professeurs sont suspectés de sédition. L’ancien chauffeur du père de Sila, reconverti dans des affaires malhonnêtes et lucratives, prend plaisir à la suivre pour la traiter de haut. Tout le monde se sent surveillé et peut s’attendre à une arrestation arbitraire. Sila n’envisage qu’une issue pour y échapper : continuer ses études au Canada. Fazil hésite à l’accompagner, même si Madame Hayat elle-même pousse son « petit Marc Antoine », comme elle l’appelle, à partir avec cette étudiante de son âge.
Fazil, en adoptant un mode de vie modeste, partage les vicissitudes de ses nouveaux compagnons d’infortune. Si le très beau roman d’Ahmet Altan décrit les difficultés d’une jeunesse avide de liberté dans ce climat politique menaçant, c’est avant tout un roman d’initiation amoureuse. Tiraillé entre deux femmes que tout oppose, l’étudiant admire chez Madame Hayat, en plus de sa sensualité enivrante, son goût de la vie, sa curiosité, son art de vivre au présent.
Magnifique portrait de femme – « Sa liberté me rend plus libre » a écrit l’auteur à l’occasion du prix Femina –, Madame Hayat décrit l’entremêlement des désirs chez un jeune homme qui rêve d’enseigner la littérature et qui apprend à observer la vie réelle. « Un livre universel, trempé dans l’encre de l’humanisme et de la liberté. » (Philippe Chevilley, Les échos)