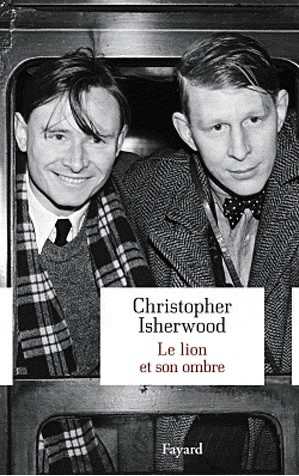Le festival Europalia India provoque-t-il une véritable Indomania à Bruxelles ? Difficile à dire quand on n’a pas encore franchi le seuil des expositions consacrées en ce moment à l’Inde – heureusement la plupart seront visibles jusqu’à la fin de l’année et même au-delà. En attendant, parmi les titres de littérature indienne exposés à la bibliothèque Sesame, qui l’a accueillie le mois dernier, j’ai choisi le roman d’une Indienne à Paris, Fenêtre sur l’abîme (2008), signé Sumana Sinha.

Shumona Sinha à France Culture, 30/9/2011
Madhuban, la narratrice, provoque d’emblée : « Viole-moi ! », dit-elle à son amant qu’elle retrouve à l’hôtel avant de rentrer chez son mari. « Mais je suis arrachée du sommeil chaque nuit. Secouée par des cauchemars. » Entre David et Antoine, sa vie ressemble à ces pièces de palais que les sultans ou les maharajas font couvrir de morceaux de miroir.
Flash-back. A Calcutta, tout a commencé six ans plus tôt dans « une vieille Ambassadeur blanche » (dans L’amant de Marguerite Duras, la limousine était noire). « L’autre nom du bonheur est français » se dit Madhuban depuis que Michel Bertrand, à un festival de films français, s’est jeté « dans l’eau noire, profonde, des yeux d’une Bengalie. Elle fut son Inde. Elle fut son étonnement oriental. L’unique. » Depuis, le diplomate et l’étudiante se voient en cachette.
Michel n’a d’abord pas cru aux audaces de la jeune femme inventant mille prétextes pour s’absenter le week-end et l’accompagner dans d’autres villes d’Inde, ravie de tout ce qui s’offre à elle, l’avion, les chambres d’hôtel, les soirées et les nuits. « Michel ne savait pas encore que quatre mois avant mon départ pour la France – et le sien pour la Russie, (…) – il me verrait pour la dernière fois. » La fille du diplomate a trouvé le mot de passe de son père sur l’ordinateur, sa femme traite Madhuban de « pétasse » par téléphone, et ensuite, rien. Le vide, le silence.
Pas de chronologie dans ce récit. Deux lieux : Paris, où Madhuban participe à un programme d’échange (enseigner l’anglais dans les collèges et les lycées et améliorer du même coup son français) et Calcutta, sa vie d’avant, sa famille, ses souvenirs. Elle passe un premier automne « doré » à Paris en 2001 : marcher, s’asseoir dans un café près de la vitre, répondre des milliers de fois à « Tu aimes Paris ? », aux flatteries sur sa beauté. « Partout, des regards et des sourires, la joie soudaine et légère, pareille au pollen dans l’air. » Tout, dans cette vie, lui plaît. « Paris va t’engloutir ! » avait prédit Michel.
Hébergée d’abord par une amie cinéaste rencontrée à Calcutta, Madhuban, quand elle n’a pas de cours à donner, s’émerveille « à chaque pas », achète ses carnets chez Gibert Jeune, flâne du côté de la Cité Universitaire, son « oasis, étendue et dense, dans une ville étrangère ». Musiques, lectures disparates, rencontres : « le temps était une aile blanche. La vie avait un rythme gai, la vie n’était que promesses, éclats, couleurs claires… »
Sans cesse, le nom de David revient, c’est lui son histoire d’amour, son récit de voyage – « Le reste ne compte pas. » Mais David, elle le rencontre bien plus tard, lorsqu’elle est déjà mariée avec Antoine. Ses parents s’inquiètent de loin, après leur grande colère quand ils ont découvert ses frasques ; ses amies d’enfance essayent « de freiner (ses) excès de vitesse », craignent que « Plume » (son pseudo) sorte à nouveau avec un homme marié.
Le Paris des touristes, ses boutiques, ses rites, ses saisons, la vie étudiante, sa propre chambre à la Cité-U, c’est le thème de la première partie de Fenêtre sur l’abîme, même si la narratrice a choisi de s’égarer « librement dans les allées de la mémoire ». Cette vie au jour le jour, « sans penser au lendemain », à écrire des poèmes, à préparer une thèse sur « le questionnement du Temps dans la poésie française contemporaine », est aussi une expérience physique, sensuelle, érotique.
Son directeur de thèse lit ses pages, l’invite quand il reçoit poètes, artistes et philosophes. Bientôt elle l’appelle « Antoine », l’accompagne aux vernissages, s’installe chez lui. Premiers mois de fête autour des mots et des livres. Un soir d’été, il glisse une bague en or à son doigt, avec « trois gouttes de lumière ». Tout devrait être parfait… « Comment ? Vous devinez déjà ? Mais moi je ne savais pas. » Vivre auprès du beau visage d’Antoine ne suffit pas, Madhuban a besoin d’imprévu, de désir, de rencontres de hasard. La nuit, il dort paisiblement, elle sort. David entre dans sa vie, dans sa peau.
Fenêtre sur l’abîme raconte avec fièvre l’émancipation éperdue d’une jeune femme qui veut tout vivre avec passion. Après avoir commencé ce roman en bengali, Sumana/Shumona Sinha a osé l’écrire en français directement, sur le motif en quelque sorte, dans une langue imagée pleine d’éclats, baroque. Récemment, elle a « craché sa colère » dans Assommons les pauvres ! où elle aborde le thème de l’exil d’une tout autre manière.