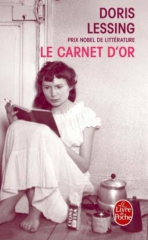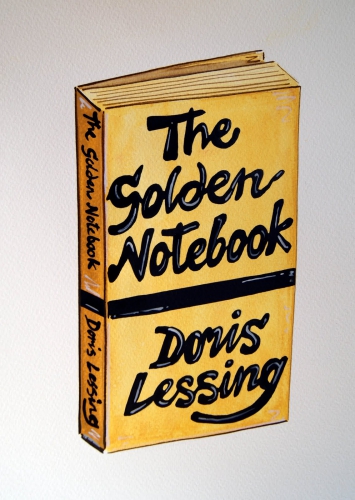Le carnet d’or de Doris Lessing (traduit de l’anglais par Marianne Véron), ce gros roman dévoré avec passion il y a quarante ans, trônait depuis longtemps à l’avant de ma bibliothèque – allait-il tenir le coup à la relecture ? Je l’ai rouvert : « Les deux femmes étaient seules dans l’appartement. »
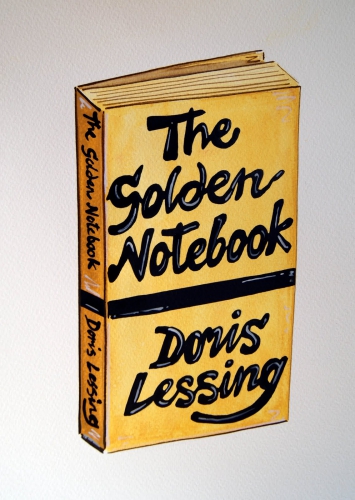
Aquarelle de John Jones d’après la couverture originale du roman
Londres, été 1957. Anna et Molly, deux amies, discutent de Richard (l’ex-mari de Molly s’est annoncé) et de Marion, avec qui il vit à présent. « Dans leurs rapports, un équilibre s’était établi très tôt : Molly était plus au fait des choses de ce monde, mais Anna la dominait intellectuellement. » Aux yeux des autres, elles sont des « femmes libres », mènent le même genre de vie, sans être mariées. « Femmes libres », ce sera le titre de cinq parties du roman où « Le carnet d’or » s’intercale avant la dernière.
Molly, une grande blonde aux cheveux courts, est actrice ; avant cela elle a beaucoup « bricolé – peinture, danse, théâtre, élucubration littéraire ». Elle ne supporte pas qu’Anna n’écrive plus, avec le talent qu’elle a. Anna n’aime pas trop Richard, mais il est venu la voir pour parler de Tommy, son fils de vingt ans qui « passe son temps à rêvasser ». L’homme d’affaires supporte mal que Molly, sa mère, se préoccupe si peu de son avenir. Anna, une petite brune menue aux cheveux « vaporeux », et Molly partagent leur « vie émotionnelle au jour le jour », se racontent presque tout.
Le premier roman d’Anna Wulf sur un groupe de communistes en Afrique du Sud, « Frontières de guerre », a remporté un succès tel qu’elle vit encore sur l’argent ainsi gagné. Il traite aussi des rapports entre les blancs et les noirs, c’est en fait le choc de la ségrégation raciale qui a suscité son engagement politique (comme celui de Doris Lessing). On lui propose régulièrement d’en tirer un film, mais elle résiste aux scénarios réducteurs. Depuis cette publication, elle est bel et bien en proie à un blocage littéraire.
Molly et Anna ont la même psychanalyste (elles l’appellent « Maman Sucre ») qui cherche aussi à la faire écrire. En réalité, Anna tient en secret des carnets de quatre couleurs : un noir qui concerne son travail d’écrivaine, un rouge pour la politique, un jaune où elle invente des histoires d’après son expérience, un bleu où elle tente de tenir son journal. Tour à tour, dans chacune des parties, nous lisons le contenu de ces quatre carnets.
Le carnet d’or, paru en 1962, traite de questions on ne peut plus actuelles, même si la société a changé depuis lors : l’engagement social et politique (Molly et Anna adhèrent un temps au parti communiste, puis le critiquent en découvrant son aveuglement doctrinaire et le peu de considération accordée aux intellectuels), les relations entre les femmes et les hommes (le goût et le prix de l’indépendance), la vie de femme seule avec un enfant (Anna chérit sa fille Janet), la vie sexuelle, les règles, la psychanalyse et l’analyse des rêves, la solitude, la dépression…
Et, bien sûr, l’écriture, la création littéraire y occupent une grande place. En 2007, le prix Nobel de littérature a couronné la romancière britannique (1919-2013) qui montre ici comment l’expérience personnelle et la construction imaginaire s’imbriquent, s’affrontent, se nourrissent l’une de l’autre. C’est passionnant de voir comment Anna transpose sa propre vie dans un univers fictif et cherche à écrire « la vérité ». Doris Lessing considérait Le carnet d’or comme un « roman expérimental ».
A la relecture de ce roman culte pour les féministes (« si j’étais un homme sans l’obligation de me contrôler sans cesse, je serais très différente » écrit un jour Anna, fatiguée de son rôle de mère qui lui tient tant à cœur), j’ai été à nouveau frappée par sa modernité. En rupture complète avec une structure romanesque classique, Doris Lessing livre une sorte de radiographie de la société britannique des années 1950-1970 sans jamais répondre définitivement aux questions que se posent ses personnages, alliant analyse critique et ouverture.
Sur près de six cents pages, Anna et Molly, « femmes libres » en lutte permanente pour rester fidèles à leurs convictions, observent la société, l’actualité politique, les comportements et les relations interpersonnelles, leur propre vie. C’est un point de vue original et décapant, une vision fragmentée très contemporaine. J’y ai trouvé certaines longueurs, mais je suis heureuse de m’être replongée dans ce roman si stimulant et si peu conformiste. Oui, comme l’a écrit Joyce Carol Oates : « On ne dira jamais assez combien ce livre a compté pour les jeunes femmes de ma génération. Il a changé radicalement notre conscience. »
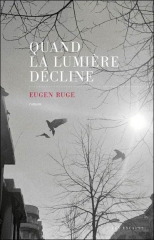 « On entendait un brouhaha et des rires à travers la double porte de l’ancienne cave à vin. Vingt et une heures trente et ils étaient toujours là en bas. […]
« On entendait un brouhaha et des rires à travers la double porte de l’ancienne cave à vin. Vingt et une heures trente et ils étaient toujours là en bas. […]