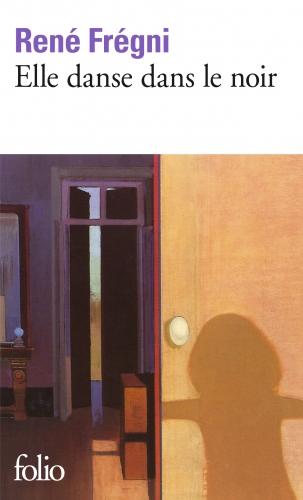Une amie m’a gentiment offert Se trouver de Pirandello, (Trovarsi, traduit de l’italien par Michel Arnaud), dans une collection précieuse pour les amateurs de théâtre, le Répertoire pour un théâtre populaire de l’Arche. La pièce est dédiée « A Marta Abba, pour que je ne meure pas » (L. P.) et son profil figure en couverture, lors de la création à Naples, en 1932, de la pièce que Pirandello (1867-1936) a écrite pour elle, « sa compagne et son inspiratrice ».

Marta Abba (source)
J’ai pris grand plaisir à la découverte de ce texte que je ne connaissais pas. Emmanuelle Béart a incarné cette « Donata Genzi, une comédienne qui se perd dans ses incertitudes de femme à la ville comme à la scène » (TNB, Rennes). Les deux premiers actes se déroulent sur la Riviera, le troisième dans une chambre « d’un luxueux hôtel de grande ville » (selon les didascalies).
Dans la villa d’Elisa Acuri, qui a invité Donata à séjourner chez elle, des invités arrivent pour le dîner : Giviero (« jeune homme mûr, proche de la quarantaine »), un médecin fortuné qui n’exerce pas, la marquise Boveno (« une vraie dame ») et sa petite-fille Nina qui se chamaillent sur la nécessité de prendre un châle vu le temps très venteux, le comte Mola (la cinquantaine, très élégant).
Nina commente le va-et-vient des invités qui montent ou descendent de la galerie. D’après elle, qui ose tout dire, tout le monde sait que Giviero a été l’amant de Donata. Comme Nina mais pour d’autres raisons, Mola redoute ce que va faire son neveu Ely, qu’il envoie chercher : celui-ci « s’est mis en tête de partir ce soir sur son bateau, et par une mer pareille ! »
Avec Volpès et Salio, deux autres arrivants, les invités s’interrogent sur le genre de femme qu’est Donata Genzi, qu’on dit « tourmentée », « une femme difficile »… Pour Salio, c’est une erreur de vouloir savoir ce qu’elle est « comme femme » parce que Donata est une vraie actrice « qui « vit » quand elle est sur scène et non « qui joue la comédie » dans la vie ».
Elisa, la trentaine, dit de Donata qu’elle est « l’être le plus simple et le plus gentil du monde ». Elles se sont connues à l’école, retrouvées récemment. Comme Donata a besoin de repos, Elisa l’a accueillie en « lui promettant que personne ne la verrait ». L’actrice vit seule. Et la conversation repart sur la vie de femme et la vie d’actrice, sur les mœurs supposées des gens de théâtre, sur l’expérience amoureuse…
Le silence se fait quand Donata Genzi descend en robe du soir, « pâle, avec une expression de trouble sur le visage ». La Marquise lui dit la connaître « en tant qu’actrice et non en tant que femme ». Donata affirme être « sincère » dans chacun de ses rôles. Ses vies « fictives » permettent à une actrice de vivre toutes sortes de possibilités, de « se transfigurer ». Ce qu’ils voient sur la scène, c’est comment elle vit la vie de son personnage, non la sienne !
Ils passent dans la salle à manger. Donata, fatiguée, remonte dans sa chambre. Ely arrive alors en vêtements de sport, il a déjà dîné et préfère prendre un livre. Nina lui propose une liqueur, il se dit qu’un jour ou l’autre, il l’attrapera… Puis Donata descend et l’interroge sur son oncle, sur son bateau, et tout à coup lui demande de l’emmener le soir même avec lui sur son voilier !
L’acte II se déroule chez le comte Mola, dans une pièce aménagée en atelier de peintre pour Ely. Vingt jours plus tôt, « Donata a été transportée là, à moitié morte, par Ely, le soir du naufrage du voilier, et elle y est restée. » Le docteur vient de lui refaire un pansement à la nuque, Ely l’a mordue quand elle s’est agrippée à lui pour ne pas qu’ils se noient tous les deux. Ils sont amoureux et pour Donata, c’est l’occasion d’être vraiment elle-même. Ely voudrait qu’ils se marient, qu’elle casse tous ses contrats et renonce au théâtre. Elisa, en véritable amie, l’en dissuade.
Au dernier acte, Ely a quitté le théâtre avant la fin de la représentation. Mola l’a suivi à son hôtel et l’enguirlande de s’être enfui ainsi. Mais son neveu n’en peut plus de voir Donata sur scène, il s’en va. Il l’attendra « quand elle aura retrouvé son vrai visage, quand elle aura fini d’étaler devant tout le monde… » Mola le traite de fou qui ne comprend rien à la vie d’actrice. Arrive Donata, qui avait faibli pendant le spectacle, s’est reprise ensuite et se sent libérée, ivre du bonheur d’avoir recouvré l’intégralité de son être d’actrice et de son être de femme – mais « L’Idiot ! Il est parti ! »
« Bien qu’il s’agisse d’un portrait d’après nature et sur mesure, inspiré par la comédienne Marta Abba, la psychologie en parait un peu simpliste, démodée et rhétorique. Le personnage s’analyse un peu trop. Il ne fait même que cela » a écrit Poirot-Delpech dans Le Monde en 1966. Démodée ? La pièce me semble encore actuelle. Comment vivre sa vocation artistique sans renoncer à sa vie personnelle, comment vivre sa vie sans renoncer à vivre ses rôles ? Si cela vous intéresse, le programme du Théâtre de la Colline est en ligne, avec des textes éclairants sur Se trouver de Pirandello.
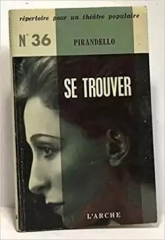 « Et c’est cela qui est vrai… Et rien n’est vrai… Ce qui est vrai, c’est seulement qu’il faut se créer, créer ! Et c’est alors seulement, qu’on se trouve. »
« Et c’est cela qui est vrai… Et rien n’est vrai… Ce qui est vrai, c’est seulement qu’il faut se créer, créer ! Et c’est alors seulement, qu’on se trouve. »